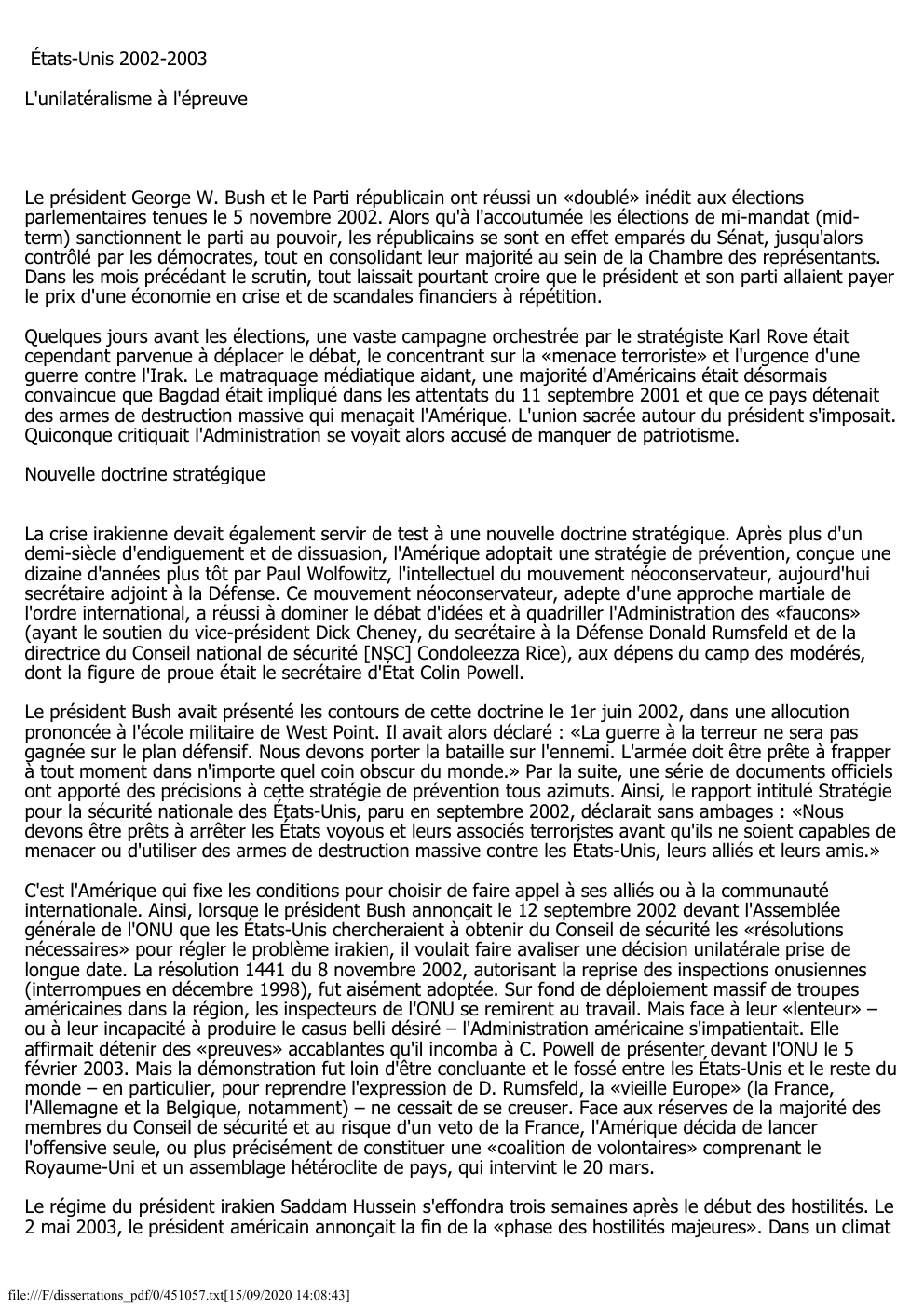États-Unis 2002-2003 L'unilatéralisme à l'épreuve Le président George W. Bush et le Parti républicain ont réussi un «doublé» inédit aux...
Extrait du document
«
États-Unis 2002-2003
L'unilatéralisme à l'épreuve
Le président George W.
Bush et le Parti républicain ont réussi un «doublé» inédit aux élections
parlementaires tenues le 5 novembre 2002.
Alors qu'à l'accoutumée les élections de mi-mandat (midterm) sanctionnent le parti au pouvoir, les républicains se sont en effet emparés du Sénat, jusqu'alors
contrôlé par les démocrates, tout en consolidant leur majorité au sein de la Chambre des représentants.
Dans les mois précédant le scrutin, tout laissait pourtant croire que le président et son parti allaient payer
le prix d'une économie en crise et de scandales financiers à répétition.
Quelques jours avant les élections, une vaste campagne orchestrée par le stratégiste Karl Rove était
cependant parvenue à déplacer le débat, le concentrant sur la «menace terroriste» et l'urgence d'une
guerre contre l'Irak.
Le matraquage médiatique aidant, une majorité d'Américains était désormais
convaincue que Bagdad était impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 et que ce pays détenait
des armes de destruction massive qui menaçait l'Amérique.
L'union sacrée autour du président s'imposait.
Quiconque critiquait l'Administration se voyait alors accusé de manquer de patriotisme.
Nouvelle doctrine stratégique
La crise irakienne devait également servir de test à une nouvelle doctrine stratégique.
Après plus d'un
demi-siècle d'endiguement et de dissuasion, l'Amérique adoptait une stratégie de prévention, conçue une
dizaine d'années plus tôt par Paul Wolfowitz, l'intellectuel du mouvement néoconservateur, aujourd'hui
secrétaire adjoint à la Défense.
Ce mouvement néoconservateur, adepte d'une approche martiale de
l'ordre international, a réussi à dominer le débat d'idées et à quadriller l'Administration des «faucons»
(ayant le soutien du vice-président Dick Cheney, du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld et de la
directrice du Conseil national de sécurité [NSC] Condoleezza Rice), aux dépens du camp des modérés,
dont la figure de proue était le secrétaire d'État Colin Powell.
Le président Bush avait présenté les contours de cette doctrine le 1er juin 2002, dans une allocution
prononcée à l'école militaire de West Point.
Il avait alors déclaré : «La guerre à la terreur ne sera pas
gagnée sur le plan défensif.
Nous devons porter la bataille sur l'ennemi.
L'armée doit être prête à frapper
à tout moment dans n'importe quel coin obscur du monde.» Par la suite, une série de documents officiels
ont apporté des précisions à cette stratégie de prévention tous azimuts.
Ainsi, le rapport intitulé Stratégie
pour la sécurité nationale des États-Unis, paru en septembre 2002, déclarait sans ambages : «Nous
devons être prêts à arrêter les États voyous et leurs associés terroristes avant qu'ils ne soient capables de
menacer ou d'utiliser des armes de destruction massive contre les États-Unis, leurs alliés et leurs amis.»
C'est l'Amérique qui fixe les conditions pour choisir de faire appel à ses alliés ou à la communauté
internationale.
Ainsi, lorsque le président Bush annonçait le 12 septembre 2002 devant l'Assemblée
générale de l'ONU que les États-Unis chercheraient à obtenir du Conseil de sécurité les «résolutions
nécessaires» pour régler le problème irakien, il voulait faire avaliser une décision unilatérale prise de
longue date.
La résolution 1441 du 8 novembre 2002, autorisant la reprise des inspections onusiennes
(interrompues en décembre 1998), fut aisément adoptée.
Sur fond de déploiement massif de troupes
américaines dans la région, les inspecteurs de l'ONU se remirent au travail.
Mais face à leur «lenteur» –
ou à leur incapacité à produire le casus belli désiré – l'Administration américaine s'impatientait.
Elle
affirmait détenir des «preuves» accablantes qu'il incomba à C.
Powell de présenter devant l'ONU le 5
février 2003.
Mais la démonstration fut loin d'être concluante et le fossé entre les États-Unis et le reste du
monde – en particulier, pour reprendre l'expression de D.
Rumsfeld, la «vieille Europe» (la France,
l'Allemagne et la Belgique, notamment) – ne cessait de se creuser.
Face aux réserves de la majorité des
membres du Conseil de sécurité et au risque d'un veto de la France, l'Amérique décida de lancer
l'offensive seule, ou plus précisément de constituer une «coalition de volontaires» comprenant le
Royaume-Uni et un assemblage hétéroclite de pays, qui intervint le 20 mars.
Le régime du président irakien Saddam Hussein s'effondra trois semaines après le début des hostilités.
Le
2 mai 2003, le président américain annonçait la fin de la «phase des hostilités majeures».
Dans un climat
file:///F/dissertations_pdf/0/451057.txt[15/09/2020 14:08:43]
d'euphorie, les néoconservateurs suggéraient d'utiliser la même technique de «renversement de régime»
contre l'Iran, la Syrie, voire l'Arabie saoudite.
Obstacles insoupçonnés
Mais sur le chemin de leurs grandes ambitions politiques – créer un régime irakien stable, remodeler la
région –, les Américains ont découvert qu'ils avaient gravement sous-estimé les difficultés de l'aprèsguerre.
Au lieu d'être accueillis en libérateurs, ils ont vite été perçus comme des occupants étrangers
davantage intéressés par le pétrole et les juteux contrats de reconstruction que par le bien-être du peuple
irakien.
Malgré leurs efforts, les États-Unis n'ont pas trouvé les armes de destruction massive qu'ils
avaient accusé l'Irak de détenir.
Tout en reconnaissant l'origine douteuse des révélations d'avant la
guerre, le président Bush a affirmé que la barbarie avérée du régime de S.
Hussein justifiait à elle seule la
guerre.
Face à son incapacité à endiguer l'anarchie et le chaos, l'équipe américaine chargée de gouverner
l'Irak, dirigée par le général à la retraite Jay Garner, a été remaniée au bout de trois semaines.
La
nomination d'un nouveau «proconsul», le diplomate Paul Bremer, sous l'autorité directe du secrétaire à la
Défense, n'a mis fin ni à l'état d'insécurité ni au mécontentement de la population irakienne.
Le 9 mai 2003, les États-Unis et le Royaume-Uni introduisaient auprès du Conseil de sécurité de l'ONU
une résolution (no 1483) visant à leur accorder les pleins pouvoirs pour administrer l'Irak : un fonds
d'assistance, alimenté principalement par une industrie pétrolière en voie de privatisation, serait placé
sous l'autorité des «puissances occupantes» ; les sanctions contre ce pays seraient suspendues et l'ONU
jouerait un rôle humantaire d'appoint.
Les membres du Conseil de sécurité ont demandé quelques
modifications, accordant en particulier un rôle plus important à l'ONU.
Le vote fut l'occasion de décrisper
un peu les rapports entre les États-Unis et les alliés d'hier – en particulier la France, l'Allemagne et la
Russie – qui s'étaient opposés à la guerre.
Implication dans le conflit israélo-palestinien
À la veille de la guerre, le président Bush avait maintes fois répété que la «libération» de l'Irak
permettrait aussi de résoudre le conflit du Proche Orient, d'autant plus que l'Autorité palestinienne avait
répondu à sa demande de marginaliser....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓