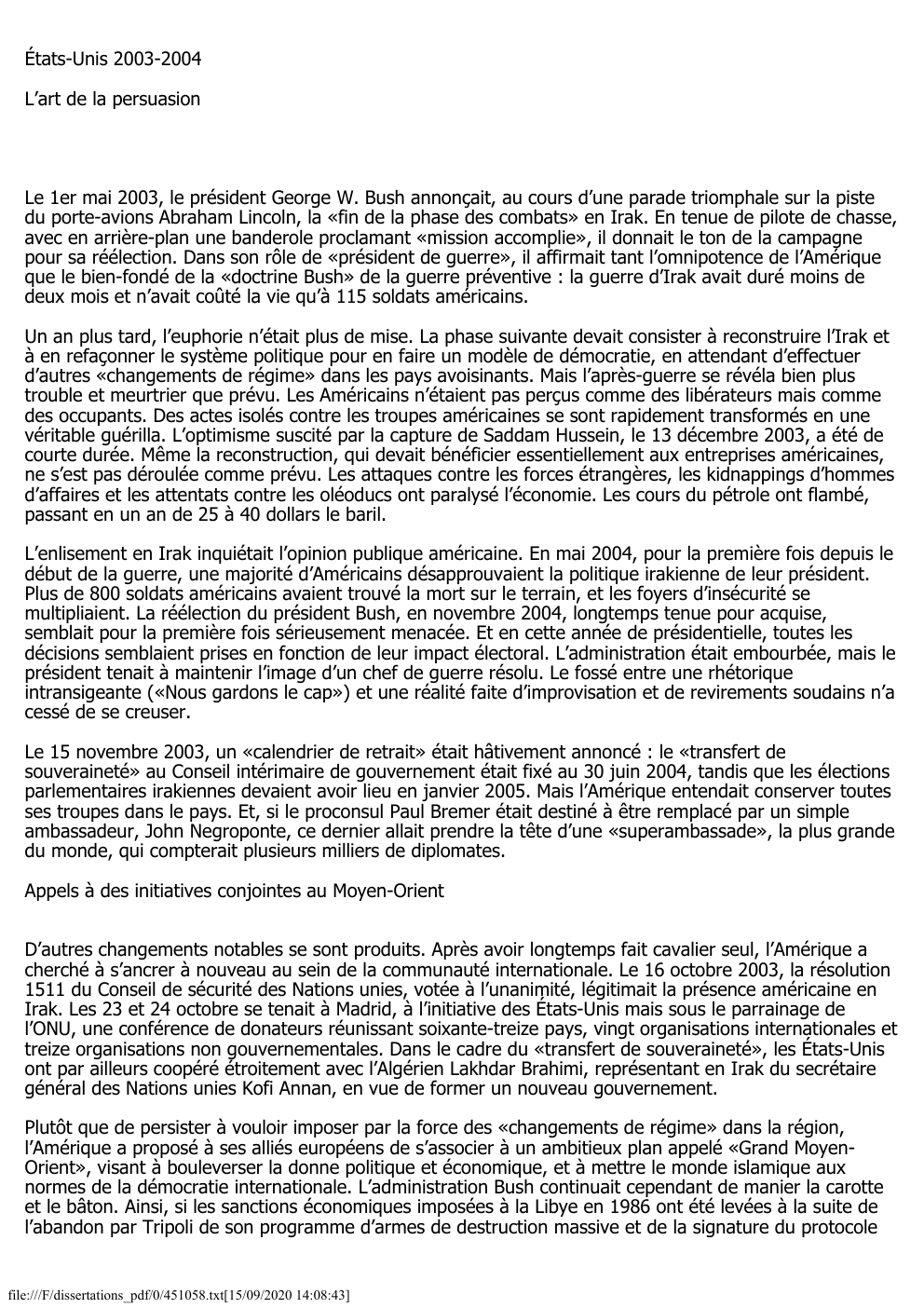États-Unis 2003-2004 L’art de la persuasion Le 1er mai 2003, le président George W. Bush annonçait, au cours d’une parade...
Extrait du document
«
États-Unis 2003-2004
L’art de la persuasion
Le 1er mai 2003, le président George W.
Bush annonçait, au cours d’une parade triomphale sur la piste
du porte-avions Abraham Lincoln, la «fin de la phase des combats» en Irak.
En tenue de pilote de chasse,
avec en arrière-plan une banderole proclamant «mission accomplie», il donnait le ton de la campagne
pour sa réélection.
Dans son rôle de «président de guerre», il affirmait tant l’omnipotence de l’Amérique
que le bien-fondé de la «doctrine Bush» de la guerre préventive : la guerre d’Irak avait duré moins de
deux mois et n’avait coûté la vie qu’à 115 soldats américains.
Un an plus tard, l’euphorie n’était plus de mise.
La phase suivante devait consister à reconstruire l’Irak et
à en refaçonner le système politique pour en faire un modèle de démocratie, en attendant d’effectuer
d’autres «changements de régime» dans les pays avoisinants.
Mais l’après-guerre se révéla bien plus
trouble et meurtrier que prévu.
Les Américains n’étaient pas perçus comme des libérateurs mais comme
des occupants.
Des actes isolés contre les troupes américaines se sont rapidement transformés en une
véritable guérilla.
L’optimisme suscité par la capture de Saddam Hussein, le 13 décembre 2003, a été de
courte durée.
Même la reconstruction, qui devait bénéficier essentiellement aux entreprises américaines,
ne s’est pas déroulée comme prévu.
Les attaques contre les forces étrangères, les kidnappings d’hommes
d’affaires et les attentats contre les oléoducs ont paralysé l’économie.
Les cours du pétrole ont flambé,
passant en un an de 25 à 40 dollars le baril.
L’enlisement en Irak inquiétait l’opinion publique américaine.
En mai 2004, pour la première fois depuis le
début de la guerre, une majorité d’Américains désapprouvaient la politique irakienne de leur président.
Plus de 800 soldats américains avaient trouvé la mort sur le terrain, et les foyers d’insécurité se
multipliaient.
La réélection du président Bush, en novembre 2004, longtemps tenue pour acquise,
semblait pour la première fois sérieusement menacée.
Et en cette année de présidentielle, toutes les
décisions semblaient prises en fonction de leur impact électoral.
L’administration était embourbée, mais le
président tenait à maintenir l’image d’un chef de guerre résolu.
Le fossé entre une rhétorique
intransigeante («Nous gardons le cap») et une réalité faite d’improvisation et de revirements soudains n’a
cessé de se creuser.
Le 15 novembre 2003, un «calendrier de retrait» était hâtivement annoncé : le «transfert de
souveraineté» au Conseil intérimaire de gouvernement était fixé au 30 juin 2004, tandis que les élections
parlementaires irakiennes devaient avoir lieu en janvier 2005.
Mais l’Amérique entendait conserver toutes
ses troupes dans le pays.
Et, si le proconsul Paul Bremer était destiné à être remplacé par un simple
ambassadeur, John Negroponte, ce dernier allait prendre la tête d’une «superambassade», la plus grande
du monde, qui compterait plusieurs milliers de diplomates.
Appels à des initiatives conjointes au Moyen-Orient
D’autres changements notables se sont produits.
Après avoir longtemps fait cavalier seul, l’Amérique a
cherché à s’ancrer à nouveau au sein de la communauté internationale.
Le 16 octobre 2003, la résolution
1511 du Conseil de sécurité des Nations unies, votée à l’unanimité, légitimait la présence américaine en
Irak.
Les 23 et 24 octobre se tenait à Madrid, à l’initiative des États-Unis mais sous le parrainage de
l’ONU, une conférence de donateurs réunissant soixante-treize pays, vingt organisations internationales et
treize organisations non gouvernementales.
Dans le cadre du «transfert de souveraineté», les États-Unis
ont par ailleurs coopéré étroitement avec l’Algérien Lakhdar Brahimi, représentant en Irak du secrétaire
général des Nations unies Kofi Annan, en vue de former un nouveau gouvernement.
Plutôt que de persister à vouloir imposer par la force des «changements de régime» dans la région,
l’Amérique a proposé à ses alliés européens de s’associer à un ambitieux plan appelé «Grand MoyenOrient», visant à bouleverser la donne politique et économique, et à mettre le monde islamique aux
normes de la démocratie internationale.
L’administration Bush continuait cependant de manier la carotte
et le bâton.
Ainsi, si les sanctions économiques imposées à la Libye en 1986 ont été levées à la suite de
l’abandon par Tripoli de son programme d’armes de destruction massive et de la signature du protocole
file:///F/dissertations_pdf/0/451058.txt[15/09/2020 14:08:43]
additionnel du TNP (Traité de non-prolifération nucléaire), de nouvelles sanctions étaient imposées à la
Syrie, accusée de complaisance envers certains «mouvements terroristes».
Sur le plan électoral, l’année 2004 se présentait initialement sous de bons augures pour G.
W.
Bush, qui
n’avait pas à subir des primaires au sein de sa formation, le Parti républicain.
Le locataire de la MaisonBlanche, armé d’un trésor de guerre de plus de 100 millions de dollars et à la tête d’un parti uni, semblait
bien parti pour jouer la carte sécuritaire contre une opposition divisée et affaiblie.
Neuf candidats se sont,
en effet, disputé l’investiture du Parti démocrate.
L’ex-gouverneur du Vermont, Howard Dean, était en
tête dans tous les sondages, la véhémence de son discours contre la guerre en Irak lui ayant permis de
mobiliser les militants de base.
Il avait également su utiliser Internet pour se faire connaître du plus
grand nombre et obtenir des contributions financières conséquentes.
Il avait reçu l’appui de ténors du
parti, tel Albert Gore, l’ex-vice-président et candidat à la présidentielle de 2000.
Le candidat Bush
s’apprêtait donc à affronter ce candidat jugé peu en phase avec une Amérique conservatrice.
La campagne consensuelle de John Kerry
Mais, dès les premières consultations – les «caucus» de l’Iowa (19 janvier 2004) et les primaires du New
Hampshire (27 janvier) –, John Kerry, le sénateur du Massachusetts, créa la surprise.
Après quelques
victoires aisées, il vola de succès en succès.
La candidature de Howard Dean fit long feu, et seul John
Edwards, sénateur de Caroline du Nord, obtint des scores honorables, en particulier dans les États du
Sud, avant de se retirer de la course.
Cette performance lui valut d'ailleurs d'être choisi par le sénateur
Kerry comme colistier, le 6 juillet 2004.
En sélectionnant J.
Kerry, un homme d’expérience mais manquant de charisme, les démocrates avaient
misé sur le candidat le plus apte à battre un président sortant disposant d’atouts considérables.
Car,
malgré les déconvenues irakiennes, les préoccupations sécuritaires jouent souvent en faveur d’un
président en exercice.
Vétéran de la guerre du Vietnam, le candidat démocrate avait, par la suite, fondé
un mouvement d’anciens combattants opposés à la guerre.
Même si certains milieux d’extrême droite
mettaient son patriotisme en doute, J.
Kerry pouvait être un «président de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓