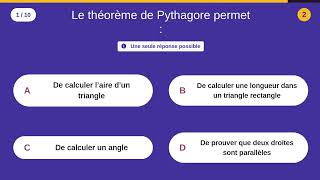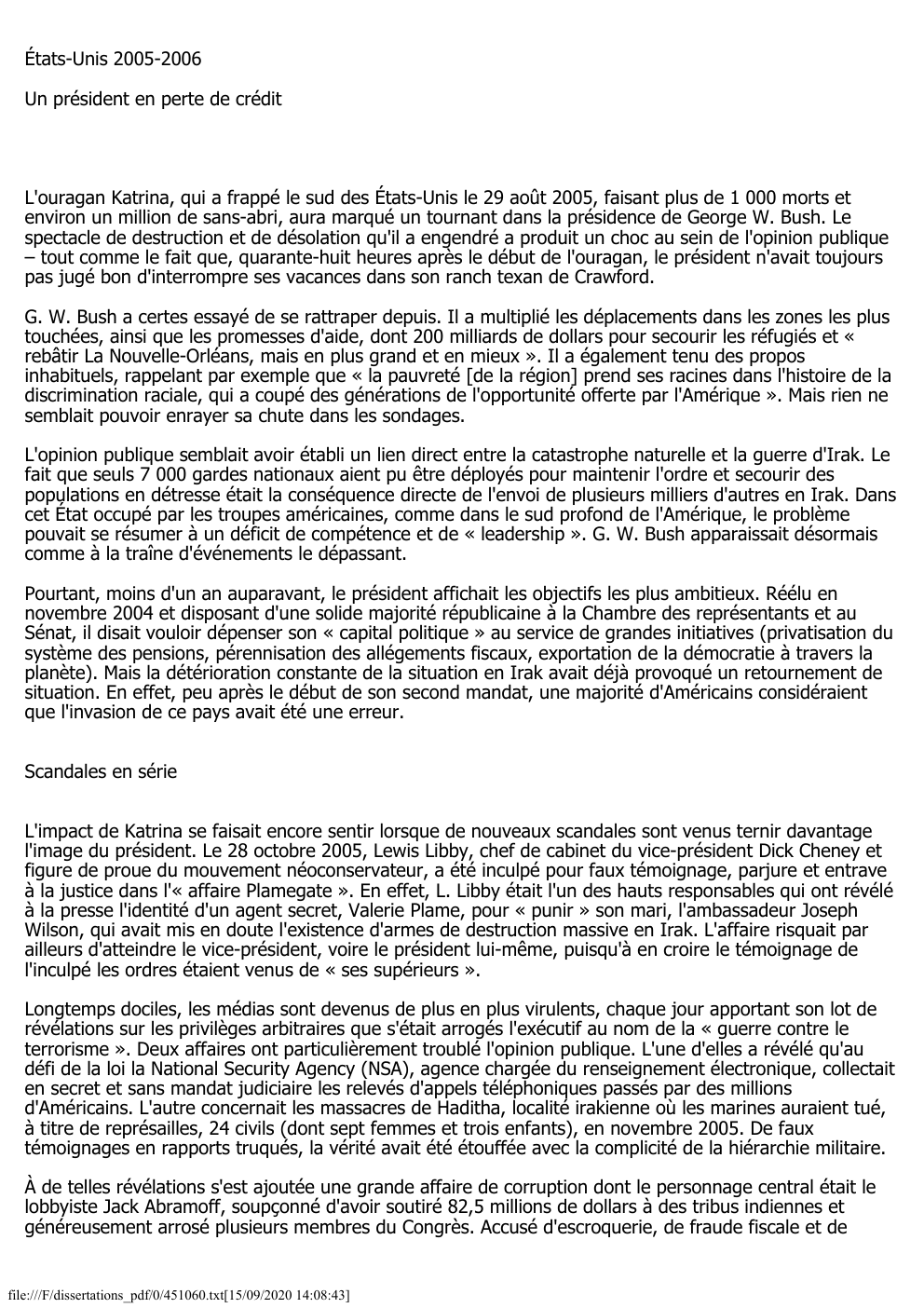États-Unis 2005-2006 Un président en perte de crédit L'ouragan Katrina, qui a frappé le sud des États-Unis le 29 août...
Extrait du document
«
États-Unis 2005-2006
Un président en perte de crédit
L'ouragan Katrina, qui a frappé le sud des États-Unis le 29 août 2005, faisant plus de 1 000 morts et
environ un million de sans-abri, aura marqué un tournant dans la présidence de George W.
Bush.
Le
spectacle de destruction et de désolation qu'il a engendré a produit un choc au sein de l'opinion publique
– tout comme le fait que, quarante-huit heures après le début de l'ouragan, le président n'avait toujours
pas jugé bon d'interrompre ses vacances dans son ranch texan de Crawford.
G.
W.
Bush a certes essayé de se rattraper depuis.
Il a multiplié les déplacements dans les zones les plus
touchées, ainsi que les promesses d'aide, dont 200 milliards de dollars pour secourir les réfugiés et «
rebâtir La Nouvelle-Orléans, mais en plus grand et en mieux ».
Il a également tenu des propos
inhabituels, rappelant par exemple que « la pauvreté [de la région] prend ses racines dans l'histoire de la
discrimination raciale, qui a coupé des générations de l'opportunité offerte par l'Amérique ».
Mais rien ne
semblait pouvoir enrayer sa chute dans les sondages.
L'opinion publique semblait avoir établi un lien direct entre la catastrophe naturelle et la guerre d'Irak.
Le
fait que seuls 7 000 gardes nationaux aient pu être déployés pour maintenir l'ordre et secourir des
populations en détresse était la conséquence directe de l'envoi de plusieurs milliers d'autres en Irak.
Dans
cet État occupé par les troupes américaines, comme dans le sud profond de l'Amérique, le problème
pouvait se résumer à un déficit de compétence et de « leadership ».
G.
W.
Bush apparaissait désormais
comme à la traîne d'événements le dépassant.
Pourtant, moins d'un an auparavant, le président affichait les objectifs les plus ambitieux.
Réélu en
novembre 2004 et disposant d'une solide majorité républicaine à la Chambre des représentants et au
Sénat, il disait vouloir dépenser son « capital politique » au service de grandes initiatives (privatisation du
système des pensions, pérennisation des allégements fiscaux, exportation de la démocratie à travers la
planète).
Mais la détérioration constante de la situation en Irak avait déjà provoqué un retournement de
situation.
En effet, peu après le début de son second mandat, une majorité d'Américains considéraient
que l'invasion de ce pays avait été une erreur.
Scandales en série
L'impact de Katrina se faisait encore sentir lorsque de nouveaux scandales sont venus ternir davantage
l'image du président.
Le 28 octobre 2005, Lewis Libby, chef de cabinet du vice-président Dick Cheney et
figure de proue du mouvement néoconservateur, a été inculpé pour faux témoignage, parjure et entrave
à la justice dans l'« affaire Plamegate ».
En effet, L.
Libby était l'un des hauts responsables qui ont révélé
à la presse l'identité d'un agent secret, Valerie Plame, pour « punir » son mari, l'ambassadeur Joseph
Wilson, qui avait mis en doute l'existence d'armes de destruction massive en Irak.
L'affaire risquait par
ailleurs d'atteindre le vice-président, voire le président lui-même, puisqu'à en croire le témoignage de
l'inculpé les ordres étaient venus de « ses supérieurs ».
Longtemps dociles, les médias sont devenus de plus en plus virulents, chaque jour apportant son lot de
révélations sur les privilèges arbitraires que s'était arrogés l'exécutif au nom de la « guerre contre le
terrorisme ».
Deux affaires ont particulièrement troublé l'opinion publique.
L'une d'elles a révélé qu'au
défi de la loi la National Security Agency (NSA), agence chargée du renseignement électronique, collectait
en secret et sans mandat judiciaire les relevés d'appels téléphoniques passés par des millions
d'Américains.
L'autre concernait les massacres de Haditha, localité irakienne où les marines auraient tué,
à titre de représailles, 24 civils (dont sept femmes et trois enfants), en novembre 2005.
De faux
témoignages en rapports truqués, la vérité avait été étouffée avec la complicité de la hiérarchie militaire.
À de telles révélations s'est ajoutée une grande affaire de corruption dont le personnage central était le
lobbyiste Jack Abramoff, soupçonné d'avoir soutiré 82,5 millions de dollars à des tribus indiennes et
généreusement arrosé plusieurs membres du Congrès.
Accusé d'escroquerie, de fraude fiscale et de
file:///F/dissertations_pdf/0/451060.txt[15/09/2020 14:08:43]
corruption active de « responsables publics », J.
Abramoff a plaidé coupable le 3 janvier 2006.
Ses
révélations promettaient d'éclabousser plusieurs responsables importants du Parti républicain ainsi que
certains démocrates.
L'une des premières victimes collatérales de l'affaire fut le représentant du Texas et
ancien chef de la majorité républicaine à la Chambre, Tom Delay, qui a démissionné et renoncé à
participer aux élections parlementaires de novembre 2006.
Une majorité désolidarisée du président
La perspective d'une débâcle électorale lors de ces élections de mi-parcours du mandat présidentiel (midterm) a, par ailleurs, provoqué une véritable fronde au sein du parti.
Les élus républicains craignaient en
effet par-dessus tout de faire les frais de l'impopularité du président et cherchaient à prendre leurs
distances vis-à-vis de l'occupant de la Maison-Blanche.
À l'initiative de l'influent sénateur John McCain, qui fut longtemps prisonnier de guerre au Vietnam, le
Sénat s'est prononcé par 90 voix (sur 100) contre les traitements inhumains infligés aux détenus
soupçonnés de terrorisme.
Le Congrès a également obtenu un droit de regard plus grand sur la conduite
de la guerre en Irak, et c'est au forceps que la loi USA PATRIOT, votée à la suite des attentats du 11
septembre 2001 et qui accordait des pouvoirs accrus à l'exécutif, s'est vue renouvelée.
Des « faucons »
de premier plan ont en effet changé de camp, et l'on a même vu six généraux à la retraite réclamer la
démission du secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, auquel le président n'a cessé de réaffirmer son
soutien.
À ceux qui réclamaient avec insistance le retour des troupes américaines d'Irak, la position
officielle de l'Administration consistait à répéter que toute fixation artificielle d'un calendrier de retrait ne
ferait qu'encourager l'insurrection et compromettre la stratégie de « victoire complète ».
L'opposition républicaine a même bravé la menace d'un veto présidentiel (qui aurait été le premier en
cinq ans) dans l'« affaire Dubai Ports World », la compagnie appartenant au gouvernement de Dubaï, qui,
via....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓