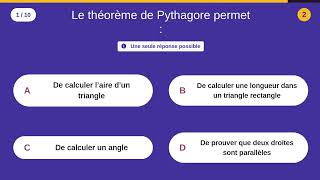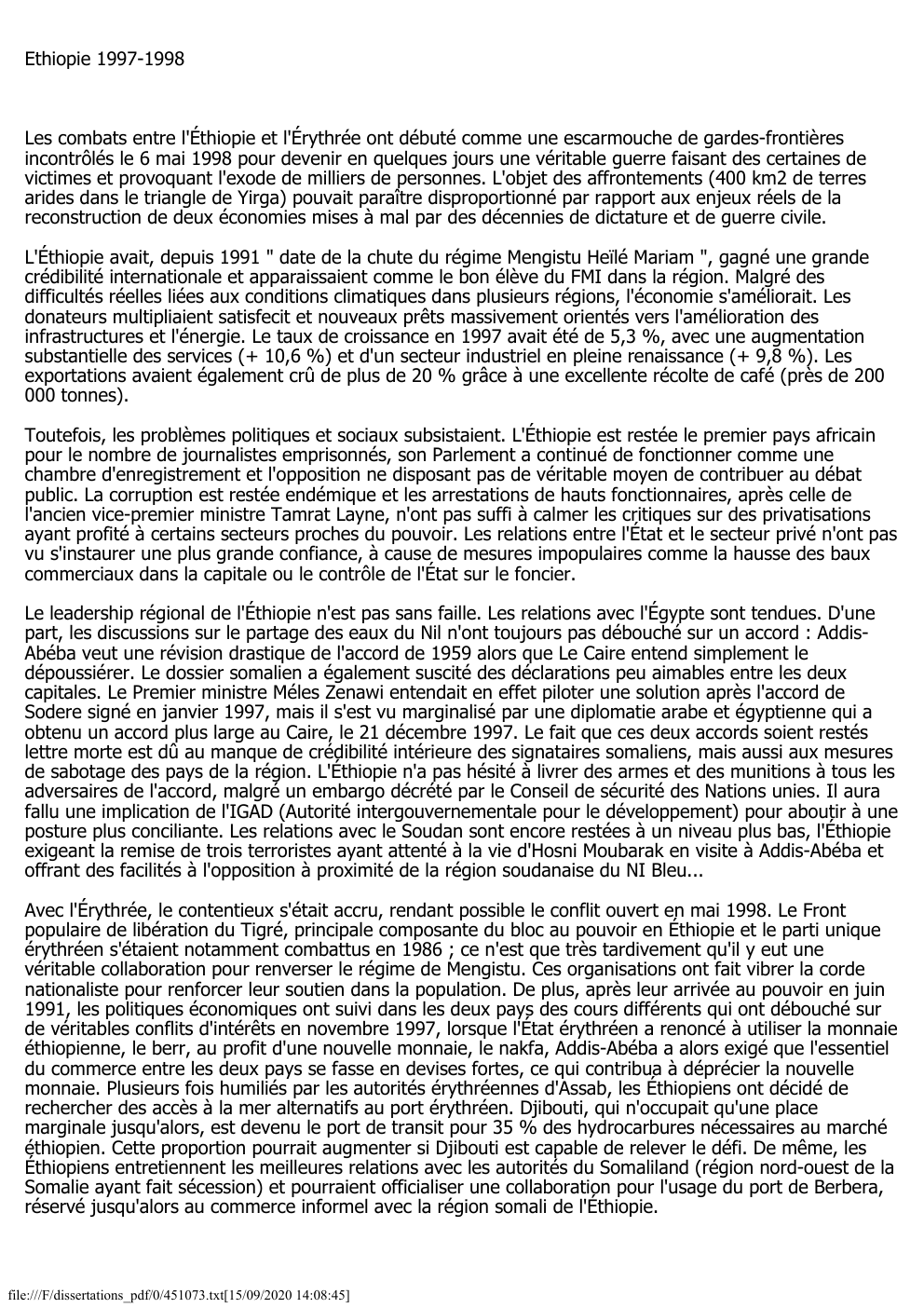Ethiopie 1997-1998 Les combats entre l'Éthiopie et l'Érythrée ont débuté comme une escarmouche de gardes-frontières incontrôlés le 6 mai 1998...
Extrait du document
«
Ethiopie 1997-1998
Les combats entre l'Éthiopie et l'Érythrée ont débuté comme une escarmouche de gardes-frontières
incontrôlés le 6 mai 1998 pour devenir en quelques jours une véritable guerre faisant des certaines de
victimes et provoquant l'exode de milliers de personnes.
L'objet des affrontements (400 km2 de terres
arides dans le triangle de Yirga) pouvait paraître disproportionné par rapport aux enjeux réels de la
reconstruction de deux économies mises à mal par des décennies de dictature et de guerre civile.
L'Éthiopie avait, depuis 1991 " date de la chute du régime Mengistu Heïlé Mariam ", gagné une grande
crédibilité internationale et apparaissaient comme le bon élève du FMI dans la région.
Malgré des
difficultés réelles liées aux conditions climatiques dans plusieurs régions, l'économie s'améliorait.
Les
donateurs multipliaient satisfecit et nouveaux prêts massivement orientés vers l'amélioration des
infrastructures et l'énergie.
Le taux de croissance en 1997 avait été de 5,3 %, avec une augmentation
substantielle des services (+ 10,6 %) et d'un secteur industriel en pleine renaissance (+ 9,8 %).
Les
exportations avaient également crû de plus de 20 % grâce à une excellente récolte de café (près de 200
000 tonnes).
Toutefois, les problèmes politiques et sociaux subsistaient.
L'Éthiopie est restée le premier pays africain
pour le nombre de journalistes emprisonnés, son Parlement a continué de fonctionner comme une
chambre d'enregistrement et l'opposition ne disposant pas de véritable moyen de contribuer au débat
public.
La corruption est restée endémique et les arrestations de hauts fonctionnaires, après celle de
l'ancien vice-premier ministre Tamrat Layne, n'ont pas suffi à calmer les critiques sur des privatisations
ayant profité à certains secteurs proches du pouvoir.
Les relations entre l'État et le secteur privé n'ont pas
vu s'instaurer une plus grande confiance, à cause de mesures impopulaires comme la hausse des baux
commerciaux dans la capitale ou le contrôle de l'État sur le foncier.
Le leadership régional de l'Éthiopie n'est pas sans faille.
Les relations avec l'Égypte sont tendues.
D'une
part, les discussions sur le partage des eaux du Nil n'ont toujours pas débouché sur un accord : AddisAbéba veut une révision drastique de l'accord de 1959 alors que Le Caire entend simplement le
dépoussiérer.
Le dossier somalien a également suscité des déclarations peu aimables entre les deux
capitales.
Le Premier ministre Méles Zenawi entendait en effet piloter une solution après l'accord de
Sodere signé en janvier 1997, mais il s'est vu marginalisé par une diplomatie arabe et égyptienne qui a
obtenu un accord plus large au Caire, le 21 décembre 1997.
Le fait que ces deux accords soient restés
lettre morte est dû au manque de crédibilité intérieure des signataires somaliens, mais aussi aux mesures
de sabotage des pays de la région.
L'Éthiopie n'a pas hésité à livrer des armes et des munitions à tous les
adversaires de l'accord, malgré un embargo décrété par le Conseil de sécurité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓