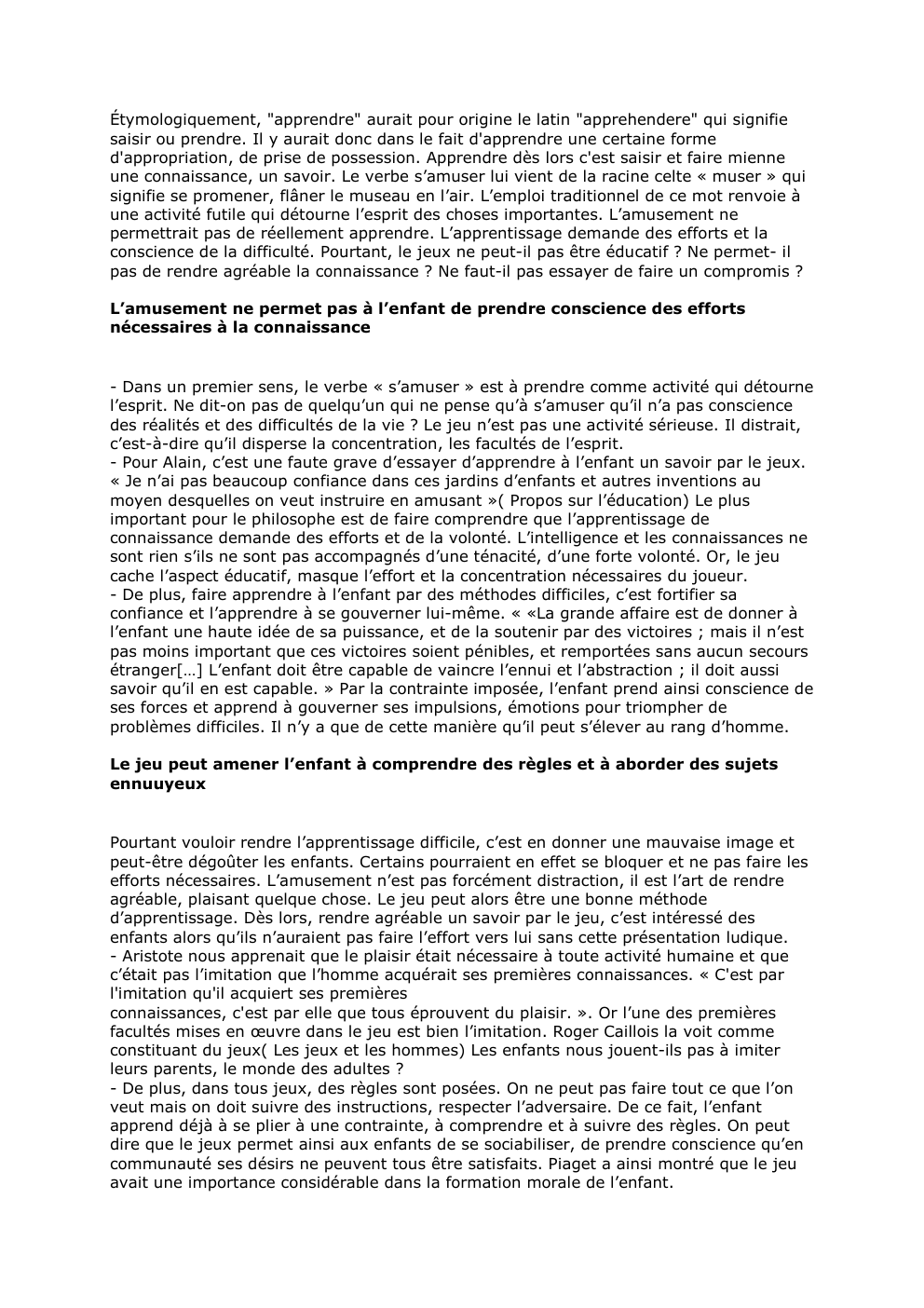Étymologiquement, "apprendre" aurait pour origine le latin "apprehendere" qui signifie saisir ou prendre. Il y aurait donc dans le fait...
Extrait du document
«
Étymologiquement, "apprendre" aurait pour origine le latin "apprehendere" qui signifie
saisir ou prendre.
Il y aurait donc dans le fait d'apprendre une certaine forme
d'appropriation, de prise de possession.
Apprendre dès lors c'est saisir et faire mienne
une connaissance, un savoir.
Le verbe s’amuser lui vient de la racine celte « muser » qui
signifie se promener, flâner le museau en l’air.
L’emploi traditionnel de ce mot renvoie à
une activité futile qui détourne l’esprit des choses importantes.
L’amusement ne
permettrait pas de réellement apprendre.
L’apprentissage demande des efforts et la
conscience de la difficulté.
Pourtant, le jeux ne peut-il pas être éducatif ? Ne permet- il
pas de rendre agréable la connaissance ? Ne faut-il pas essayer de faire un compromis ?
L’amusement ne permet pas à l’enfant de prendre conscience des efforts
nécessaires à la connaissance
- Dans un premier sens, le verbe « s’amuser » est à prendre comme activité qui détourne
l’esprit.
Ne dit-on pas de quelqu’un qui ne pense qu’à s’amuser qu’il n’a pas conscience
des réalités et des difficultés de la vie ? Le jeu n’est pas une activité sérieuse.
Il distrait,
c’est-à-dire qu’il disperse la concentration, les facultés de l’esprit.
- Pour Alain, c’est une faute grave d’essayer d’apprendre à l’enfant un savoir par le jeux.
« Je n’ai pas beaucoup confiance dans ces jardins d’enfants et autres inventions au
moyen desquelles on veut instruire en amusant »( Propos sur l’éducation) Le plus
important pour le philosophe est de faire comprendre que l’apprentissage de
connaissance demande des efforts et de la volonté.
L’intelligence et les connaissances ne
sont rien s’ils ne sont pas accompagnés d’une ténacité, d’une forte volonté.
Or, le jeu
cache l’aspect éducatif, masque l’effort et la concentration nécessaires du joueur.
- De plus, faire apprendre à l’enfant par des méthodes difficiles, c’est fortifier sa
confiance et l’apprendre à se gouverner lui-même.
« «La grande affaire est de donner à
l’enfant une haute idée de sa puissance, et de la soutenir par des victoires ; mais il n’est
pas moins important que ces victoires soient pénibles, et remportées sans aucun secours
étranger[…] L’enfant doit être capable de vaincre l’ennui et l’abstraction ; il doit aussi
savoir qu’il en est capable.
» Par la contrainte imposée, l’enfant prend ainsi conscience de
ses forces et apprend à gouverner ses impulsions, émotions pour triompher de
problèmes difficiles.
Il n’y a que de cette manière qu’il peut s’élever au rang d’homme.
Le jeu peut amener l’enfant à comprendre des règles et à aborder des sujets
ennuuyeux
Pourtant vouloir rendre l’apprentissage difficile, c’est en donner une mauvaise image et
peut-être dégoûter les enfants.
Certains pourraient en effet se bloquer et ne pas faire les
efforts nécessaires.
L’amusement n’est pas forcément distraction, il est l’art de rendre
agréable, plaisant quelque chose.
Le jeu peut alors être une bonne méthode
d’apprentissage.
Dès lors, rendre agréable un savoir par le jeu, c’est intéressé des
enfants alors qu’ils n’auraient pas faire l’effort vers lui sans cette présentation ludique.
- Aristote nous apprenait que le plaisir était nécessaire à toute activité humaine et que
c’était pas l’imitation que l’homme acquérait ses premières connaissances.
« C'est par
l'imitation qu'il acquiert ses premières
connaissances, c'est par elle que tous éprouvent du plaisir.
».
Or l’une des premières
facultés mises en œuvre dans le jeu est bien l’imitation.
Roger Caillois la voit comme
constituant du jeux( Les jeux et les hommes) Les enfants nous jouent-ils pas à imiter
leurs parents, le monde des adultes ?
-....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓