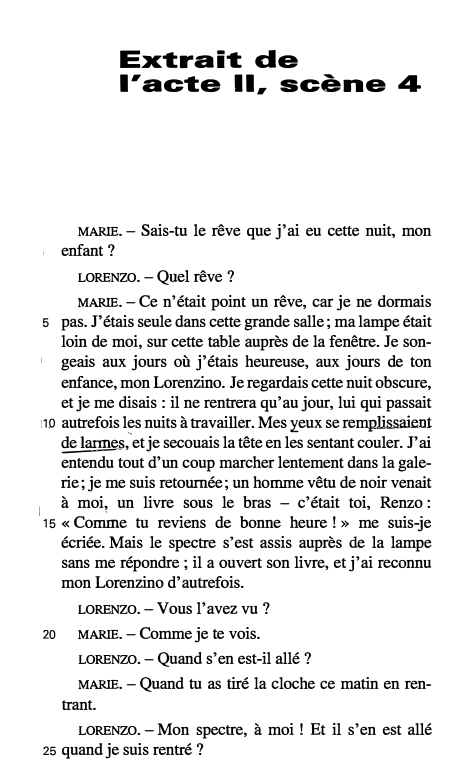Extrait de l'acte Il, scène 4 MARIE. - Sais-tu le rêve que j'ai eu cette nuit, mon enfant? LORENZO. -Quel...
Extrait du document
«
Extrait de
l'acte Il, scène 4
MARIE.
- Sais-tu le rêve que j'ai eu cette nuit, mon
enfant?
LORENZO.
-Quel rêve?
MARIE.
-Ce n'était point un rêve, car je ne dormais
5 pas.
J'étais seule dans cette grande salle ; ma lampe était
loin de moi, sur cette table auprès de la fenêtre.
Je son
, geais aux jours où j'étais heureuse, aux jours de ton
enfance, mon Lorenzino.
Je regardais cette nuit obscure,
etje me disais: il ne rentrera qu'aujour, lui qui passait
110 autrefois les nuits à travailler.
Mes yeux se remplissaient
�s;·etje secouais la tête en les sentant couler.
J'ai
entendu tout d'un coup marcher lentement dans la gale
rie;je me suis retournée; un homme vêtu de noir venait
, à moi, un livre sous le bras - c'était toi, Renzo:
' 15 « Comme tu reviens de bonne heure ! » me suis-je
écriée.
Mais le spectre s'est assis auprès de la lampe
sans me répondre ; il a ouvert son livre, etj'ai reconnu
mon Lorenzino d'autrefois.
LORENZO.
-Vous l'avez vu?
20 MARIE.
-Commeje te vois.
LORENZO.
-Quand s'en est-il allé?
MARIE.
-Quand tu as tiré la cloche ce matin en ren
trant.
LORENZO.
-Mon spectre, à moi ! Et il s'en est allé
25 quandje suis rentré?
,
MARIE.
- Il s'est levé d'un air mélancolique, et s'est
effacé comme une vapeur du matin.
LORENZO.
-
Catherine, Catherine, lis-moi l'histoire de
Brutus.
30
CATHERINE.
-
Qu'avez-vous? vous tremblez de la tête
aux pieds.
LORENZO.
- Ma mère, asseyez-vous ce soir à la place
où vous étiez cette nuit, et si mon spectre revient, diteslui qu'il verra bientôt quelque chose qui l'étonnera.
LECTURE
MÉTHODIQUE
INTRODUCTION
Dans cette scène apparaissent, outre Lorenzo, deux personnages féminins que le spectateur connaît déjà, depuis
l'acte 1, scène 6 : Marie Soderini, mère de Lorenzo, et
Catherine Ginori, sœur de Marie et tante du jeune homme.
On les y a déjà entendues déplorer la déchéance de
Lorenzo, et évoquer l'enfant généreux et épris d'héroïsme
qu'il était- autrefois.
Il paraît donc très naturel de voir ici la
mère de Lorenzo hantée par l'image de son « Lorenzino
d'autrefois », comme par celle d'un disparu.
Précisément,
ce Lorenzo va connaître dans cette scène une résurrection,
à travers l'hallucination de Marie.
Musset a travaillé la vraisemblance psychologique pour
faciliter l'insertion du surnaturel dans le quotidien : ce sera
notre premier axe d'étude.
La puissance poétique qui
baigne la scène mérite ensuite d'être analysée.
Il restera
alors à étudier la portée symbolique du rêve de Marie; en
Lorenzo, auditeur du récit de sa mère, surgit un rêve d'action et de grandeur : d'où l'importance dramatique de ce
passage dans le processus de maturation qui mènera jus~
qu'au meurtre.
26
J
\,
1.
LA VRAISEMBLANCE
PSYCHOLOGIQUE
1
Un climat favorable
à l'hallucination
: Musset a tout fait pour que la vision de Marie paraisse
émaner naturellement de la songerie solitaire d'une mère
sur le passé de son fils.
« Je songeais au jour où j'étais heu
reuse» : cette nostalgie est également naturelle chez une
femme que tout dans son fils a meurtrie.
Le surgissement
des larmes (1.
10-11) signale la commotion affective et
annonce le trouble de l'hallucination.
Musset a multiplié les éléments extérieurs favorables au
phénomène de vision : la solitude de Marie, la pénombre
qui baigne la pièce, l'espace vaste et comme déserté
(« J'étais seule dans cette grande salle»).
Pareille à la
lampe placée loin de Marie (1.
5-6), on imagine volontiers
que sa conscience ne l'éclaire plus que faiblement, et ne
fait plus barrage aux images du passé.
Le surnaturel dans le quotidien
Le surnaturel paraît s'ins�rer avec aisance dans le quoti
dien.
Sans frayeur, Marie aècueille l'apparition, avec les
simples mots par lesquels une mère interroge son fils qui
rentre : « Comme tu reviens de bonne heure ! » (1.
15).
Cette nuance d'étonnement s'explique par le fait que Marie
garde à l'esprit, jusque dans sa vision, les nuits agitées que
Lorenzo passe d'ordinaire au dehors.
Comme s'il accom
plissait des gestes quotidiens, le spectre s'installe sous la
lampe et se plonge dans sa lecture : tout naturellement,
l'image du fils réfléchi et paisible que Marie croyait disparu
a repris sa place (1.
17-18).
Ainsi le surnaturel s'inscrit-il avec une tranquille évidence
dans !'.esprit de Marie.
Musset a écarté tout pittoresque
macabre dont un mauvais romantisme aurait pu décorer
cette scène d'apparition.
Sur le plan formel, on remarque la.
continuité dans le passage de la réalité à la vision : des
expressions comme « J'ai entendu tout d'un coup mar- _
cher» (1.
11-12), ou « le spectre s'est assis» (1.
16) excluent
la source objective de la perception.
2.
PUISSANCE POÉTIQUE
DE L'ÉVOCATION
La poésie de la solitude
et de la douleur
En quelques brèves phrases, Musset a suggéré l'espace
plein d'ombre qui entoure la mère de Lorenzo et accroît sa
solitude : il nous invite à imaginer la « grande salle » austère
d'une demeure du xv1• siècle, prolongée par une « galerie »
où l'écho des pas (« j'ai entendu marcher lentement »)
agrandit encore l'espace.
On aperçoit le visage de Marie à
travers un clair-obscur, comme dans maints tableaux de la
Renaissance.
Et devant les larmes qui emplissent ses yeux, comment
ne pas songer à celles d'une autre Marie, la Vierge, si souvent peinte par les artistes florentins ? Musset a suggéré
une variation sur le thème de la Madone, de la Mater Dolorosa qui pense avoir définitivement perdu son fils, comme
Marie Soderini croit disparu son Lorenzino d'autrefois.
1
La poésie du silence
Le silence, déjà présent dans l'évocation de la demeure,
acquiert une dimension mystérieuse avec le silence du
spectre qui ne répond pas à Marie (1.
17).
Contrastant avec
lui, le son de la cloche (1.
22) en rompt l'enchantement surnaturel au matin.
Ce silence du spectre est riche de suggestions qui en
font la poésie : s'opposant ati bavardage habituel de
Lorenzo, il symbolise la paix domestique et la soumission....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓