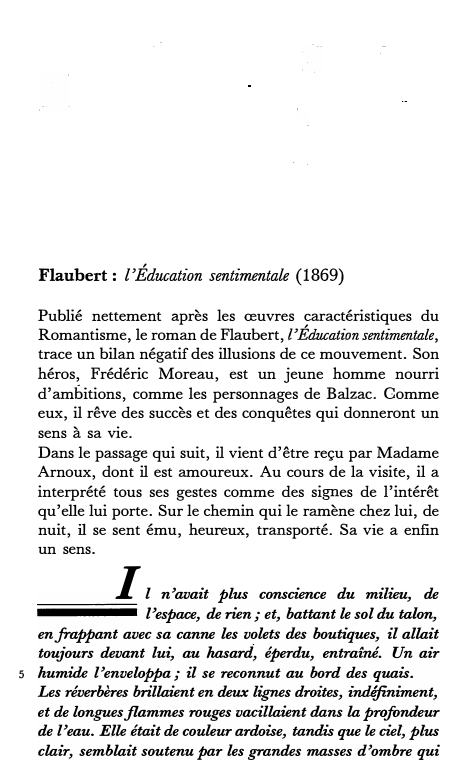Flaubert: ['Éducation sentimentale (1869) Publié nettement après les œuvres caractéristiques du Romantisme, le roman de Flaubert, !'Éducation sentimentale, trace un...
Extrait du document
«
Flaubert: ['Éducation sentimentale (1869)
Publié nettement après les œuvres caractéristiques du
Romantisme, le roman de Flaubert, !'Éducation sentimentale,
trace un bilan négatif des illusions de ce mouvement.
Son
héros, Frédéric Moreau, est un jeune homme nourri
d'ambitions, comme les personnages de Balzac.
Comme
eux, il rêve des succès et des conquêtes qui donneront un
sens à sa vie.
Dans le passage qui suit, il vient d'être reçu par Madame
Arnoux, dont il est amoureux.
Au cours de la visite, il a
interprété tous ses gestes comme des signes de l'intérêt
qu'elle lui porte.
Sur le chemin qui le ramène chez lui, de
nuit, il se sent ému, heureux, transporté.
Sa vie a enfin
un sens.
5
Il n'avait plus conscience du milieu, de
l'espace, de rien; et, battant le sol du talon,
en.frappant avec sa canne les volets des boutiques, il allait
toujours devant lui, au hasard, éperdu, entraîné.
Un air
humide l'enveloppa; il se reconnut au bord des quais.
Les réverbères brillaûnt en deux lignes droites, indéfiniment,
et de longuesflammes rouges vacillaûnt dans la profondeur
de l'eau.
Elle était de couleur ardoise, tandis que le ciel, plus
clair, semblait soutenu par les grandes masses d'ombre qui
se levaient de chaque côté du.fleuve.
Des édifi,ces, que l'on
n'apercevait pas, faisaient des redoublements d'obscurité.
Un
brouillard lumineux flottait au-delà, sur les toits ; tous les
bruits se fondaient en un seul bourdonnement; un vent léger
soufflait.
15 Il s'était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l'air.
Cependant, il sentait monter
dufond de lui-même quelque chose d'intarissable, un a.fflux
de tendresse qui l'énervait, comme le mouvement des ondes
sous ses yeux.
À [ 'horloge d'une église, une heure sonna, len20 tement, pareille à une voix qui l'eût appelé.
Alors, il.fut saisi par un de ces.frissons de l'âme où il vous
semble qu'on est transporté dans un monde supérieur.
Une
faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l'objet, lui était
venue.
Il se demanda, sérieusement, s'il serait un grand
25 peintre ou un grand poète; et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de
Mme Arnoux.
Il avait donc trouvé sa vocation ! Le but de
son existence était clair maintenant, et l'avenir infaillible.
10
Gustave Flaubert, ['Éducation sentimentale (1869), I, 4.
Idée directrice
Flaubert analyse les réactions et les états d'âme de son personnage de l'intérieur et à travers les relations de ce dernier avec son environnement.
Cette présentation évolue en
paragraphes successifs, ponctués par l'indication de perceptions qui marquent un retour à la réalité.
Alternativement passif et actif, subissant une très forte émotion, et
prenant conscience du réel, Frédéric est peu à peu métamorphosé.
L'étude du texte pourra s'attacher à la transformation du personnage à travers l'alternance des phases
d'émotivité et de lucidité et à son contact avec l'environnement.
56
PISTES DE LECTURE
A.
L'expression de l'émotivité
Le déroulement du texte nous montre un personnage(« il»)
en proie à une intense émotivité, mais évoluant dans le sens
d'une conscience progressive de ce qui se passe en lui.
On
remarque en effet le passage de l'inconscience totale(« Il
n'avait plus conscience», 1.
1) à une sensibilité exprimée
(« il sentait», 1.
16).
De l'inconscience à la lucidité, l'évolution se fait en plusieurs étapes.
• Première étape: l'état second (l.
1-1)
Le fait que le héros se trouve dans un état second est marqué par l'absence de conscience (1.
1).
Le groupe ternaire
(« du milieu, de l'espace, de rien») souligne, avec une
aggravation dans les termes, l'insensibilité totale dans
laquelle se trouve le personnage.
Cette idée est illustrée par
l'analogie avec un aveugle(« frappant avec sa canne», 1.
3);
elle est accentuée par l'emploi d'un participe et d'un adjectif
(«entraîné», «éperdu», 1.
4), soulignant la passivité de Frédéric, comme soumis à une force incontrôlable.
L'absence
de direction précise et le caractère aléatoire de la marche
(marqué par l'expression« au hasard», 1.
4) insistent sur
l'absence de maîtrise de soi et de réelle conscience.
• Deuxième étape: une sensibilité progressive (l.
16-19) ·
Elle est suggérée à partir de la ligne 16 par l'utilisation de
l'imparfait (soulignant une action progressive et qui dure)
et par le verbe «monter» qui marque également l'idée
d'une progression.
L'indication de l'origine du phénomène: « du fond», 1.
17), l'imprécision du terme « quelque chose», l'adjectif «intarissable» et le mot «afflux»
confirment l'idée d'un phénomène qui s'inscrit dans le
temps.
Sa durée permet au héros d'en faire l'analyse.
La
comparaison avec le mouvement de l'eau(« comme le mouvement des ondes», 1.
18) renforce encore cette notion de
durée.
Dans ce passage du texte, Flaubert nous fait part
57
d'un phénomène perçu de l'intérieur de son héros, mais
difficile à identifier.
• Troisième étape: l'identification du phénomène (l.
19-24)
Le phénomène dont la perception a été analysée dans les
lignes 16-19 est précisé par le mot« voix» (1.
20), qui suggère un appel venu d'ailleurs.
Une identification approximative de l'émotion se fait par l'utilisation du terme
«frissons» , qui reste cependant bien incertain: il s'agit
en effet de« frissons de l'âme»! La formulation vague« un
de ces» (1.
21), l'emploi du verbe« sembler»(« où il vous
semble qu'on est transporté») marquent à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓