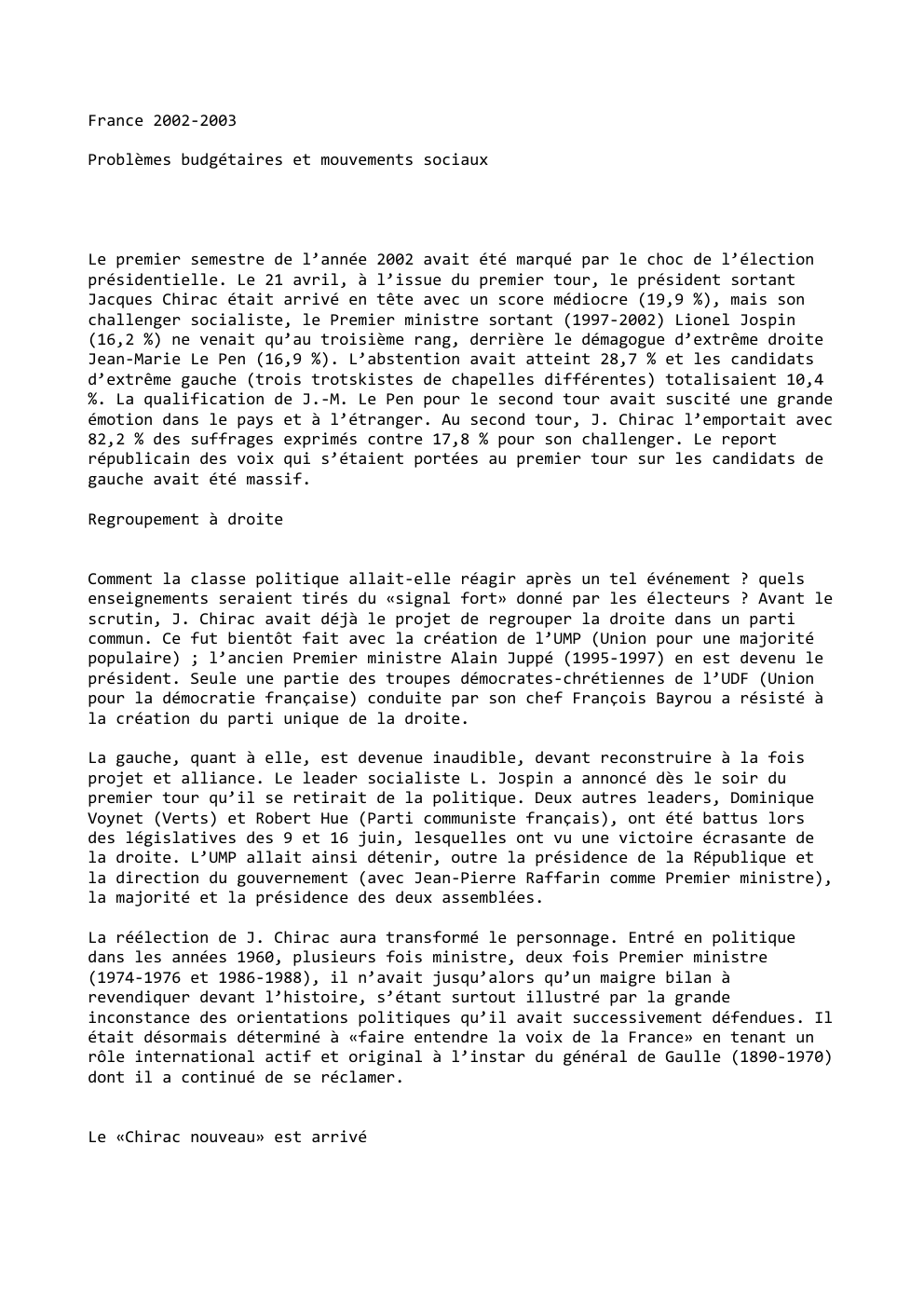France 2002-2003 Problèmes budgétaires et mouvements sociaux Le premier semestre de l’année 2002 avait été marqué par le choc de...
Extrait du document
«
France 2002-2003
Problèmes budgétaires et mouvements sociaux
Le premier semestre de l’année 2002 avait été marqué par le choc de l’élection
présidentielle.
Le 21 avril, à l’issue du premier tour, le président sortant
Jacques Chirac était arrivé en tête avec un score médiocre (19,9 %), mais son
challenger socialiste, le Premier ministre sortant (1997-2002) Lionel Jospin
(16,2 %) ne venait qu’au troisième rang, derrière le démagogue d’extrême droite
Jean-Marie Le Pen (16,9 %).
L’abstention avait atteint 28,7 % et les candidats
d’extrême gauche (trois trotskistes de chapelles différentes) totalisaient 10,4
%.
La qualification de J.-M.
Le Pen pour le second tour avait suscité une grande
émotion dans le pays et à l’étranger.
Au second tour, J.
Chirac l’emportait avec
82,2 % des suffrages exprimés contre 17,8 % pour son challenger.
Le report
républicain des voix qui s’étaient portées au premier tour sur les candidats de
gauche avait été massif.
Regroupement à droite
Comment la classe politique allait-elle réagir après un tel événement ? quels
enseignements seraient tirés du «signal fort» donné par les électeurs ? Avant le
scrutin, J.
Chirac avait déjà le projet de regrouper la droite dans un parti
commun.
Ce fut bientôt fait avec la création de l’UMP (Union pour une majorité
populaire) ; l’ancien Premier ministre Alain Juppé (1995-1997) en est devenu le
président.
Seule une partie des troupes démocrates-chrétiennes de l’UDF (Union
pour la démocratie française) conduite par son chef François Bayrou a résisté à
la création du parti unique de la droite.
La gauche, quant à elle, est devenue inaudible, devant reconstruire à la fois
projet et alliance.
Le leader socialiste L.
Jospin a annoncé dès le soir du
premier tour qu’il se retirait de la politique.
Deux autres leaders, Dominique
Voynet (Verts) et Robert Hue (Parti communiste français), ont été battus lors
des législatives des 9 et 16 juin, lesquelles ont vu une victoire écrasante de
la droite.
L’UMP allait ainsi détenir, outre la présidence de la République et
la direction du gouvernement (avec Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre),
la majorité et la présidence des deux assemblées.
La réélection de J.
Chirac aura transformé le personnage.
Entré en politique
dans les années 1960, plusieurs fois ministre, deux fois Premier ministre
(1974-1976 et 1986-1988), il n’avait jusqu’alors qu’un maigre bilan à
revendiquer devant l’histoire, s’étant surtout illustré par la grande
inconstance des orientations politiques qu’il avait successivement défendues.
Il
était désormais déterminé à «faire entendre la voix de la France» en tenant un
rôle international actif et original à l’instar du général de Gaulle (1890-1970)
dont il a continué de se réclamer.
Le «Chirac nouveau» est arrivé
Le «nouveau Chirac» s’est ainsi manifesté lors de la conférence des Nations
unies sur le développement durable tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) du 26
août au 4 septembre 2002.
Il y a prononcé un discours largement inspiré des
revendications des mouvements écologistes et des ONG (organisations non
gouvernementales), invoquant la responsabilité des États quant à l’avenir des
générations futures.
Nombreux sont ceux qui ont applaudi le propos, mais aussi
souligné son déphasage avec les actes politiques concrets d’un gouvernement dont
les premiers mois d’exercice ont semblé faire la part belle aux exigences des
lobbies industriels.
J.
Chirac s’est aussi illustré, avec un retentissement certain dans le monde, en
s’opposant à la guerre d’Irak voulue par l’administration Bush et soutenue par
le Royaume-Uni.
À cette occasion, la diplomatie française, dirigée par Dominique
de Villepin, s’est montrée très offensive, n’hésitant pas à s’opposer
frontalement au «grand allié».
La France n’entendait pas, en effet, accepter le
recours automatique à la force (c’est-à-dire à une «guerre préventive») que
défendaient les États-Unis.
Elle a ainsi pu considérer comme un succès la
formulation de la résolution 1441 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 8
novembre 2002, laquelle contraignait l’Irak à se plier à un régime d’inspection
rigoureux pour vérifier que le pays ne possédait plus d’armes de destruction
massive.
Elle a, dans ce cadre, agi de concert avec l’Allemagne et la Russie.
Le
10 février suivant, au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN), elle a exercé son droit de veto (avec l’Allemagne et la Belgique) afin
de s’opposer à la volonté des États-Unis d’utiliser les moyens de l’Alliance
pour protéger la Turquie dans la perspective d’un conflit avec l’Irak.
Ces postures diplomatiques ont cependant été critiquées pour le peu de cas
qu’elles ont fait des partenaires européens, non seulement le Royaume-Uni, mais
aussi les autres États membres de l’Union européenne et les États en cours
d'adhésion soutenant la position américaine.
Ceux-ci ont été qualifiés de «mal
élevés» et «un peu inconscients» par le président français.
Au plan intérieur, J.
Chirac a par ailleurs proclamé de grandes ambitions
concernant certains problèmes de santé publique comme la sécurité routière, le
tabagisme et le cancer.
Une politique libérale sans complexes
La politique menée par le gouvernement s’est inscrite dans les choix politiques
du candidat Chirac qui avait centré sa campagne sur les questions de sécurité.
Le budget a clairement donné priorité à la police, à l’armée et à la justice, au
détriment notamment de l’éducation et de la recherche.
Les contraintes
budgétaires se sont présentées sous un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓