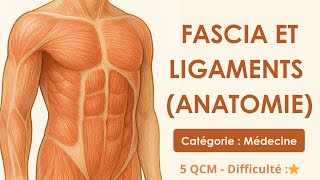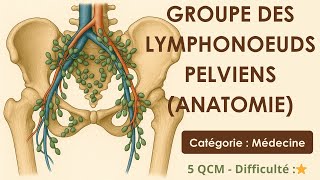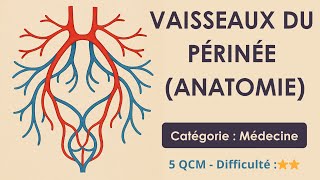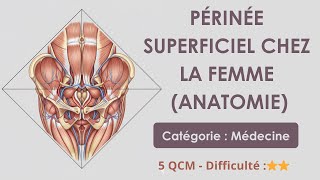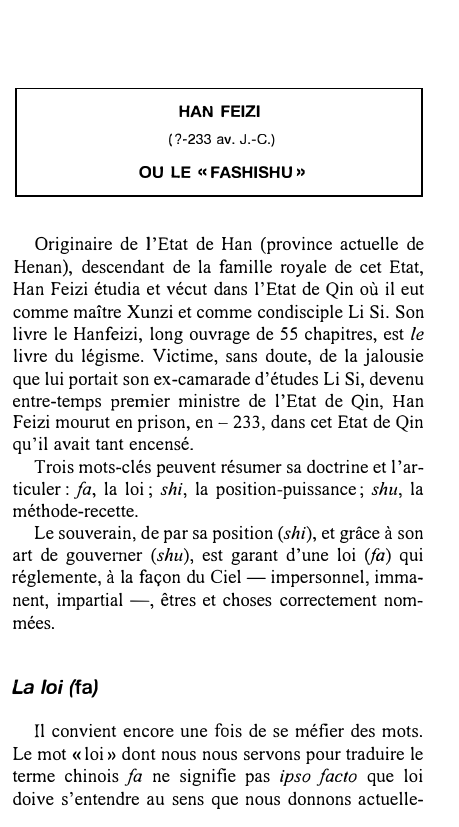HAN FEIZI ( ?-233 av. J.-C.) OU LE « FASHISHU » Originaire de l'Etat de Han (province actuelle de Henan),...
Extrait du document
«
HAN FEIZI
( ?-233 av.
J.-C.)
OU LE « FASHISHU »
Originaire de l'Etat de Han (province actuelle de
Henan), descendant de la famille royale de cet Etat,
Han Feizi étudia et vécut dans l'Etat de Qin où il eut
comme maître Xunzi et comme condisciple Li Si.
Son
livre le Hanfeizi, long ouvrage de 55 chapitres, est le
livre du légisme.
Victime, sans doute, de la jalousie
que lui portait son ex-camarade d'études Li Si, devenu
entre-temps premier ministre de l'Etat de Qin, Han
Feizi mourut en prison, en - 233, dans cet Etat de Qin
qu'il avait tant encensé.
Trois mots-clés peuvent résumer sa doctrine et l'ar
ticuler : fa, la loi ; shi, la position-puissance; shu, la
méthode-recette.
Le souverain, de par sa position (shi), et grâce à son
art de gouverner (shu), est garant d'une loi (fa) qui
réglemente, à la façon du Ciel - impersonnel, imma
nent, impartial -, êtres et choses correctement nom
mées.
La loi (fa)
Il convient encore une fois de se méfier des mots.
Le mot «loi» dont nous nous servons pour traduire le
terme chinois fa ne signifie pas ipso facto que loi
doive s'entendre au sens que nous donnons actuelle-
ment à ce mot, par exemple et au plus court, l'en
semble des droits et devoirs établis.
La loi au sens du légisrne signifie très précisément
et uniquement les devoirs auxquels sont soumis tous
les sujets.
« Une loi est ce qui est inscrit dans les registres, éta
bli dans les départements, et promulgué au peuple.
»
Devoirs objectifs, clairement définis, selon un barème
rigoureux de récompenses et de châtiments, de titres et
de mérites, comme de dégradations et démérites, et
dont le but immédiatement connu est de concourir à la
puissance conquérante de l'Etat et à la paix publique.
La nature de ce droit est de qualifier le délit- et d' ap
pliquer la peine qui y correspond
non de permettre
au juge d'apprécier la responsabilité du coupable et,
partant, la gravhé de son acte.
Un tel droit est par essence pénal, ce que restera
continûment le droit chinois, même «tempéré» par la
suite de circonstances atténuantes 1•
Quoi qu'il en soit, la loi a comme caractéristique
essentielle d'exiger la même obéissance de tous et
s'oppose de ce fait aux discriminations anciennes, liées
à la nature féodalo-familiale des anciennes principau
tés où non seulement il y avait séparation entre «gens
de condition» et «gens de commun», mais encore
gentleman agreement entre gens de qualité, apparentés
d'ailleurs si ce n'est par le sang au moins par la condi
tion, et non une quelconque application de la loi.
En
effet, comme l'exprimait un adage confucéen
1.
De ces atténuations ultérieures un bon exemple est le privi
lège accordé aux nobles ou aux hauts fonctionnaires, passibles de
mort à la suite d'un délit, de pouvoir se suicider au lieu de subir
une mise à mort infamante.
Rappelons que par droit pénal on
entend habituellement l'ensemble des règles de conduite imposées
aux « sujets» sous menace de peine.
« les rites (c.à.d.
le savoir-vivre, les convenances, le
gentleman agreement...) ne descendent pasjusqu'aux
gens du commun, la loi pénale (à laquelle était sou
mis seulement le peuple) ne monte pas jusqu'aux
nobles 1• »
La loi, du point de vue confucéen, ne s'adressait
qu'au peuple.
Elle avait quelque chose de vulgaire, de
brutal et de quasi infamant en soi.
Qu'ont-ils besoin de
lois ceux qui, tenus à coexister dans leur milieu, n'ont
d'autre issue, en cas de conflit, que de s'arranger
«noblement» sans perdre la face.
Qu'ont-ils besoin de
lois ceux que rites et vertus façonnent selon cette piété
filiale qui est l'alpha et l'oméga de leur discipline
même de vie?
C'est à ces rapports hiérarchiquement personnali
sés et moralisés que la loi légiste met «vulgairement»
fin.
Cette loi, par ailleurs, ne faisait que traduire dans
ses règlements l'ordre et l'ordonnancement des «dix
mille êtres» (tout le réel) auquel préside le Dao.
Car il y a dans le légisme aussi comme un aména
gement de conceptions diverses : taoïstes, moïstes,
«nominalistes» et même confucéennes.
En effet, le légisme emprunte au taoïsme son onto
logie immanentiste.
Les êtres et les choses suivent le
1.
Le seul moment réellement révolutionnaire de la pensée
confucianiste, de Confucius à Mengzi; a été de tenter faire admettre
et percevoir que les rites ne sont pas liés à une classe de prétendus
nobles, mais que n'importe ·qui s'anoblit à les respecter, fût-il de
basse extraction.
N'oublions pas non plus que dans la Chine en
crise des «Printemps et Automnes» et des « Royaumes combat
tants» certains nobles ayant perdu fonction, titre et statut social
étaient en quelque sorte reconduits à un état «peuple», dont leur
éducation même les différenciait.
Guère nobles selon le rang, ils
l'étaient toujours selon le cœur et le maintien.
336 /
La philosophie chinoise
cours même du Dao, dans son flux productif et changeant.
La loi ne fait en somme que s'adosser au Dao
qui la pousse dans le sens du courant qu'il manifeste.
La société humaine par l'intermédiaire de la loi
efficace ordonne l'univers comme si tel était le
«désir» immanent du Dao, de la Voie.
L'homme
par sa parole, par le dit de la loi-devoir ne fait que
connaître et prendre petitement conscience de ce que
le Dao fait sans parole et sans intervention.
Mais
contrairement aux taoïstes qui, à l'imitation du Dao
non parlant et non intervenant - car son silence est
plus parlant que toute parole, comme son activité plus
agissante que toute intervention - se méfiaient de
toute parole et de tout règlement comme de toute
intervention, les légistes, eux, estimaient, par la loi et
les devoirs prescrits, expliciter le rôle de l'homme, à
lui dévolu par le Dao, comme si l'efficace du Dao se
pouvait exprimer dans la loi.
Du moïsme, le légisme retient son insistance sur
l'utile, le profitable, l'intérêt, mais pas du tout son
Ciel justicier et (presque) personnalisé, ni son caractère de secte religieuse moralisante.
Des nominalistes, le légisme capte la science des
noms, les désignations correctes, l'univocité terminologique, mais non ses tendances sophistiques ou son
recours à des arguments qu'il juge fallacieux parce que
paradoxaux, c'est dire autrement inutiles et irrationnels.
Du confucianisme même il conservera la polarisation de l'univers sur la personne du souverain en tant
que garant de l'ordre universel.
Mais alors que le souverain confucéen fait rayonner la loi morale qui baigne
tout dans l'humanisme de la bienveillance et de la
bienséance, le souverain légiste est le tenant-lieu de
l'impersonnalité et de l'impartialité même de la loi.
Despote, si on veut, et c'est ce que ne manqueront pas
de dire pour des raisons diverses confucéens et taoïstes
réunis, mais non de la pire espèce puisque soumis à la
loi même dont il est l'absolu garant.
Du moins en théo
rie, puisque les justifications théoriques n'enlèvent
rien à l'absoluité du pouvoir, fût-il déclaré non arbi
traire.
N'empêche qu'à tenir égaux les deux plateaux
de la balance récompenses / châtiments sans faire
entrer en ligne de compte ni ses attachements, goûts,
préférences ou la qualité des personnes, le souverain
légiste se conduit plus en serviteur de la loi qu'en
«despote oriental» selon l'imagerie convenue.
C'est la
loi qui est cruelle, non le souverain.
En un mot la loi légiste est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓