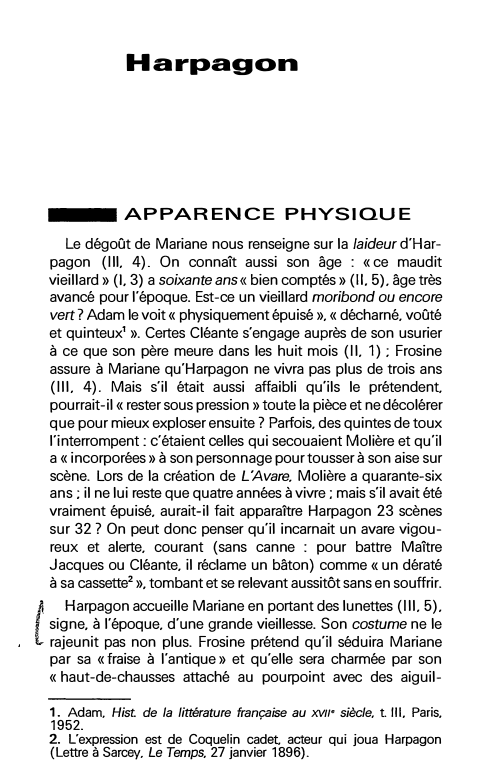Harpagon APPARENCE PHYSIQUE l Le dégoût de Mariane nous renseigne sur la /aideurd'Har pagon (Ill. 4). On connaît aussi son...
Extrait du document
«
Harpagon
APPARENCE PHYSIQUE
l
Le dégoût de Mariane nous renseigne sur la /aideurd'Har
pagon (Ill.
4).
On connaît aussi son âge : « ce maudit
vieillard» (1.
3) a soixante ans« bien comptés» (IL 5).
âge très
avancé pour l'époque.
Est-ce un vieillard moribond ou encore
vert? Adam le voit« physiquement épuisé».« décharné.
voûté
et quinteux1 ».
Certes Cléante s'engage auprès de son usurier
à ce que son père meure dans les huit mois (Il.
1); Frosine
assure à Mariane qu'Harpagon ne vivra pas plus de trois ans
(Ill.
4).
Mais s'il était aussi affaibli qu'ils le prétendent.
pourrait-il« rester sous pression» toute la pièce et ne décolérer
que pour mieux exploser ensuite? Parfois.
des quintes de toux
lïnterrompent: c'étaient celles qui secouaient Molière et quïl
a « incorporées» à son personnage pour tousser à son aise sur
scène.
Lors de la création de L'Avare.
Molière a quarante-six
ans ; il ne lui reste que quatre années à vivre ; mais sïl avait été
vraiment épuisé.
aurait-il fait apparaître Harpagon 23 scènes
sur 32? On peut donc penser quïl incarnait un avare vigou
reux et alerte.
courant (sans canne : pour battre Maître
Jacques ou Cléante.
il réclame un bâton) comme« un dératé
à sa cassette2».
tombant et se relevant aussitôt sans en souffrir.
Harpagon accueille Mariane en portant des lunettes (Ill.
5).
signe.
à l'époque.
d'une grande vieillesse.
Son costume ne le
rajeunit pas non plus.
Frosine prétend quïl séduira Mariane
par sa « fraise à l'antique» et qu'elle sera charmée par son
« haut-de-chausses attaché au pourpoint avec des aiguil1.
Adam.
Hist de la littérature française au xv11• siècle.
t.
Ill.
Paris.
1952.
2.
L'expression est de Coquelin cadet acteur qui joua Harpagon
(Lettre à Sarcey, Le Temps.
27 janvier 1896).
lettes » (Il.
5).
Harpagon suit encore une mode.
celle du temps
d'Henri IV.
vieille de cinquante ans.
Il y a fort à parier qu'il
porte un costume de son propre père.
à moins qu'il ne le tire
de « l"ample magasin de hardes» dont La Flèche le croit
propriétaire (Il.
4).
Voici.
d'après l'inventaire fait à la mort de
Molière.
le costume d'Harpagon : «un manteau.
chausses et
pourpoint de satin noir.
garni de dentelle ronde de soie noire.
chapeau.
perruque.
souliers ».
La.
tenue.
bien que passée de
mode.
est décente : Harpagon est un riche bourgeois.
il a une
haute idée de sa position sociale et malgré son avarice.
se voit
obligé de garder des éléments de train de maison : carrosse
(branlant}.
chevaux (affamés).
domestiques (mais si peu
nombreux) en livrée (trouée et tachée}.
LE CARACTÈRE
D'HARPAGON
Un vieil avare amoureux - Pantalon ou le Baron - apparaît
fréquemment dans lacommedia dell'arte.
Molière s'en est
souvenu pour son Harpagon.
mais en enrichissant considérablement les données sommaires de la comédie italienne.
Cet
enrichissement a souvent été critiqué et l'on a dit que Molière
avait créé un personnage abstrait ou invraisemblable.
L'habitude d'étudier séparément en Harpagon.
l'avare.
le père et
l'amoureux confirme qu·on a renoncé à trouver dans le
personnage une unité.
une cohérence.
Or il suffit pour comprendre Harpagon.
de s'en remettre au
titre de la pièce.
L:.4.vare.
mais sans laisser à ce mot son sens
étroit du francais : «Avare: personruLqui a beaucoup d'argent
.
~
-· qui amasse et garde toutce qu'elle a» (Petit Robert).
Le mot
latin avàrîtia-noosrênsé1griè ~rméux-: il désigne un vif désir_ de
consewèi:mais surtout d'acquérirto!:liours_gl!J.S.
Cette.mtidité
nèse limite pàSà la convoitise des ri~es.
mais s•étêriaà
tout ce qui peut donner à l'avare l'impression d"exister davantage.
Harpagon est dévoré par cette avarice totale dont son
nëfrn" même rend compte: H~c'esten latin,_le croc~.
le grappin qui sert à prendre et à r~r.
C'est une forme
extrême.
monstrUèuse dece que La Rochefoucauld appelle
«l'amour-propre» et qu'il définit comme un attachement
excfÛSif à sa -propre personne.
à sa conversati~son
--
développement : « amour de soi et de toutes les choses pour
s~i ~>- Che~,.tJ~~~p_aq_o~.:- l'a':1~u!-_~.:.?.Er;..P!~!1~~~ forme d'~n
des1r de vivre mtensement a travers I or.
1amour.
et le plein
exërëlëêêiësësêfroits ctê maîîrë'et de-pèré_-· .
' .---
L'or et l'instinct de conservation
On entend par instinct de èonservation le désir naturel de
maintenir intacte sa prop!'ë-personne.-Pîûs ·Harpagon vieillit.
plus cette volonté se déveÎoppeenlui jusqu'aâi:îsôr'ber toute
son~énèrgîe:1râ-têïiement-vécu pour préserver eiacërêiître sa
fortune que.
désormais.
il s'est identifié à ses écus.
Son argent
représente pour lui bien plus qu'un « cher ami».
un « support».
une «consolation» : c'est une véritable substance
vitale.
son« sang».
ses« entrailles» (IV.
7).
Pour ce vieillard,
conserver sa vie.
conserver son or.
cela revient au même.
et sa
( ~:~~;:;:.~6:~;t~~:o~i~parition
Mais il ne rui suffit pasê:lêëôiisèrver intacte sa fortune: l'or
ne doit~,mir dans la terre d'un sommeil qui ressemblêrait
vit;rîa mort.C'est
tiâsarctqÛ'une si grosse s&nmè est
enfouiedans son jardin (L 4).
et dès qu'il le pourra.
il la fera
fructifier par l'usure: davantage
d'or.
davantage de vie! Les
~ ~ ~ _ .
.
.
•.,....,,...-.-r:-._::-.;;:,~
chiffres comptent tant dans son existence qu Harpagon semble parfois transformé en une véritable calculatrice humaine.
si
grande est sa virtuosité pour jongler avec les taux d'intérêt (1.
4).
Mais Harpagon a bien d'autres façons de retenir la vie.
par
Avarice et amour
'
Loin d'être invraisemblables.
les projets de mariage d'Harpagon sont des manifestations de l'instinct de conservation
qui l'anime.
Les vieTiri:ii'ëts-amôm-eux ·cre~îëufiësfilles.
qui
paraissent souvent dans la littérature.
correspondent à une
réalité : la vieillesse se tourne vers la jeunesse.
fraîche et
vigoureuse.
comme pôür' en-âosôroêfTà 'fôrëën~f se protéger
par Ïàd8 la mort.
C'ès1:· 1-e··5üfcf'Hàrpagôn quanO il pense
épouserîvîâriârte: elle ne lui apporte pas beaucoup d'argent.
mais une dot bien plus précieuse.
sa jeunesse.
sa grâce - la
meilleurë"desë'ùrës ~d87ouvenCêï)OiJrcetOgre vfeillissant
« Son maintien honnête et sa douceurm'ont gagné l'âme».
confie-t-il (1, 4) : il apprécie et recherche en elle les qualités
dont il est le plus dépourvu.
Cependant, lorsque Cléante
l'oblige à choisir entre sa « chère cassette» et Mariane.
il
renonce à sa fiancée et revient à ses anciennes amours: c'est}
une véritable lune de miel qu'il commence avec son argent.
paré des charmes d'un objet perdu et retrouvé (V.
6).
,
Un vieillard plein d'énergie
Harpagon.
par conviction et aussi pour se rassurer.
aime se
présenter comme indestructible.
Il est fier de ses soixante ans.
et Frosine, qui l'a compris.
le flattesw.-ce point (Il, 5).
IÏ faut
voir Harpagon se rengorger....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓