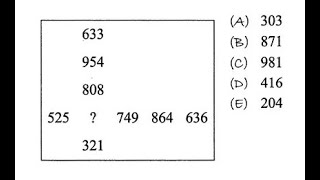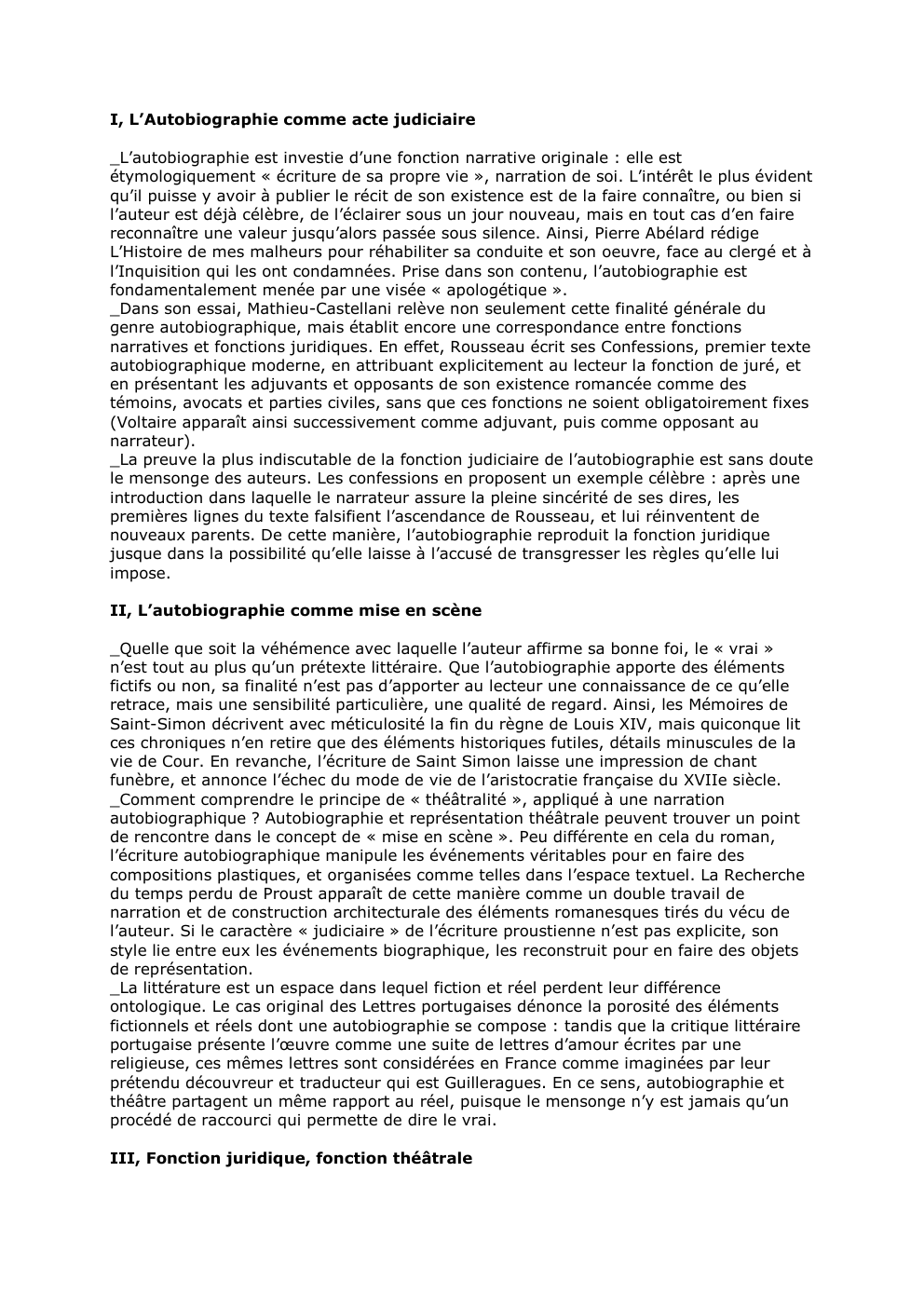I, L’Autobiographie comme acte judiciaire _L’autobiographie est investie d’une fonction narrative originale : elle est étymologiquement « écriture de sa...
Extrait du document
«
I, L’Autobiographie comme acte judiciaire
_L’autobiographie est investie d’une fonction narrative originale : elle est
étymologiquement « écriture de sa propre vie », narration de soi.
L’intérêt le plus évident
qu’il puisse y avoir à publier le récit de son existence est de la faire connaître, ou bien si
l’auteur est déjà célèbre, de l’éclairer sous un jour nouveau, mais en tout cas d’en faire
reconnaître une valeur jusqu’alors passée sous silence.
Ainsi, Pierre Abélard rédige
L’Histoire de mes malheurs pour réhabiliter sa conduite et son oeuvre, face au clergé et à
l’Inquisition qui les ont condamnées.
Prise dans son contenu, l’autobiographie est
fondamentalement menée par une visée « apologétique ».
_Dans son essai, Mathieu-Castellani relève non seulement cette finalité générale du
genre autobiographique, mais établit encore une correspondance entre fonctions
narratives et fonctions juridiques.
En effet, Rousseau écrit ses Confessions, premier texte
autobiographique moderne, en attribuant explicitement au lecteur la fonction de juré, et
en présentant les adjuvants et opposants de son existence romancée comme des
témoins, avocats et parties civiles, sans que ces fonctions ne soient obligatoirement fixes
(Voltaire apparaît ainsi successivement comme adjuvant, puis comme opposant au
narrateur).
_La preuve la plus indiscutable de la fonction judiciaire de l’autobiographie est sans doute
le mensonge des auteurs.
Les confessions en proposent un exemple célèbre : après une
introduction dans laquelle le narrateur assure la pleine sincérité de ses dires, les
premières lignes du texte falsifient l’ascendance de Rousseau, et lui réinventent de
nouveaux parents.
De cette manière, l’autobiographie reproduit la fonction juridique
jusque dans la possibilité qu’elle laisse à l’accusé de transgresser les règles qu’elle lui
impose.
II, L’autobiographie comme mise en scène
_Quelle que soit la véhémence avec laquelle l’auteur affirme sa bonne foi, le « vrai »
n’est tout au plus qu’un prétexte littéraire.
Que l’autobiographie apporte des éléments
fictifs ou non, sa finalité n’est pas d’apporter au lecteur une connaissance de ce qu’elle
retrace, mais une sensibilité particulière, une qualité de regard.
Ainsi, les Mémoires de
Saint-Simon décrivent avec méticulosité la fin du règne de Louis XIV, mais quiconque lit
ces chroniques n’en retire que des éléments historiques futiles, détails minuscules de la
vie de Cour.
En revanche, l’écriture de Saint Simon laisse une impression de chant
funèbre, et annonce l’échec du mode de vie de l’aristocratie française du XVIIe siècle.
_Comment comprendre le principe de « théâtralité », appliqué à une narration
autobiographique ? Autobiographie et représentation théâtrale peuvent trouver un point
de rencontre dans le concept de « mise en scène ».
Peu différente en cela du roman,
l’écriture autobiographique manipule les événements véritables pour en faire des
compositions plastiques, et organisées comme telles dans l’espace textuel.
La Recherche
du temps perdu de Proust apparaît de cette manière comme un double travail de
narration et de construction architecturale des éléments romanesques tirés du vécu de
l’auteur.
Si le caractère « judiciaire » de l’écriture proustienne n’est pas explicite, son
style lie entre eux les événements biographique, les reconstruit pour en faire des objets
de représentation.
_La littérature est un espace dans lequel fiction et réel perdent leur différence
ontologique.
Le cas original des Lettres portugaises dénonce la porosité des éléments
fictionnels et réels dont une autobiographie se compose : tandis que la critique littéraire
portugaise présente l’œuvre comme une suite de lettres d’amour écrites par une
religieuse, ces mêmes lettres sont considérées en France comme imaginées par leur
prétendu découvreur et traducteur qui est Guilleragues.
En ce sens, autobiographie et
théâtre partagent un même rapport au réel, puisque le mensonge n’y est jamais qu’un
procédé....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓