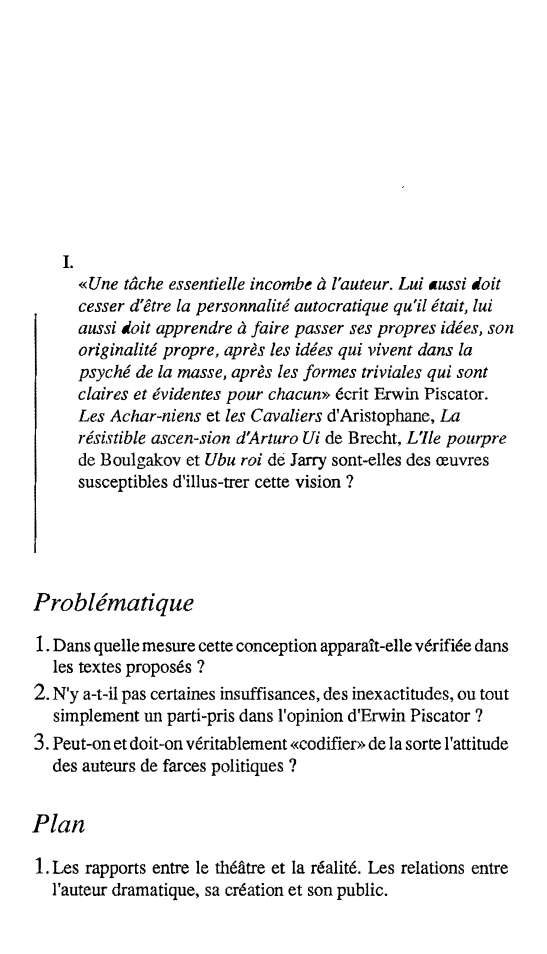I. «Une tâche essentielle incombe à l'auteur. Lui aussi doit cesser d'it re la personnalité autocratique qu'il était, lui aussi...
Extrait du document
«
I.
«Une tâche essentielle incombe à l'auteur.
Lui aussi doit
cesser d'it re la personnalité autocratique qu'il était, lui
aussi doit apprendre à faire passer ses propres idées, son
originalité propre, après les idées qui vivent dans la
psyché de la masse, après les formes triviales qui sont
claires et évidentes pour chacun» écrit Erwin Piscator.
Les Acharniens et les Cavaliers d'Aristophane.
La
résistible ascension d'Arturo Ui de Brecht, L'ile pourpre
de Boulgakov et Ubu roi dé Jarry sont-elles des œuvres
susceptibles d'illustrer cette vision ?
Problématique
1.
Dans quelle mesure cette conception apparaît-elle vérifiée dans
les textes proposés ?
2.
N'y a-t-il pas certaines insuffisances, des inexactitudes.
ou tout
simplement un parti-pris dans l'opinion d'Erwin Piscator?
3.
Peut-on et doit-on véritablement «codifier» de la sorte l'attitude
des auteurs de farces politiques ?
Plan
1.
Les rapports entre le théâtre et la réalité.
Les relations entre
l'auteur dramatique, sa création et son public.
Applications partielles
143
A.
L'auteur est inscrit dans une situation historique, sociale et
politique précise.
B.
Dans la perspective d'Erwin Piscator, !'écrivain doit se livrer
à trois choix successifs pour que son écriture porte le mieux
possible : la forme du message, «les idées qui vivent dans la
psyché de la masse ...
et ...
les formes triviales ...
claires et
évidentes pour chacun», la manière dont son originalité
propre va venir se greffer sur ce qui précède.
c.
C'est la farce, mettant en scène «une situation plaisante empruntée à la vie ordinaire» qui permet le passage entre «les
idées de la psyché», «les formes triviales» et les «propres
idées de l'auteur».
D.
Le théâtre est centré sur le public également dans la mesure
où le personnage de fiction opprimé s'identifie au spectateur,
qui ainsi par contrecoup effectue un mouvement réciproque.
2.
Cependant la pensée d'Erwin Piscator ne semble pas rendre
compte de la pratique théâtrale des œuvres proposées.
De fait,
en y regardant de plus près, on pourrait considérer à certains
égards que son raisonnement est incomplet, inexact, voire
partisan.
A.
Les «idées de la psyché» ne peuvent jamais être objectives.
B.
De plus, partir, comme le préconise Erwin Piscator, des
formes de pensée et des représentations propres au public,
n'est-ce pas en fait une manière de sous-estimer les capacités
de ceux auxquels on s'adresse ?
c.
Dans les rapports entre la fiction de la pièce et le réel auquel
elle renvoie, le fictif peut être débordé par le réel, ou le réel
donné expressément comme tel.
Quand c'est le cas, l'auteur
intervient personnellement.
D.
Cette autocratie revient en fait à une visée didactique de la
part du dramaturge.
Le didactisme ne revêt aucun caractère
pesant du fait du comique et de la rapidité de l'action.
3.Alors, quelle doit être l'attitude de l'auteur dramatique? En effet,
s'il part du public, il n'est pas sûr que le spectateur parvienne à
sa pensée en dépassant la farce; inversement s'il part unique-
La dissertation littéraire .
144
ment de sa propre personnalité, il n'est pas certain non plus que
le spectateur accepte de le suivre.
A.
Pour faire fonctionner sa pièce comme une démonstration, il
semble donc que le dramaturge doive nécessairement jouer
d'un savant dosage.
B.
Le théâtre n'est pas donné comme un simple lieu de divertissement, mais comme le lieu même du réel.
Il reflète le réel et
le réel doit le prolonger, puisque la pièce est un appel à
l'action.
c.
On note dans ce cadre l'omniprésence implicite de la relation
à la politique et aux politiciens.
D.
Chaque créateur comme chaque critique possède son tempé-
rament.
En outre le chef-d'œuvre est impossible à codifier.
Plan détaillé du développement
1.
Quels sont les rapports entre le théâtre et la réalité, quelles sont
les relations entre l'auteur dramatique, sa création et son public?
Il semble nécessaire avant tout de bien se figurer que l'auteur
est inscrit dans une situation historique, sociale et politique
précise.
Notes à rédiger: - Aristophane: citoyen athénien révolté contre les
ravages de la guerre prolongée par les gouvernants dans des visées lucratives, et la démagogie
sous toutes ses formes dont le peuple athénien est
la victime.
- Pièce de Brecht écrite en 1941, en pleine ascension hitlérienne par un marxiste en exil.
Boulgakov met en scène un auteur dramatique,
une troupe et son directeur dans les années 1920
en Union Soviétique, au moment où les théâtres
sont soumis à la censure.
Il montre l'influence de
l'histoire et de la politique sur le métier même
d'auteur dramatique et la représentation théâtrale.
Boulgakov a connu dans son pays une
longue période de silence et son existence ne fut
guère aisée ...
A.
Applications partielles
145
- Malgré le désengagement de Jarry, Ubu est une
féroce caricature du bourgeois égoïste et stupide,
lâche et avide, qui peut symboliser la classe au
pouvoir dans les années 1890, dans sa volonté
d'accaparement.
Quoi qu'il en soit, donc, !'écrivain apparaît confronté à une
situation en fonction de laquelle, étant donné son regard pénétrant
et sa position personnelle, il ne peut être neutre mais engagé
politiquement.
De là naît en lui le désir de transmettre un message
politique dont le contenu correspondra au sens de son engagement.
Ce sens ressort d'une analyse qui se veut lucide et utilitaire
pour le citoyen et l'État lui-même.
Brecht l'atteste: «L'homme de
théâtre n'a pas à chercher ses leçons auprès de l'État.
L'État au
contraire peut apprendre du dramaturge» ...
B.
Dans la perspective d'Erwin Piscator, l'écrivain doit se livrer
à trois choix successifs pour que son écriture porte le mieux
possible : la fonne du message, «les idées qui vivent dans la
psyché de la masse ...
et ...
les fonnes triviales ...
claires et
évidentes pour chacun», la manière dont son originalité
propre va venir se greffer sur ce qui précède.
La fonne théâtrale semble la meilleure pour faire passer le
message.
Les quatre auteurs y ont souscrit.
Pour quelles raisons ?
Notes à rédiger : - Le théâtre s'adresse généralement au plus grand
nombre.
On veut le convaincre.
Aristophane
s'adresse aux paysans : les victimes.
Brecht au
peuple allemand, au prolétariat, aux peuples
bernés ou intimidés par le nazisme, et au peuple
américain pour le faire intervenir.
Le message théâtral est direct, immédiat, mais
aussi complet et ininterrompu.
- De plus, il est plus concret et plus vivant (imprégnation de certaines scènes dans l'esprit du
public).
- La résonance est plus grande, car on crée un jeu
de miroirs.
Cependant, pour que la transmission du message politique se
fasse dans de bonnes conditions, le dramaturge doit se rapprocher
de la structure mentale du public et adopter ses fonnes de pensée
146
La dissertation littéraire
et ses formes privilégiées.
Ainsi le spectateur devient le véritable
centre de la création.
Notes à rédiger : - Les idées simples susceptibles d'emporter l'adhésion du spectateur se situent à deux niveaux, celui
des passions et du corps, celui de l'éthique.
On
peut donc citer : l'instinct de conservation, la
liberté, la justice ...
Ces idées sont en quelque sorte instinctives.
Elles
provoquent un mouvement automatique de pulsion suivi d'une réaction, même si elles semblent
en sommeil.
C'est ce mouvement humain fondamental que le dramaturge doit faire renaître en
créant sur scène des manifestations qui impliquent exactement le contraire de la référence
instinctive immanente, c'est-à-dire un monde à
l'envers souvent angoissant.
Dans les Acharniens, ex : la scène des ambassadeurs qui non seulement n'ont pas rempli leur
mission honnêtement, mais en plus affabulent
aux frais des Athéniens.
De plus, on intime le
silence à Dicéopolis, qui les dénonce, précisément dans le lieu où s'exerce la démocratie ...
- Dans L'Ile pourpre, ex : le cassant «Interdiction
de représenter» de Sava Loukitch atteste à la fois
son autoritarisme et son injustice puisqu'il réduit
les comédiens au chômage.
- Chez Brecht, la paroleestrégentée par la tyrannie
des gangsters.
Chez Jarry, Ubu aux paysans
indigents : «Je m'en fiche.
Payez».
Le point
culminant de la trahison des idées instinctives : le
meurtre, est atteint chez ces deux derniers auteurs.
Mais cela ne suffit pas, c'est pourquoi ces idées fondamentales
sont mises en évidence par une fonne de représentation tout à fait
transparente et familière pour le grand public.
Notes à rédiger : un comique simple: les insultes (Les Cavaliers,
Ubu roi) ; les coups (Ubu marionnette fidèle à la
tradition du guignol).
Fonction : la décrispation.
- Lareprésentation de la réalité quotidienne: Brecht
utilise des noms très proches de ceux de leurs
modèles réels de l'actualité ; il décrit les États-
Applications partielles
147
Unis de l'après première guerre mondiale et en
particulier une ville très agitée Chicago.
Rappel
d'un problème grave qui se pose au public au
moment où il regarde la pièce : les références au
révolver et àla mitraillettepourrefléter les moyens
de l'expansion militaire nazie.
Emploi du langage quotidien : les interjections
des personnages chez Aristophane, les hésitations de la langue parlée chez Boulgakov, le
langage argotique imagé chez Brecht, la scatologie même déformée chez Jarry: «Merdre».
- La clarté même des situations et des personnages.
L'intrigue progresse toujours à partir d'un
personnage central.
Dicéopolis, Ubu, Ui sont
presque toujours en scène ; même si Sava Loukitch n'apparaît, qu'au troisième acte de la pièce
de Dymogasky, son absence est donnée dès le
début comme une présence encore plus terrible.
De plus, le visage d'Ubu apparaît encore plus typé
dans la trivialité par l'usage du masque.
Enfin,
même s'ils ont des modèles vivants, les personnages sont réduits à quelques traits principaux.
- L'effet visuel : disputes continuelles, donc animation de la vie dans les Cavaliers, attaques et
contre-attaques éclair dynamiquement suggérées
par Jarry, constant jeu de lumières dans la scène
du procès chez Brecht, qui efface les maillons
susceptibles de ralentir le mouvement.
Animation progressive du théâtre chez Boulgakov.
c.
C'est la farce, définie par H.
Bénac comme mettant en scène
«une situation plaisante empruntée à la vie ordinaire» qui
·permet le passage entre «les idées de la psyché», les «formes
triviales« et les «propres idées de l'auteur».
Erwin Piscator
insiste sur le fait que les idées du dramaturge ne doivent pas
primer, mais s'insérer dans un schéma préexistant déterminé
par le public, c'est ce qu'il exprime par le terme le plus
important de son raisonnement : «après», qui renvoie à
l'abolition de l'autocratie de l'auteur dramatique.
La farce
revêt deux formes principales : le grossissement outrancier
ou caricature et le rabaissement.
A l'aide de ces deux procédés on montre plus clairement à la conscience du spectateur
La dissertation littéraire
148
que ses valeurs traditionnelles sont bafouées par ceux qui détiennent le pouvoir.
Notes à rédiger :
D.
L'outrance : dans Les Acharniens, d'abord l'invraisemblance des propos des ambassadeurs
suscite le rire, mais ensuite la reprise de Dicéopolis, par le décalage qu'elle introduit, provoque
l'indignation.
Même si l'outrance contribue à
truquer la réalité dans une certaine mesure, elle
n'en suggère pas moins une réalité profonde.
Dans L1le pourpre, Sava Loukitch institue à la
fois l'obligation d'une révolution prolétarienne
internationale et d'un décalque avec le rôle joué
par les marins dans la révolution soviétique.
Malgré la déformation, «l'intoxication idéologique» est suggérée.
Chez Brecht et Jarry, parodies
de procès et terreur institutionnalisée.
- Le rabaissement sous toutes ses formes : chez
Brecht l'Allemagne devient Chicago, lieu du
racket, du meurtre, de la prostitution.
Aristophane rabaisse systématiquement toutes les causes de guerre pour mieux prendre à parti les
personnages officiels qui excitent les athéniens
contre leurs ennemis.
Volonté de rendre les personnages farcesques :
Ui adopte des attitudes mécaniques et Brecht
montre qu'une certaine politique est l'art de feindre.
On se rapproche du spectateur en rendant les
personnages vulnérables, en les faisant tomber
de leur piédestal.
Le théâtre est centré sur le public également dans la mesure
où le personnage de fiction opprimé s'identifie au spectateur,
qui ainsi par contrecoup effectue un mouvement réciproque.
Notes à rédiger:
Dicéopolis utilise la première personne du pluriel.
- Le public partage le désespoir de Dymogasky.
Boulgakov donne au spectateur la possibilité de
devenir un acteur de sa pièce.
Tout est théâtre.
L'ile pourpre contient deux
pièces distinctes et la salle est une troisième
scène.
- Identification pathétique chez Brecht dans l'épi-
i
f
149
Applications partielles
sode de la femme ensanglantée: «et tous acceptent ça / Et nous en crevons tous !»
- Dans Ubu roi, le public a l'impression que devant
ses yeux se déroulent pour son plaisir des saynettes farcesques auxquelles il pourrait participer.
1
'
'
r
i
Un tel théâtre assume deux fonctions principales : une fonction
éthique dans la mesure où la subjectivité del 'auteur dramatique se
porte entièrement vers celle du spectateur, amorçant un mouvement d'universalité ; une fonction sociale dans la mesure où grâce
au respect du spectateur, le dramaturge peutle divertir et l'intéresser à la fois, sans l'aliéner parce qu'il crée un regard collectif, un
regard avec ...
Transition: Mais ce regard collectif, aboutissement de la pensée
d'Erwin Piscator rend-il compte de la pratique théâtrale des
œuvres proposées ? En effet, la conception énoncée n'est-elle
pas réductrice, puisqu'elle procède en définitive de présupposés
subjectifs et d'une idée préconçue du public.
L'auteur dramatique peut-il et doit-il véritablement abandonner toute forme
d'autocratie?
*
2.
De fait, en y regardant de plus près, on pourrait considérer à
certains égards que le raisonnement d'Erwin Piscator est incomplet, inexact, voire partisan.
A.
Tout d'abord, rien n'est évident au sujet des valeurs.
Les
«idées de la psyché» n'existent pas en tant que telles : la subjectivité doit agir pour les déduire de telle ou telle situation,
ce qui implique qu'un choix préexiste à la norme.
Ainsi ces
valeurs....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓