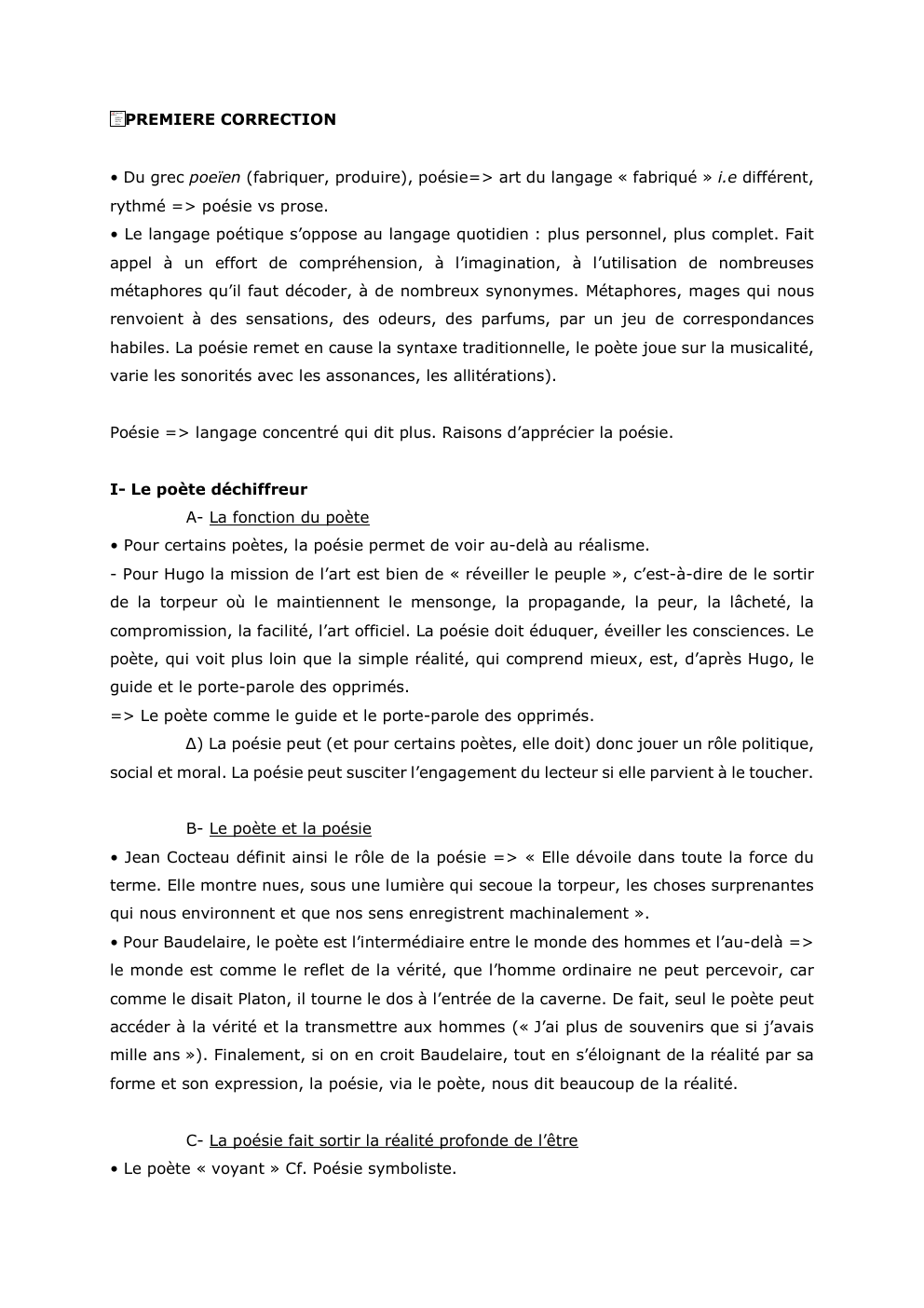Impossib le d'afficher l'image liée. Le fichier PREMIERE CORRECTION • Du grec poeïen (fabriquer, produire), poésie=> art du langage «...
Extrait du document
«
Impossib
le
d'afficher
l'image
liée.
Le
fichier
PREMIERE CORRECTION
• Du grec poeïen (fabriquer, produire), poésie=> art du langage « fabriqué » i.e différent,
rythmé => poésie vs prose.
• Le langage poétique s’oppose au langage quotidien : plus personnel, plus complet.
Fait
appel à un effort de compréhension, à l’imagination, à l’utilisation de nombreuses
métaphores qu’il faut décoder, à de nombreux synonymes.
Métaphores, mages qui nous
renvoient à des sensations, des odeurs, des parfums, par un jeu de correspondances
habiles.
La poésie remet en cause la syntaxe traditionnelle, le poète joue sur la musicalité,
varie les sonorités avec les assonances, les allitérations).
Poésie => langage concentré qui dit plus.
Raisons d’apprécier la poésie.
I- Le poète déchiffreur
A- La fonction du poète
• Pour certains poètes, la poésie permet de voir au-delà au réalisme.
- Pour Hugo la mission de l’art est bien de « réveiller le peuple », c’est-à-dire de le sortir
de la torpeur où le maintiennent le mensonge, la propagande, la peur, la lâcheté, la
compromission, la facilité, l’art officiel.
La poésie doit éduquer, éveiller les consciences.
Le
poète, qui voit plus loin que la simple réalité, qui comprend mieux, est, d’après Hugo, le
guide et le porte-parole des opprimés.
=> Le poète comme le guide et le porte-parole des opprimés.
∆) La poésie peut (et pour certains poètes, elle doit) donc jouer un rôle politique,
social et moral.
La poésie peut susciter l’engagement du lecteur si elle parvient à le toucher.
B- Le poète et la poésie
• Jean Cocteau définit ainsi le rôle de la poésie => « Elle dévoile dans toute la force du
terme.
Elle montre nues, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes
qui nous environnent et que nos sens enregistrent machinalement ».
• Pour Baudelaire, le poète est l’intermédiaire entre le monde des hommes et l’au-delà =>
le monde est comme le reflet de la vérité, que l’homme ordinaire ne peut percevoir, car
comme le disait Platon, il tourne le dos à l’entrée de la caverne.
De fait, seul le poète peut
accéder à la vérité et la transmettre aux hommes (« J’ai plus de souvenirs que si j’avais
mille ans »).
Finalement, si on en croit Baudelaire, tout en s’éloignant de la réalité par sa
forme et son expression, la poésie, via le poète, nous dit beaucoup de la réalité.
C- La poésie fait sortir la réalité profonde de l’être
• Le poète « voyant » Cf.
Poésie symboliste.
• « Les Correspondances ».
Pour Baudelaire, le naturel (la matière, l’apparence) VS le
spirituel (réalité profonde) et c’est par les symboles qu’il pourra appréhender la réalité
supérieure réservée au poète clairvoyant.
Seul le poète est capable de déchiffrer les
symboles et pourra donc interpréter les signes mystérieux (« confuses paroles » v.2) que
lui envoie la nature.
=> pour pénétrer le mystère du monde réel, Baudelaire recourt à la technique des
synesthésies : harmonie secrète de nos sens.
Le poète doit inventer les mots et les images
les mieux à même de faire sentir la présence de cet autre monde => symbolisme.
• Le poète, la poésie nous révèle à nous-même : « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon
frère » (Baudelaire).
« Hélas ! Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous.
Comment
ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui crois que le ne suis pas toi.
» avertit Hugo dans
la préface des Contemplations.
• La poésie permet de saisir la réalité des émotions : le « je » transparaît, surtout dans la
poésie lyrique (par les images…) et se trahit => rapport entre la poésie et l’inconscient.
Vision des Surréalistes : forces du rêve et de l’insconscient qui se libèrent par le poème.
∆) Le poète est ainsi traducteur, déchiffreur de signes et permet de révéler des
émotions et des sentiments au lecteur.
II- L’écriture poétique
Comment les poètes parviennent-ils à dire plus dans leurs vers ?
A- Un langage de l’émotion
• La poésie : condensé d'écriture qui rassemble une grande quantité d'émotions (VS prose
ou théâtre qui sont souvent de longs développements).
Ex : « il a deux trous rouges dans la poitrine » => Rimbaud avec son poème « Le Dormeur
du Val», dépeint en quelques lignes toute l'horreur de la guerre que l'on retrouve dans la
littérature en prose dans de longs développements.
• Cf.
le texte d’H.
Michaux => il crée de nouveaux mots « Il l'emparouille et l'endosque
contre terre ;/ Il le rague et le roupéte jusqu'à son drâle ; / Il le pratéle et le libucque et
lui baroufle les ouillais ».
Travail des mots, travail de la langue.
Mots-valises, néologismes… Même si on ne connaît
pas les mots, on comprend dans ce poème l’horreur de la guerre.
B- Poésie de l’image
• Remise en cause de la syntaxe traditionnelle : sonorités, musicalité, assonances,
allitérations mais graphisme important (disposition dans la page, calligrammes).
Ex : Hugo
«Les souffles de la nuit flottaient sur Galgal » allitérations en « l » qui fait entendre le
souffle du vents.
• Nouveau langage pour dire ce que seul le poète peut voir.
Cf.
la Lettre à Paul Demeny,
Lettre dite du Voyant de Rimbaud + Cf.
le Sonnet des Voyelles.
• Poésie de la transfiguration qui oblige à s’ouvrir à des équivalences, qui privilégie l’image,
l’analogie.
Ex : « Le pain », « La bicyclette » ; on pourrait par exemple développer
l’exemple offert par " Le pain " en rappelant comment la langue ordinaire parle de la "
croûte " du pain, mais omet le rapprochement avec celle de la terre.
• Le poète crée parfois sa propre langue pour jouer plus librement avec elle.
Étrangeté des
métaphores symbolistes, « déracinement du langages ».
• Surréalistes : images insolites => nouvel univers.
« La terre est bleue comme une
orange » Eluard / « Bergère, Ô Tour Eiffel/ Le troupeau des ponts bêle »
Ex : Chez Eluard, la poésie est un condensé d’écriture.
Pas de ponctuation : successions
de phrases nominales sans liens car elles s’adressent à la sensibilité, à l'émotion, plus qu'à
la raison.
C- La musicalité, l’essence de la poésie
• Pour Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Valéry ou Claudel, la poésie est ce qui reste quand
on a éliminé tout ce qu’on peut traduire en prose.
=> Les mots, débarrassés de leur fonction utilitaire, didactique ou ornementale, visent à
créer une pure harmonie, voisine de la musique.
• Le symbolisme a tenté d’atteindre avec les mots la pureté impalpable de la musique.
Ex :
« Et je m’en vais / Au vent mauvais / Qui m’emporte / Deça, delà, / Pareil à la / Feuille
morte » Verlaine.
=> peu importe le sens des mots, ce qui compte est que, comme les notes de musique,
les mots soient l’écriture d’une partition mélodieuse.
∆) Poésie : ne vise pas à la compréhension par un langage appris mais à
l’impression et à l’universalité.
Évasion du lecteur de poésie qui, durant sa lecture, n’est
plus dans la réalité quotidienne (ou dans l’expression de la réalité quotidienne).
Poète : souvent considéré comme un rêveur => nous entraîne dans son monde.
III- Quelques raisons d’aimer la poésie et ses limites
Même si la poésie est un travail sur les mots => importance des sentiments, de
la fonction du poème.
La poésie est aussi une manière de s’exprimer, d’énoncer ses idées.
A- Une poésie des sentiments
La poésie est le lieu de l’épanchement, de l’expression de ses sentiments.
• Exaltation du « je » qui célèbre « tu ».
Lyrisme.
Célébration de l’être cher (prenez des exemples de votre corpus).
Dialogue sentimental,
tutoiement et désignation directe de la femme aimée : Lou chez Apollinaire, Elsa chez
Aragon…
• Se libérer par les mots, sons, rythmes : Cf.
Baudelaire qui met en poème son mal-être
et ses montées d’angoisse (Cf.
« spleen »).
• Séparation, mort : thème fréquents de la poésie => tristesse, désespoir.
Mélancolie du
souvenir (Verlaine, Lamartine).
∆) => Le lecteur peut se reconnaître dans l’évocation des sentiments du poète.
Justesse
du dit et universalité des sentiments.
B- La poésie comme arme
• Genre court (rapide, condensé=> fort), qui frappe l’imagination par ses images
(métaphores…)
La poésie utilise alors des registres variés : sature, ironie, lyrisme, burlesque.
• La poésie se met au service des grandes causes.
- Engagement social, contre les injustices.
Ex : Rimbaud « Les Assis ».
- Engagement politique.
Hugo : Les Châtiments, lutte contre Napoléon III (se moque de
lui « petit, petit, petit », « le singe » et le montre comme un ogre sanguinaire)
• Cf.
« Souvenir de la nuit du 4 » => poème très touchant, le lecteur est influencé (talent
de conteur, de poète, images de la vie quotidienne, du désespoir de la vieille femme, de
l’injustice…=> arme rhétorique).
Cf.
« La lettre du déserteur » de B.
Vian.
∆) Le lecteur réfléchit grâce à la poésie qui lui montre d’autres aspects sur un
sujet (ex : Hugo donne sa conception du Second Empire ; Eluard donne sa version de la
poésie engagée…).
C- La poésie, un art difficile à pénétrer
• Comprend-on toujours qu’un poème aussi simple que Pour faire le portrait d’un oiseau
de Prévert cache en fait un art poétique, un plaidoyer pour un art libre et pour une nature
à préserver ?
« Mes sonnets […] perdraient en charme à être expliqués, si la chose en était possible »
affirme Nerval.
• C’est parfois une revendication du poète de réserver son œuvre aux seuls initiés et de la
rendre volontairement hermétique au profane.
Le message poétique réservé aux êtres
sensibles ? => Hermétisme.
Ex : Mallarmé choisit des mots rares : « Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx, / Aboli
bibelot d’inanité sonore… ».
Cf.
le poète Char qui reconnaissait que certains pans de ses poèmes ne pouvaient....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓