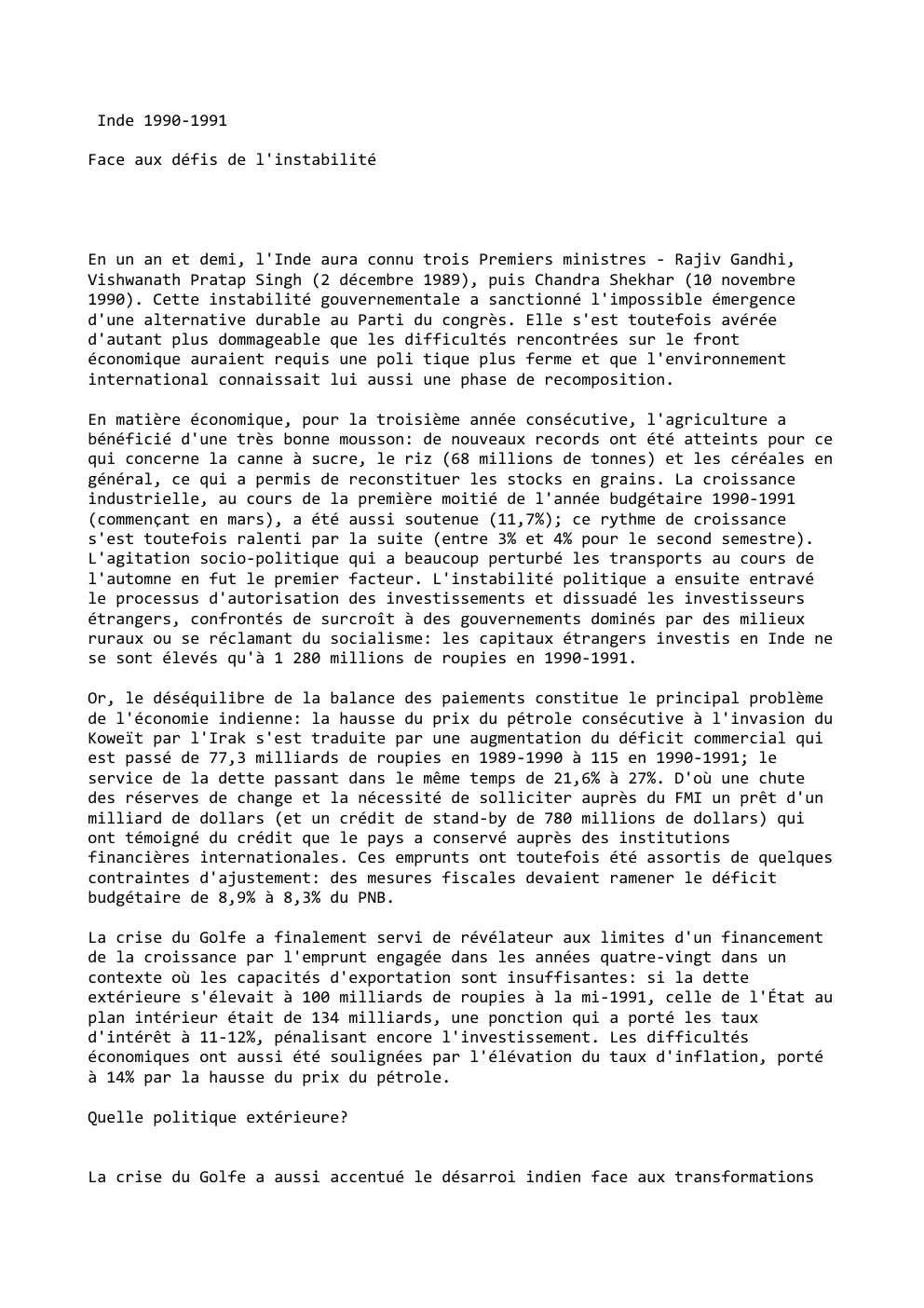Inde 1990-1991 Face aux défis de l'instabilité En un an et demi, l'Inde aura connu trois Premiers ministres - Rajiv...
Extrait du document
«
Inde 1990-1991
Face aux défis de l'instabilité
En un an et demi, l'Inde aura connu trois Premiers ministres - Rajiv Gandhi,
Vishwanath Pratap Singh (2 décembre 1989), puis Chandra Shekhar (10 novembre
1990).
Cette instabilité gouvernementale a sanctionné l'impossible émergence
d'une alternative durable au Parti du congrès.
Elle s'est toutefois avérée
d'autant plus dommageable que les difficultés rencontrées sur le front
économique auraient requis une poli tique plus ferme et que l'environnement
international connaissait lui aussi une phase de recomposition.
En matière économique, pour la troisième année consécutive, l'agriculture a
bénéficié d'une très bonne mousson: de nouveaux records ont été atteints pour ce
qui concerne la canne à sucre, le riz (68 millions de tonnes) et les céréales en
général, ce qui a permis de reconstituer les stocks en grains.
La croissance
industrielle, au cours de la première moitié de l'année budgétaire 1990-1991
(commençant en mars), a été aussi soutenue (11,7%); ce rythme de croissance
s'est toutefois ralenti par la suite (entre 3% et 4% pour le second semestre).
L'agitation socio-politique qui a beaucoup perturbé les transports au cours de
l'automne en fut le premier facteur.
L'instabilité politique a ensuite entravé
le processus d'autorisation des investissements et dissuadé les investisseurs
étrangers, confrontés de surcroît à des gouvernements dominés par des milieux
ruraux ou se réclamant du socialisme: les capitaux étrangers investis en Inde ne
se sont élevés qu'à 1 280 millions de roupies en 1990-1991.
Or, le déséquilibre de la balance des paiements constitue le principal problème
de l'économie indienne: la hausse du prix du pétrole consécutive à l'invasion du
Koweït par l'Irak s'est traduite par une augmentation du déficit commercial qui
est passé de 77,3 milliards de roupies en 1989-1990 à 115 en 1990-1991; le
service de la dette passant dans le même temps de 21,6% à 27%.
D'où une chute
des réserves de change et la nécessité de solliciter auprès du FMI un prêt d'un
milliard de dollars (et un crédit de stand-by de 780 millions de dollars) qui
ont témoigné du crédit que le pays a conservé auprès des institutions
financières internationales.
Ces emprunts ont toutefois été assortis de quelques
contraintes d'ajustement: des mesures fiscales devaient ramener le déficit
budgétaire de 8,9% à 8,3% du PNB.
La crise du Golfe a finalement servi de révélateur aux limites d'un financement
de la croissance par l'emprunt engagée dans les années quatre-vingt dans un
contexte où les capacités d'exportation sont insuffisantes: si la dette
extérieure s'élevait à 100 milliards de roupies à la mi-1991, celle de l'État au
plan intérieur était de 134 milliards, une ponction qui a porté les taux
d'intérêt à 11-12%, pénalisant encore l'investissement.
Les difficultés
économiques ont aussi été soulignées par l'élévation du taux d'inflation, porté
à 14% par la hausse du prix du pétrole.
Quelle politique extérieure?
La crise du Golfe a aussi accentué le désarroi indien face aux transformations
du paysage international.
La tension entre l'Inde et le Pakistan qui avait
dominé le premier semestre 1990, au point de provoquer des tirs d'artillerie,
s'est atténuée au cours de l'été, notamment sous la pression de l'URSS et des
États-Unis (une mission américaine s'est ainsi rendue à New Delhi en juin).
Ultérieurement, Chandra Shekhar lorsqu'il fut Premier ministre, en novembre,
s'efforça de rétablir une forme de dialogue avec le Premier ministre
pakistanais, Nawaz Sharif; cette démarche traduisait un souci général
d'améliorer les rapports de l'Inde avec ses voisins dans la perspective ouverte
par le précédent Premier ministre indien, V.P.
Singh.
Les relations anciennes de
Chandra Shekhar avec l'opposition démocratique au Népal servirent ce projet (les
relations avec Katmandou ont traversé une crise aiguë de mars 1989 à juin 1990),
tout comme, dans le cas de Sri Lanka, la destitution du gouvernement du Tamil
Nadu - État tamoul de l'Union indienne -, accusé d'abriter des camps
d'entraînement de militants du mouvement tamoul sri-lankais LTTE (Tigres de
l'Eelam tamoul).
Les relations sino-indiennes ont quant à elles continué à
s'améliorer lentement, Chandra Shekhar ayant mandaté une délégation pour
rétablir le commerce frontalier, ce qui a pu aider la Chine à résoudre la
question des pénuries au Tibet.
Les problèmes régionaux se sont toutefois trouvés refoulés au second plan lors
de la crise du Golfe qui fut une passe difficile pour l'Inde.
Fidèle à sa ligne
politique dans la région, qui consistait à ne pas prendre parti dans les
différends entre États (sauf contre Israël), afin de préserver ses débouchés,
ses approvisionnements pétroliers et les contrats de travail dont bénéficient
1,5 million d'Indiens (dont 800 000 en Arabie saoudite et dans les Émirats
arabes unis), la diplomatie indienne a cherché à ménager toutes les parties, y
compris l'Irak qui fournissait à l'Inde deux tiers de ses besoins en pétrole.
Peu après l'invasion du Koweït (2 août 1990), qui se traduisit par le
rapatriement de 900 000 travailleurs immigrés soumis à de terribles épreuves sur
place, le ministre des Affaires étrangères, I.K.
Gujral, rendit visite à Saddam
Hussein de qui il reçut l'accolade.
Il tenta, sans succès, de susciter une
médiation des non-alignés.
Ensuite, sans se rendre aux vues américaines, l'Inde
se rallia aux résolutions des Nations unies - y compris celle prévoyant l'usage
de la force à l'expiration de l'ultimatum -, tout en refusant de lier la
question palestinienne à celle du Koweït.
Mais après le déclenchement des
hostilités (17 janvier 1991), la décision de Chandra Shekhar d'autoriser les
avions américains à se ravitailler en Inde fut critiquée par tous les partis, à
commencer par le Congrès dont le chef, Rajiv Gandhi, se fit l'avocat d'une
initiative des non-alignés.
La délégation du mouvement essuya toutefois un refus
à ses demandes d'entrevue de la part de Saddam Hussein et mécontenta les alliés.
Ces atermoiements ont illustré la relative désorientation dont souffre la
politique étrangère indienne dans un paysage international en voie de
recomposition: l'attachement au non-alignement et le biais anti-américain
semblent de moins en moins tenables au moment où l'URSS ne peut plus servir ni
de pôle rival aux États-Unis ni d'allié-protecteur.
Si la visite du Premier
ministre V.P.
Singh à Moscou, en août 1990, s'était surtout traduite par une
reconduction des accords commerciaux, leur mise en oeuvre s'est en effet avérée
difficile en raison de la désorganisation de l'économie soviétique.
Le
successeur de V.P.
Singh, Chandra Shekhar, avait d'une certaine façon commencé à
tirer les conséquences de cet état de choses et amorcé un rapprochement avec les
États-Unis.
Cela allait être l'un des facteurs de la prise de distance du
Congrès dont la défection, en mars 1991, allait causer la seconde chute de
gouvernement en quatre mois.
Vives turbulences politiques
La dépendance du Janta Dal du Premier ministre V.P.
Singh envers les voix du BJP
(Bharatiya Janta Party, nationaliste hindou) et des communistes laissait
présager que le gouvernement formé à la fin de 1989 n'achèverait pas son mandat.
Les premières tensions résultèrent cependant, au printemps 1990, des aspirations
au pouvoir du chef d'une des factions du Janta Dal, le leader paysan et
vice-Premier ministre Devi Lal.
Celui-ci annonça, puis reprit sa démission en
avril; il protesta le mois suivant contre la destitution de son fils Chauthala,
jusqu'alors chef du gouvernement de l'État d'Haryana, accusé d'avoir recouru à
la violence lors de son élection.
Devi Lal quitta finalement le gouvernement et
annonça une manifestation paysanne d'envergure pour le 9 août 1990 à New Delhi.
Deux jours avant la tenue de cette démonstration de force en forme de défi, V.P.
Singh annonça la mise en application du rapport Mandal dont les recommandations,
volontairement oubliées par les gouvernements successifs depuis 1980, portaient
d'abord sur la réservation de 27% des postes de l'administration centrale aux
castes dites "arriérées".
L'enjeu était surtout symbolique, mais cette annonce
de V.P.
Singh visait à l'ériger en leader des basses castes, et à soustraire....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓