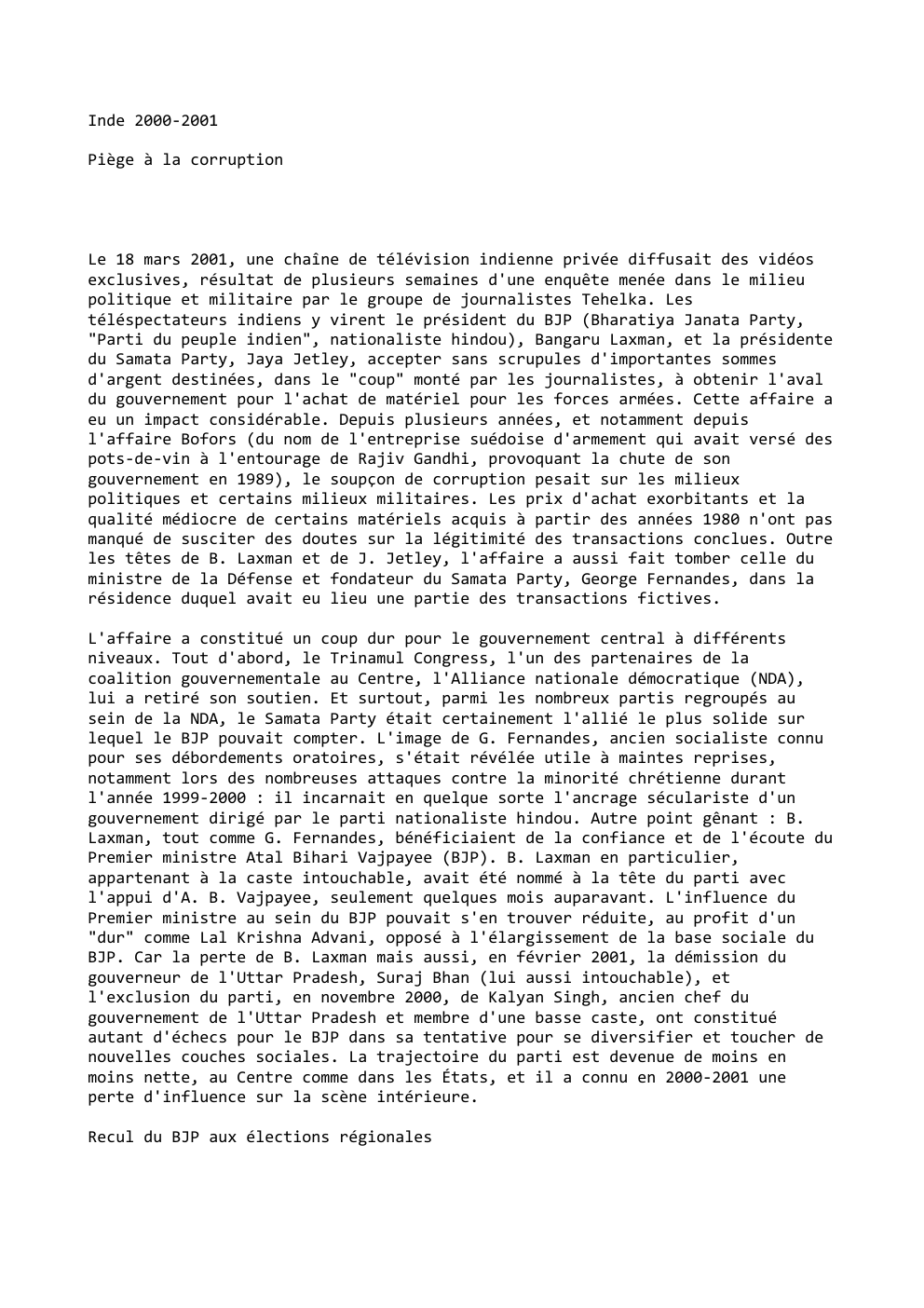Inde 2000-2001 Piège à la corruption Le 18 mars 2001, une chaîne de télévision indienne privée diffusait des vidéos exclusives,...
Extrait du document
«
Inde 2000-2001
Piège à la corruption
Le 18 mars 2001, une chaîne de télévision indienne privée diffusait des vidéos
exclusives, résultat de plusieurs semaines d'une enquête menée dans le milieu
politique et militaire par le groupe de journalistes Tehelka.
Les
téléspectateurs indiens y virent le président du BJP (Bharatiya Janata Party,
"Parti du peuple indien", nationaliste hindou), Bangaru Laxman, et la présidente
du Samata Party, Jaya Jetley, accepter sans scrupules d'importantes sommes
d'argent destinées, dans le "coup" monté par les journalistes, à obtenir l'aval
du gouvernement pour l'achat de matériel pour les forces armées.
Cette affaire a
eu un impact considérable.
Depuis plusieurs années, et notamment depuis
l'affaire Bofors (du nom de l'entreprise suédoise d'armement qui avait versé des
pots-de-vin à l'entourage de Rajiv Gandhi, provoquant la chute de son
gouvernement en 1989), le soupçon de corruption pesait sur les milieux
politiques et certains milieux militaires.
Les prix d'achat exorbitants et la
qualité médiocre de certains matériels acquis à partir des années 1980 n'ont pas
manqué de susciter des doutes sur la légitimité des transactions conclues.
Outre
les têtes de B.
Laxman et de J.
Jetley, l'affaire a aussi fait tomber celle du
ministre de la Défense et fondateur du Samata Party, George Fernandes, dans la
résidence duquel avait eu lieu une partie des transactions fictives.
L'affaire a constitué un coup dur pour le gouvernement central à différents
niveaux.
Tout d'abord, le Trinamul Congress, l'un des partenaires de la
coalition gouvernementale au Centre, l'Alliance nationale démocratique (NDA),
lui a retiré son soutien.
Et surtout, parmi les nombreux partis regroupés au
sein de la NDA, le Samata Party était certainement l'allié le plus solide sur
lequel le BJP pouvait compter.
L'image de G.
Fernandes, ancien socialiste connu
pour ses débordements oratoires, s'était révélée utile à maintes reprises,
notamment lors des nombreuses attaques contre la minorité chrétienne durant
l'année 1999-2000 : il incarnait en quelque sorte l'ancrage séculariste d'un
gouvernement dirigé par le parti nationaliste hindou.
Autre point gênant : B.
Laxman, tout comme G.
Fernandes, bénéficiaient de la confiance et de l'écoute du
Premier ministre Atal Bihari Vajpayee (BJP).
B.
Laxman en particulier,
appartenant à la caste intouchable, avait été nommé à la tête du parti avec
l'appui d'A.
B.
Vajpayee, seulement quelques mois auparavant.
L'influence du
Premier ministre au sein du BJP pouvait s'en trouver réduite, au profit d'un
"dur" comme Lal Krishna Advani, opposé à l'élargissement de la base sociale du
BJP.
Car la perte de B.
Laxman mais aussi, en février 2001, la démission du
gouverneur de l'Uttar Pradesh, Suraj Bhan (lui aussi intouchable), et
l'exclusion du parti, en novembre 2000, de Kalyan Singh, ancien chef du
gouvernement de l'Uttar Pradesh et membre d'une basse caste, ont constitué
autant d'échecs pour le BJP dans sa tentative pour se diversifier et toucher de
nouvelles couches sociales.
La trajectoire du parti est devenue de moins en
moins nette, au Centre comme dans les États, et il a connu en 2000-2001 une
perte d'influence sur la scène intérieure.
Recul du BJP aux élections régionales
Cette radicalisation n'a toutefois pas vraiment joué dans les quatre États où se
sont déroulées, en mai 2001, des élections régionales (Tamil Nadu, Assam, Kerala
et Bengale occidental, plus le territoire de Pondichéry), mais la situation
risquait d'être problématique lors des élections prévues en Uttar Pradesh début
2002.
Les élections régionales de mai 2001 ont constitué un double test pour la
coalition gouvernementale puisque, dans trois des États concernés, le BJP ou un
de ses partenaires était impliqué.
Globalement, tous en sont sortis perdants.
Au Tamil Nadu, le Dravida Munetra Kazhagam (DMK, au pouvoir) a été balayé par
son rival de longue date, l'AIADMK (All India Anna Dravida Munetra Kazhagam).
Celui-ci, dirigé par J.
Jayalalitha, pourtant sous le coup d'une mise en examen
pour plusieurs affaires de corruption, a remporté la majorité absolue avec 132
sièges sur 234, le DMK n'en ayant conservé que 28.
Le retour au pouvoir de J
Jayalalitha, à l'issue d'une campagne électorale sans idées, semblait relever du
principe "sortir les sortants" (anti-incumbency), auquel peu de gouvernements
régionaux ont pu échapper à partir du début des années 1990.
Parmi ces
exceptions figurait le Parti communiste de l'Inde-marxiste (CPI-M), entré en
lice sans sa figure emblématique, Jyoti Basu, qui s'est retirée de la politique
active dans le courant de l'année 2000.
En dépit de sa rivalité avec le Trinamul
Congress de Mamata Banerjee, ancien ministre des Transports de l'Union, qui
avait obtenu du Premier ministre une importante enveloppe de fonds pour "son"
État (Bengale occidental), le CPI-M a remporté 143 sièges sur les 211 qu'il
briguait dans cet État.
Le dauphin de J.
Basu, Buddhadev Bhattacharjea, a ainsi
été nommé à la tête du sixième gouvernement consécutif du Front de gauche au
Bengale occidental.
Le Congrès-I, qui s'était uni au Trinamul au risque de démoraliser ses cadres, a
également fait figure de perdant.
Sa victoire en Assam n'en a été que plus
retentissante.
Il y a battu non seulement le parti au pouvoir, l'Asom Gana
Parishad, mais aussi le BJP, allié de dernière minute du précédent.
Bien que
désuni dans cet État comme dans beaucoup d'autres, le Congrès a remporté plus de
la moitié des sièges, très loin devant l'alliance BJP-AGP.
Au Kerala, le front
démocratique de gauche, dirigé par le CPI-M, a été distancé par une opposition
unie au sein du Front démocratique uni, intégrant le parti du Congrès ; il n'a
remporté que 40 sièges contre 99 pour son rival.
Pour le Congrès, et plus
particulièrement pour son leader Sonia Gandhi, ces élections représentaient une
dernière chance de prouver qu'il était encore un grand parti national, le seul
capable de diriger une coalition d'alternance au BJP.
De plus, l'alliance avec
le Trinamul Congress au Bengale occidental a constitué un développement majeur
puisque, depuis la session de l'All India Congress Committee (AICC) tenue à
Pachmarhi en 1998, le parti s'était déclaré opposé à toute alliance.
Le Congrès demeurait toutefois marqué par l'indécision, le manque de direction
et le factionnalisme, amplifiés depuis l'arrivée à sa tête de S.
Gandhi.
Le vrai
test pour ce parti semblait devoir être les élections du début 2002 en Uttar
Pradesh, ancien bastion du Congrès, où il a été réduit à la portion congrue par
le BJP et les partis de castes.
Les mouvements séparatistes ont continué d'ensanglanter les confins de l'Union.
Dans le Nord-Est, la perte de vitesse....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓