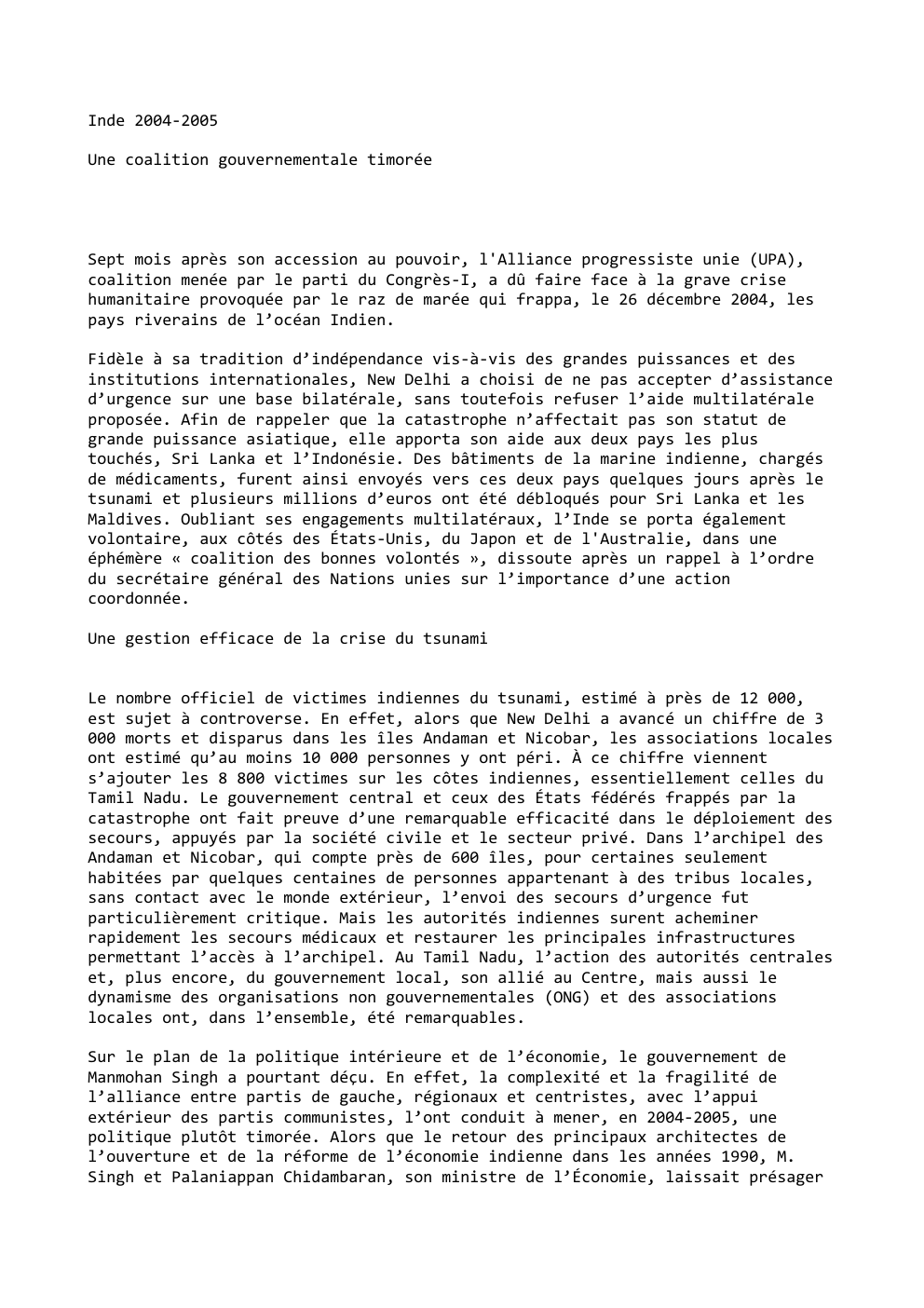Inde 2004-2005 Une coalition gouvernementale timorée Sept mois après son accession au pouvoir, l'Alliance progressiste unie (UPA), coalition menée par...
Extrait du document
«
Inde 2004-2005
Une coalition gouvernementale timorée
Sept mois après son accession au pouvoir, l'Alliance progressiste unie (UPA),
coalition menée par le parti du Congrès-I, a dû faire face à la grave crise
humanitaire provoquée par le raz de marée qui frappa, le 26 décembre 2004, les
pays riverains de l’océan Indien.
Fidèle à sa tradition d’indépendance vis-à-vis des grandes puissances et des
institutions internationales, New Delhi a choisi de ne pas accepter d’assistance
d’urgence sur une base bilatérale, sans toutefois refuser l’aide multilatérale
proposée.
Afin de rappeler que la catastrophe n’affectait pas son statut de
grande puissance asiatique, elle apporta son aide aux deux pays les plus
touchés, Sri Lanka et l’Indonésie.
Des bâtiments de la marine indienne, chargés
de médicaments, furent ainsi envoyés vers ces deux pays quelques jours après le
tsunami et plusieurs millions d’euros ont été débloqués pour Sri Lanka et les
Maldives.
Oubliant ses engagements multilatéraux, l’Inde se porta également
volontaire, aux côtés des États-Unis, du Japon et de l'Australie, dans une
éphémère « coalition des bonnes volontés », dissoute après un rappel à l’ordre
du secrétaire général des Nations unies sur l’importance d’une action
coordonnée.
Une gestion efficace de la crise du tsunami
Le nombre officiel de victimes indiennes du tsunami, estimé à près de 12 000,
est sujet à controverse.
En effet, alors que New Delhi a avancé un chiffre de 3
000 morts et disparus dans les îles Andaman et Nicobar, les associations locales
ont estimé qu’au moins 10 000 personnes y ont péri.
À ce chiffre viennent
s’ajouter les 8 800 victimes sur les côtes indiennes, essentiellement celles du
Tamil Nadu.
Le gouvernement central et ceux des États fédérés frappés par la
catastrophe ont fait preuve d’une remarquable efficacité dans le déploiement des
secours, appuyés par la société civile et le secteur privé.
Dans l’archipel des
Andaman et Nicobar, qui compte près de 600 îles, pour certaines seulement
habitées par quelques centaines de personnes appartenant à des tribus locales,
sans contact avec le monde extérieur, l’envoi des secours d’urgence fut
particulièrement critique.
Mais les autorités indiennes surent acheminer
rapidement les secours médicaux et restaurer les principales infrastructures
permettant l’accès à l’archipel.
Au Tamil Nadu, l’action des autorités centrales
et, plus encore, du gouvernement local, son allié au Centre, mais aussi le
dynamisme des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations
locales ont, dans l’ensemble, été remarquables.
Sur le plan de la politique intérieure et de l’économie, le gouvernement de
Manmohan Singh a pourtant déçu.
En effet, la complexité et la fragilité de
l’alliance entre partis de gauche, régionaux et centristes, avec l’appui
extérieur des partis communistes, l’ont conduit à mener, en 2004-2005, une
politique plutôt timorée.
Alors que le retour des principaux architectes de
l’ouverture et de la réforme de l’économie indienne dans les années 1990, M.
Singh et Palaniappan Chidambaran, son ministre de l’Économie, laissait présager
une politique économique dynamique, s’appuyant sur les 6 % de taux de croissance
annuelle moyenne, le gouvernement n’a pas montré l’enthousiasme attendu par le
secteur privé pour les réformes, notamment celle des entreprises publiques.
Il
n’a pas non plus pris les mesures destinées à améliorer les conditions de vie
des plus pauvres, figurant pourtant dans son programme électoral en 2004.
Sa
proposition de loi sur l’emploi garanti à salaire minimal est ainsi restée
lettre morte, suscitant des manifestations d’importance.
La question, cruciale,
de l’épidémie de VIH-sida, qui touche cinq millions d’Indiens selon la Banque
mondiale, n’est pas non plus inscrite dans le plan d’action gouvernemental.
Une politique intérieure attentiste
Sa victoire en 2004 a constitué pour le Congrès-I un bouleversement de ses
traditions politiques, l’amenant au pouvoir central, pour la première fois, au
sein d’une coalition, marquant ainsi la fin véritable de son hégémonie et la fin
du système bipartisan, qui avait caractérisé les années 1990.
À l’alternance
classique entre grands partis nationaux s’est substituée celle de grandes
alliances à géométrie variable, autour d’un parti national, BJP (Bharatiya
Janata Party) ou parti du Congrès.
Les élections de fin 2004 et début 2005 dans
le Maharashtra, le Jharkhand et le Bihar ont montré que ces alliances nationales
n’avaient pas cours au niveau régional.
Le scrutin pour l’assemblée régionale du
Maharashtra, en octobre 2004, a permis une nette victoire du parti du Congrès,
grâce à l’alliance conclue avec son partenaire régional, le Nationalist Congress
Party.
Fondé à la fin des années 1990 par Sharad Pawar, ancien membre du Congrès
et ancien ministre de la Défense sous Rajiv Gandhi, ce parti issu du moule
congressiste en partage encore les structures et le programme.
À l’opposé, les élections au Jharkand et au Bihar, en février 2005, ont vu le
Congrès opposé à des partenaires de l’alliance fédérale gouvernementale (UPA)
qui sont aussi, dans les États, ses premiers opposants.
Cela a été
particulièrement visible au Bihar, tenu depuis 1990 par Laloo Prasad Yadav,
détenteur du puissant ministère des Transports.
Son parti, le Rashtriya Janata
Dal (RJD), s’appuie sur les votes yadav (basse caste agraire) et musulmans.
En
choisissant de s’allier à un parti de base électorale intouchable et musulmane,
le Lok Janshakti Party, dirigé par Ram Vilas Paswan, également ministre mais «
bête noire » de L.
P.
Yadav, le Congrès fit le choix de la confrontation avec
l’homme fort de l’État, sans pour autant pouvoir espérer remporter l’élection.
Pourtant, devant les résultats donnant l’alliance conclue entre le BJP et le
Janata Dal-Unifié en tête mais sans majorité devant le RJD, le Congrès fit
volte-face.
Il se rallia à L.
P.
Yadav, s’aliénant ainsi R.
V.
Paswan.
L’imposition du gouvernement par le Centre (President’s rule) sur injonction du
président de la République indienne, Abdul Kalam, permit de sortir d’une
situation inextricable, non sans dégâts sur l’électorat dont l’expression ne fut
en rien prise en considération par les partis impliqués.
Ces développements
ainsi que la très critiquable gestion par le Centre des résultats de l’élection
au Jharkand fragilisèrent le gouvernement fédéral et contribuèrent à détériorer
l’image de la classe politique indienne, la faisant apparaître comme
opportuniste et manipulatrice.
Au Jharkhand en effet, le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓