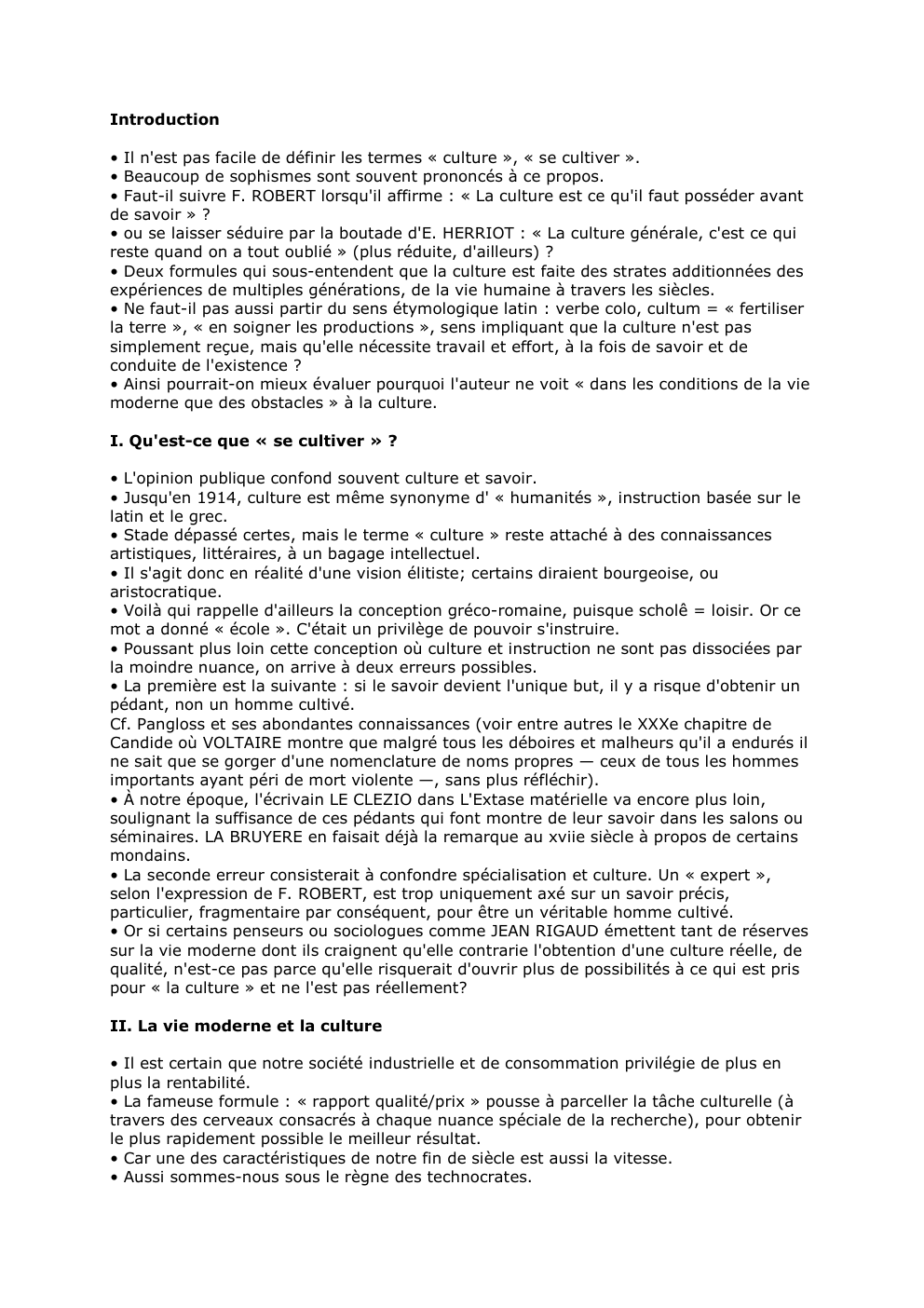Introduction • Il n'est pas facile de définir les termes « culture », « se cultiver ». • Beaucoup de...
Extrait du document
«
Introduction
• Il n'est pas facile de définir les termes « culture », « se cultiver ».
• Beaucoup de sophismes sont souvent prononcés à ce propos.
• Faut-il suivre F.
ROBERT lorsqu'il affirme : « La culture est ce qu'il faut posséder avant
de savoir » ?
• ou se laisser séduire par la boutade d'E.
HERRIOT : « La culture générale, c'est ce qui
reste quand on a tout oublié » (plus réduite, d'ailleurs) ?
• Deux formules qui sous-entendent que la culture est faite des strates additionnées des
expériences de multiples générations, de la vie humaine à travers les siècles.
• Ne faut-il pas aussi partir du sens étymologique latin : verbe colo, cultum = « fertiliser
la terre », « en soigner les productions », sens impliquant que la culture n'est pas
simplement reçue, mais qu'elle nécessite travail et effort, à la fois de savoir et de
conduite de l'existence ?
• Ainsi pourrait-on mieux évaluer pourquoi l'auteur ne voit « dans les conditions de la vie
moderne que des obstacles » à la culture.
I.
Qu'est-ce que « se cultiver » ?
• L'opinion publique confond souvent culture et savoir.
• Jusqu'en 1914, culture est même synonyme d' « humanités », instruction basée sur le
latin et le grec.
• Stade dépassé certes, mais le terme « culture » reste attaché à des connaissances
artistiques, littéraires, à un bagage intellectuel.
• Il s'agit donc en réalité d'une vision élitiste; certains diraient bourgeoise, ou
aristocratique.
• Voilà qui rappelle d'ailleurs la conception gréco-romaine, puisque scholê = loisir.
Or ce
mot a donné « école ».
C'était un privilège de pouvoir s'instruire.
• Poussant plus loin cette conception où culture et instruction ne sont pas dissociées par
la moindre nuance, on arrive à deux erreurs possibles.
• La première est la suivante : si le savoir devient l'unique but, il y a risque d'obtenir un
pédant, non un homme cultivé.
Cf.
Pangloss et ses abondantes connaissances (voir entre autres le XXXe chapitre de
Candide où VOLTAIRE montre que malgré tous les déboires et malheurs qu'il a endurés il
ne sait que se gorger d'une nomenclature de noms propres — ceux de tous les hommes
importants ayant péri de mort violente —, sans plus réfléchir).
• À notre époque, l'écrivain LE CLEZIO dans L'Extase matérielle va encore plus loin,
soulignant la suffisance de ces pédants qui font montre de leur savoir dans les salons ou
séminaires.
LA BRUYERE en faisait déjà la remarque au xviie siècle à propos de certains
mondains.
• La seconde erreur consisterait à confondre spécialisation et culture.
Un « expert »,
selon l'expression de F.
ROBERT, est trop uniquement axé sur un savoir précis,
particulier, fragmentaire par conséquent, pour être un véritable homme cultivé.
• Or si certains penseurs ou sociologues comme JEAN RIGAUD émettent tant de réserves
sur la vie moderne dont ils craignent qu'elle contrarie l'obtention d'une culture réelle, de
qualité, n'est-ce pas parce qu'elle risquerait d'ouvrir plus de possibilités à ce qui est pris
pour « la culture » et ne l'est pas réellement?
II.
La vie moderne et la culture
• Il est certain que notre société industrielle et de consommation privilégie de plus en
plus la rentabilité.
• La fameuse formule : « rapport qualité/prix » pousse à parceller la tâche culturelle (à
travers des cerveaux consacrés à chaque nuance spéciale de la recherche), pour obtenir
le plus rapidement possible le meilleur résultat.
• Car une des caractéristiques de notre fin de siècle est aussi la vitesse.
• Aussi sommes-nous sous le règne des technocrates.
• Or un spécialiste ne risque-t-il pas, comme s'en moquait l'humoriste BERNARD SHAW,
de savoir de plus en plus de choses sur de moins en moins dé choses ?
• Parcellisation et « time is money » (le temps c'est de l'argent) peuvent-ils
s'accommoder du rythme que demandait MONTAIGNE à un homme se cultivant ?
Ex.
: dans sa « librairie » (= bibliothèque), il va de livre en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓