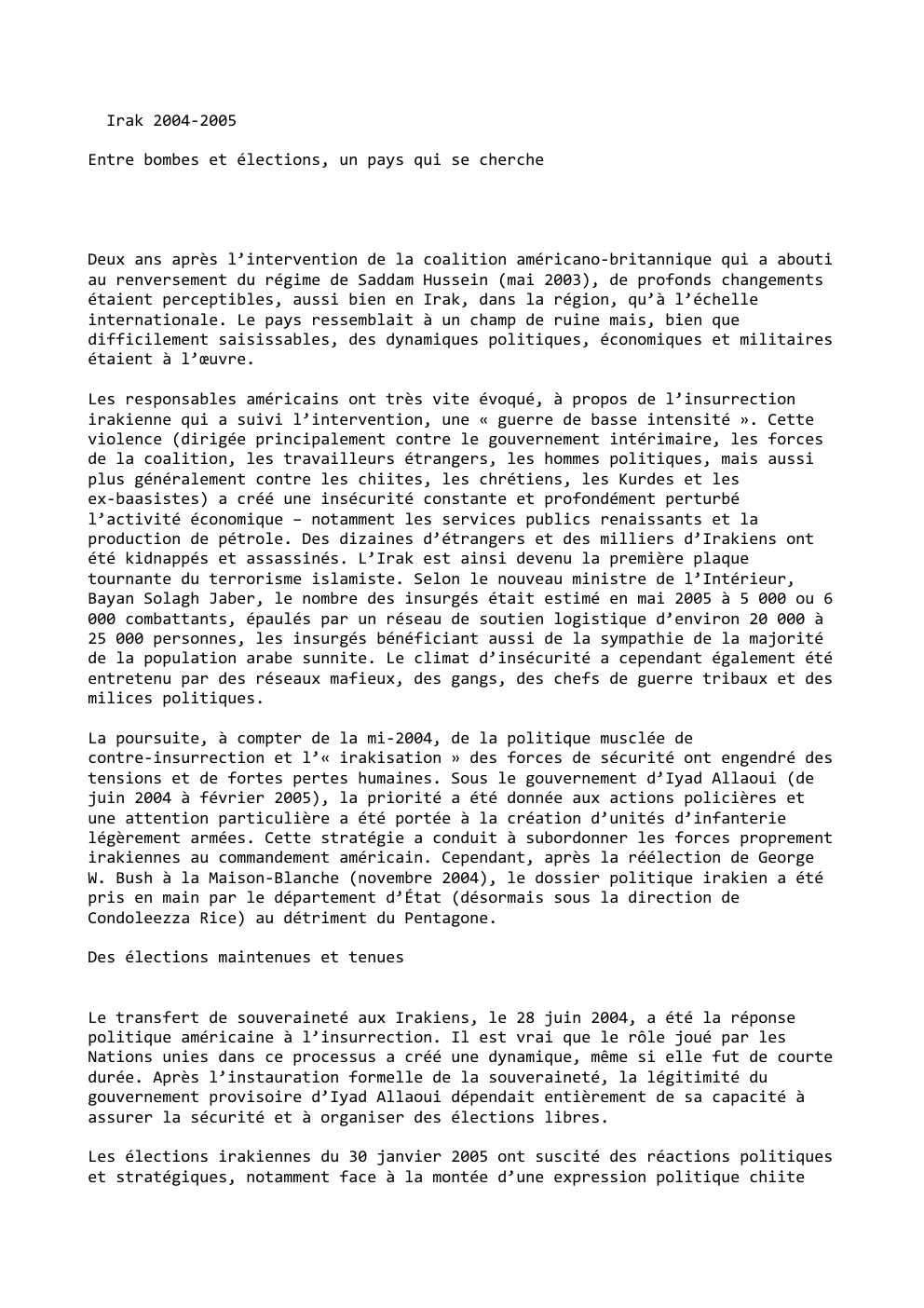Irak 2004-2005 Entre bombes et élections, un pays qui se cherche Deux ans après l’intervention de la coalition américano-britannique qui...
Extrait du document
«
Irak 2004-2005
Entre bombes et élections, un pays qui se cherche
Deux ans après l’intervention de la coalition américano-britannique qui a abouti
au renversement du régime de Saddam Hussein (mai 2003), de profonds changements
étaient perceptibles, aussi bien en Irak, dans la région, qu’à l’échelle
internationale.
Le pays ressemblait à un champ de ruine mais, bien que
difficilement saisissables, des dynamiques politiques, économiques et militaires
étaient à l’œuvre.
Les responsables américains ont très vite évoqué, à propos de l’insurrection
irakienne qui a suivi l’intervention, une « guerre de basse intensité ».
Cette
violence (dirigée principalement contre le gouvernement intérimaire, les forces
de la coalition, les travailleurs étrangers, les hommes politiques, mais aussi
plus généralement contre les chiites, les chrétiens, les Kurdes et les
ex-baasistes) a créé une insécurité constante et profondément perturbé
l’activité économique – notamment les services publics renaissants et la
production de pétrole.
Des dizaines d’étrangers et des milliers d’Irakiens ont
été kidnappés et assassinés.
L’Irak est ainsi devenu la première plaque
tournante du terrorisme islamiste.
Selon le nouveau ministre de l’Intérieur,
Bayan Solagh Jaber, le nombre des insurgés était estimé en mai 2005 à 5 000 ou 6
000 combattants, épaulés par un réseau de soutien logistique d’environ 20 000 à
25 000 personnes, les insurgés bénéficiant aussi de la sympathie de la majorité
de la population arabe sunnite.
Le climat d’insécurité a cependant également été
entretenu par des réseaux mafieux, des gangs, des chefs de guerre tribaux et des
milices politiques.
La poursuite, à compter de la mi-2004, de la politique musclée de
contre-insurrection et l’« irakisation » des forces de sécurité ont engendré des
tensions et de fortes pertes humaines.
Sous le gouvernement d’Iyad Allaoui (de
juin 2004 à février 2005), la priorité a été donnée aux actions policières et
une attention particulière a été portée à la création d’unités d’infanterie
légèrement armées.
Cette stratégie a conduit à subordonner les forces proprement
irakiennes au commandement américain.
Cependant, après la réélection de George
W.
Bush à la Maison-Blanche (novembre 2004), le dossier politique irakien a été
pris en main par le département d’État (désormais sous la direction de
Condoleezza Rice) au détriment du Pentagone.
Des élections maintenues et tenues
Le transfert de souveraineté aux Irakiens, le 28 juin 2004, a été la réponse
politique américaine à l’insurrection.
Il est vrai que le rôle joué par les
Nations unies dans ce processus a créé une dynamique, même si elle fut de courte
durée.
Après l’instauration formelle de la souveraineté, la légitimité du
gouvernement provisoire d’Iyad Allaoui dépendait entièrement de sa capacité à
assurer la sécurité et à organiser des élections libres.
Les élections irakiennes du 30 janvier 2005 ont suscité des réactions politiques
et stratégiques, notamment face à la montée d’une expression politique chiite
majoritaire et kurde en Irak.
Des millions de personnes ont bravé leur peur pour
aller voter, même si une élection isolée ne fait pas la démocratie.
Lors de ces
élections, les Irakiens ont dans leur majorité voulu donner plus de légitimité
au nouveau gouvernement irakien souverain sans que leur vote soit nécessairement
dirigé directement contre les États-Unis.
Pour la première fois de son histoire,
l’Irak allait avoir un président élu (le Kurde Jalal Talabani, mars 2005).
C’est
un Arabe chiite, Ibrahim Al-Jaafari, qui a été nommé Premier ministre (avril
2005).
Les Arabes sunnites, quant à eux, ne s’attendaient pas à de grands succès dans
ces élections.
Mais leurs divisions sont apparues croissantes.
Une partie
d’entre eux a entrepris de négocier directement avec les États-Unis, leurs
représentants figurant dans le gouvernement et participant à la rédaction de la
future Constitution.
Absence de dynamique économique
Le processus de reconstruction économique était censé poursuivre deux objectifs
principaux : la reconstruction des infrastructures autour et par l’État central
irakien ; la mise en place de réformes favorables à l’économie de marché.
L’Irak est resté un pays exsangue, sa population étant largement assistée.
Parallèlement, l’insécurité a fait baisser la production de pétrole de 20 % à 30
% et conduit à des dépenses non productives, là où l’industrie pétrolière était
censée pourvoir aux ressources de l’État et au remboursement de la dette.
La
corruption est par ailleurs devenue endémique, menaçant le processus de
reconstruction économique, mais aussi favorisant la collusion entre les éléments
corrompus des forces de sécurité et les groupes armés.
En revanche, certains secteurs de l’économie irakienne ne sont pas restés
entièrement paralysés par la violence.
Le secteur bancaire a connu des
améliorations et le dinar irakien s’est stabilisé, ouvrant ainsi quelques
opportunités économiques.
L’augmentation des salaires de la fonction publique a
permis l’élévation du niveau de vie de la population de plusieurs millions de
salariés et de retraités, mais les disparités régionales demeurent alarmantes.
Les fractures ethniques, confessionnelles et régionales
Les grandes lignes de fracture ethniques, confessionnelles et régionales
préexistaient à la formation de l’État moderne irakien, mais elles se sont
activées et inscrites dans un contexte politique nouveau, se muant en identités
politiques conflictuelles : ethnique kurde, sunnisme et chiisme arabes.
Le sunnisme arabe s’est vu marqué par trois stratégies : l’opposition pacifique,
la résistance politique et la lutte armée.
Les frontières entre les groupes
adeptes de ces stratégies étant floues et leur collaboration soumise à rudes
négociations et même à des conflits très violents.
L’insurrection est restée essentiellement circonscrite au « triangle sunnite »,
avec trois principales régions : Anbar (Falloujah et Ramadi), Mossoul....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓