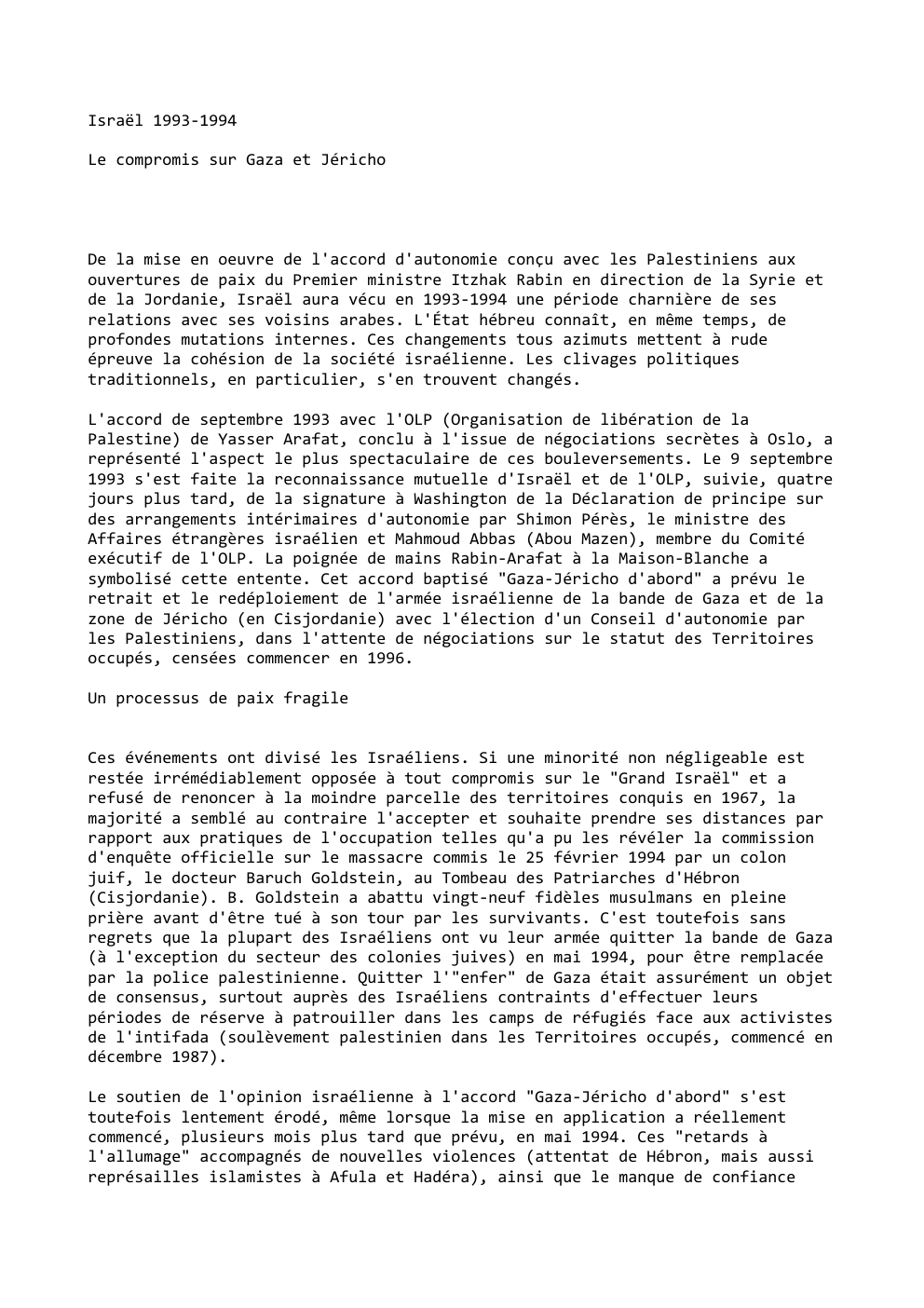Israël 1993-1994 Le compromis sur Gaza et Jéricho De la mise en oeuvre de l'accord d'autonomie conçu avec les Palestiniens...
Extrait du document
«
Israël 1993-1994
Le compromis sur Gaza et Jéricho
De la mise en oeuvre de l'accord d'autonomie conçu avec les Palestiniens aux
ouvertures de paix du Premier ministre Itzhak Rabin en direction de la Syrie et
de la Jordanie, Israël aura vécu en 1993-1994 une période charnière de ses
relations avec ses voisins arabes.
L'État hébreu connaît, en même temps, de
profondes mutations internes.
Ces changements tous azimuts mettent à rude
épreuve la cohésion de la société israélienne.
Les clivages politiques
traditionnels, en particulier, s'en trouvent changés.
L'accord de septembre 1993 avec l'OLP (Organisation de libération de la
Palestine) de Yasser Arafat, conclu à l'issue de négociations secrètes à Oslo, a
représenté l'aspect le plus spectaculaire de ces bouleversements.
Le 9 septembre
1993 s'est faite la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP, suivie, quatre
jours plus tard, de la signature à Washington de la Déclaration de principe sur
des arrangements intérimaires d'autonomie par Shimon Pérès, le ministre des
Affaires étrangères israélien et Mahmoud Abbas (Abou Mazen), membre du Comité
exécutif de l'OLP.
La poignée de mains Rabin-Arafat à la Maison-Blanche a
symbolisé cette entente.
Cet accord baptisé "Gaza-Jéricho d'abord" a prévu le
retrait et le redéploiement de l'armée israélienne de la bande de Gaza et de la
zone de Jéricho (en Cisjordanie) avec l'élection d'un Conseil d'autonomie par
les Palestiniens, dans l'attente de négociations sur le statut des Territoires
occupés, censées commencer en 1996.
Un processus de paix fragile
Ces événements ont divisé les Israéliens.
Si une minorité non négligeable est
restée irrémédiablement opposée à tout compromis sur le "Grand Israël" et a
refusé de renoncer à la moindre parcelle des territoires conquis en 1967, la
majorité a semblé au contraire l'accepter et souhaite prendre ses distances par
rapport aux pratiques de l'occupation telles qu'a pu les révéler la commission
d'enquête officielle sur le massacre commis le 25 février 1994 par un colon
juif, le docteur Baruch Goldstein, au Tombeau des Patriarches d'Hébron
(Cisjordanie).
B.
Goldstein a abattu vingt-neuf fidèles musulmans en pleine
prière avant d'être tué à son tour par les survivants.
C'est toutefois sans
regrets que la plupart des Israéliens ont vu leur armée quitter la bande de Gaza
(à l'exception du secteur des colonies juives) en mai 1994, pour être remplacée
par la police palestinienne.
Quitter l'"enfer" de Gaza était assurément un objet
de consensus, surtout auprès des Israéliens contraints d'effectuer leurs
périodes de réserve à patrouiller dans les camps de réfugiés face aux activistes
de l'intifada (soulèvement palestinien dans les Territoires occupés, commencé en
décembre 1987).
Le soutien de l'opinion israélienne à l'accord "Gaza-Jéricho d'abord" s'est
toutefois lentement érodé, même lorsque la mise en application a réellement
commencé, plusieurs mois plus tard que prévu, en mai 1994.
Ces "retards à
l'allumage" accompagnés de nouvelles violences (attentat de Hébron, mais aussi
représailles islamistes à Afula et Hadéra), ainsi que le manque de confiance
réciproque manifeste entre les dirigeants des deux parties ont entamé la
crédibilité du processus de paix, sans pour autant renforcer l'opposition de
droite, incapable de proposer d'alternative convaincante.
Cette relative passivité a permis à I.
Rabin d'aller de l'avant dans son
programme, malgré l'étroitesse de sa majorité parlementaire.
Le Premier ministre
travailliste, populaire comme ancien chef d'état-major, a rassuré en associant
étroitement la hiérarchie militaire aux négociations avec l'OLP.
La transition
plus calme que prévu à Gaza et à Jéricho en mai-juin 1994 a conforté sa marge de
manoeuvre.
Dans le même esprit, il a annoncé à la Syrie qu'Israël était prêt à des
concessions territoriales importantes sur le plateau du Golan (occupé en 1967,
puis annexé en 1981), y compris le démantèlement de colonies juives, en échange
d'une normalisation des relations avec Damas.
Ces propos allaient à l'encontre
de l'opinion majoritaire, refusant la restitution du plateau du Golan, théâtre
de furieux combats lors de la guerre israélo-arabe de 1973.
Pour désamorcer les
campagnes d'opposition, le Premier ministre s'est engagé à organiser un
référendum en cas de projet d'accord avec la Syrie impliquant d'importantes
concessions territoriales; il a ainsi suscité les critiques de Damas autant que
de certains de ses ministres.
I.
Rabin espérait pouvoir mettre en chantier cette
négociation avant le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓