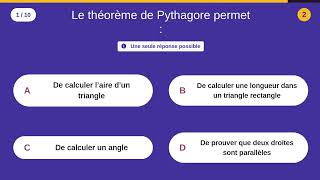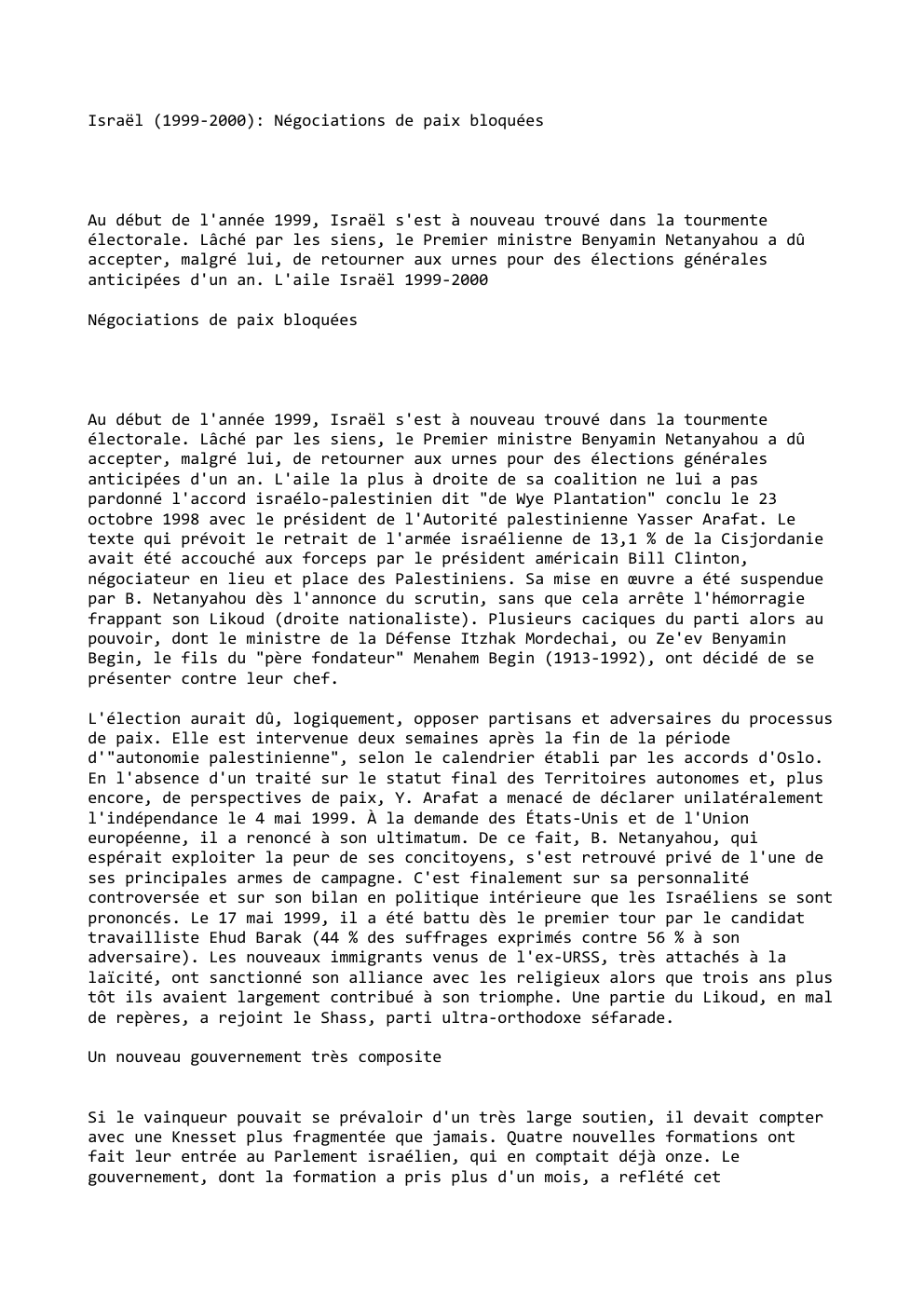Israël (1999-2000): Négociations de paix bloquées Au début de l'année 1999, Israël s'est à nouveau trouvé dans la tourmente électorale....
Extrait du document
«
Israël (1999-2000): Négociations de paix bloquées
Au début de l'année 1999, Israël s'est à nouveau trouvé dans la tourmente
électorale.
Lâché par les siens, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dû
accepter, malgré lui, de retourner aux urnes pour des élections générales
anticipées d'un an.
L'aile Israël 1999-2000
Négociations de paix bloquées
Au début de l'année 1999, Israël s'est à nouveau trouvé dans la tourmente
électorale.
Lâché par les siens, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dû
accepter, malgré lui, de retourner aux urnes pour des élections générales
anticipées d'un an.
L'aile la plus à droite de sa coalition ne lui a pas
pardonné l'accord israélo-palestinien dit "de Wye Plantation" conclu le 23
octobre 1998 avec le président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat.
Le
texte qui prévoit le retrait de l'armée israélienne de 13,1 % de la Cisjordanie
avait été accouché aux forceps par le président américain Bill Clinton,
négociateur en lieu et place des Palestiniens.
Sa mise en œuvre a été suspendue
par B.
Netanyahou dès l'annonce du scrutin, sans que cela arrête l'hémorragie
frappant son Likoud (droite nationaliste).
Plusieurs caciques du parti alors au
pouvoir, dont le ministre de la Défense Itzhak Mordechai, ou Ze'ev Benyamin
Begin, le fils du "père fondateur" Menahem Begin (1913-1992), ont décidé de se
présenter contre leur chef.
L'élection aurait dû, logiquement, opposer partisans et adversaires du processus
de paix.
Elle est intervenue deux semaines après la fin de la période
d'"autonomie palestinienne", selon le calendrier établi par les accords d'Oslo.
En l'absence d'un traité sur le statut final des Territoires autonomes et, plus
encore, de perspectives de paix, Y.
Arafat a menacé de déclarer unilatéralement
l'indépendance le 4 mai 1999.
À la demande des États-Unis et de l'Union
européenne, il a renoncé à son ultimatum.
De ce fait, B.
Netanyahou, qui
espérait exploiter la peur de ses concitoyens, s'est retrouvé privé de l'une de
ses principales armes de campagne.
C'est finalement sur sa personnalité
controversée et sur son bilan en politique intérieure que les Israéliens se sont
prononcés.
Le 17 mai 1999, il a été battu dès le premier tour par le candidat
travailliste Ehud Barak (44 % des suffrages exprimés contre 56 % à son
adversaire).
Les nouveaux immigrants venus de l'ex-URSS, très attachés à la
laïcité, ont sanctionné son alliance avec les religieux alors que trois ans plus
tôt ils avaient largement contribué à son triomphe.
Une partie du Likoud, en mal
de repères, a rejoint le Shass, parti ultra-orthodoxe séfarade.
Un nouveau gouvernement très composite
Si le vainqueur pouvait se prévaloir d'un très large soutien, il devait compter
avec une Knesset plus fragmentée que jamais.
Quatre nouvelles formations ont
fait leur entrée au Parlement israélien, qui en comptait déjà onze.
Le
gouvernement, dont la formation a pris plus d'un mois, a reflété cet
éparpillement.
Le Meretz (mouvement de la gauche pacifiste), le Parti du Centre
et Israël Be Aliya, qui représentent les immigrants russes, y côtoient le Parti
national religieux, favorable à la colonisation des Territoires palestiniens, et
le Shass.
À l'issue de longs et délicats marchandages, E.
Barak a formé une très
large coalition juive - les partis arabes en étant exclus - pour négocier avec
les Palestiniens et la Syrie.
Dès l'été, il s'est employé à relancer le processus diplomatique, tout en
maintenant le flou sur ses intentions.
Après avoir fait la promesse de conclure
la paix avec tous les voisins arabes d'Israël, il s'est uniquement engagé à
retirer ses troupes du Sud-Liban avant le 7 juillet 2000, si possible dans le
cadre d'un accord plus large avec la Syrie, sans qui rien ne se fait au "pays du
Cèdre".
Le 4 septembre 1999, à Charm el-Cheikh (Sinaï égyptien), il a signé un
nouvel arrangement avec l'OLP (Organisation de libération de la Palestine), le
sixième, qui reprend, moyennant quelques modifications, le mémorandum de Wye
Plantation gelé par B.
Netanyahou.
Principale nouveauté : les deux parties se
sont accordé un an pour aboutir à un traité de paix définitif et cinq mois pour
en fixer les grandes lignes dans un accord-cadre.
Y.
Arafat, qui se félicitait
de disposer enfin d'un "partenaire", a vite changé de ton et dénoncé les
lenteurs et les atermoiements du Premier ministre travailliste.
Ce dernier semblait préférer courtiser le président syrien Hafez el-Assad,
recherchant en priorité la paix avec la Syrie et par voie de conséquence avec le
Liban, qui lui ouvrirait les portes des pays du Golfe et permettrait d'isoler Y.
Arafat.
Mais les négociations avec la Syrie, qui ont repris à Washington, le 15
décembre 1999, après près de quatre ans d'interruption, ont été suspendues un
mois plus tard, le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk el-Charah, et
E.
Barak n'étant pas parvenus à trouver un compromis territorial.
Le premier
exigeait un retour à la situation du 4 juin 1967, juste avant le début des
hostilités entre les deux pays et la conquête du Golan par Tsahal (armée
israélienne), tandis que le second refusait de retirer ses troupes au-delà de la
frontière internationale établie en 1923 par la France et le Royaume-Uni.
Quelques centaines de mètres séparent les deux lignes, mais l'enjeu porte sur le
contrôle du lac de Tibériade, qui assure plus du tiers des besoins en eau
d'Israël.
L'échec des tractations avec la Syrie allait forcer l'armée israélienne à
quitter le Sud-Liban plus tôt que prévu et sans la moindre garantie de sécurité.
Sur le terrain, la situation devenait de plus en plus intenable à l'approche de
son départ.
Suivant la méthode appliquée une première fois par B.
Netanyahou le
25 juin 1999, E.
Barak a ordonné, le 7 février 2000, après la mort de six
soldats israéliens, le bombardement de trois centrales électriques, sans pour
autant mettre un terme aux attaques du Hezbollah, le mouvement islamiste chiite.
Tsahal a dû achever son retrait le 24 mai 2000 avec six semaines d'avance sur
son calendrier du fait de l'effondrement de sa milice supplétive, l'ALS (Armée
du Liban-Sud).
Dans les semaines suivantes, le calme a régné le long de la
frontière, le Hezbollah se contentant de célébrer sa victoire dans le calme.
La mort, le 11 juin, de H.
el-Assad semblait interdire une reprise rapide des
pourparlers de paix.
Le successeur, son fils Bachar, devait asseoir son pouvoir
avant d'envisager une quelconque initiative diplomatique.
Conformément au principe des vases communicants, le blocage du volet syrien a
aussitôt entraîné une relance des pourparlers israélo-palestiniens.
Les deux
délégations se sont retrouvées à Washington à partir du 21 mars 2000, date à
laquelle l'armée israélienne a procédé à un troisième retrait de Cisjordanie au
terme de l'accord de Charm el-Cheikh.
L'Autorité palestinienne contrôlait à
cette date directement ou indirectement 40 % de la Cisjordanie et un peu plus de
60 % de la bande de Gaza.
Les territoires sur lesquels elle exerçait son pouvoir
demeuraient toutefois enclavés, malgré l'ouverture, le 25 octobre 1999, d'un
couloir de circulation entre la bande de Gaza et la Cisjordanie.
À l'approche
d'une probable déclaration de l'État palestinien le 13 septembre 2000, les
négociations entre Y.
Arafat et E.
Barak à Camp David, à partir du 11 juillet,
continuaient de buter sur la question de Jésuralem et sur celle de l'avenir des
réfugiés palestiniens.
En revanche, la construction dans les colonies juives
s'est poursuivie à un rythme aussi soutenu que du temps du gouvernement Likoud.
Voulant éviter d'engager le fer avec les ultra-nationalistes pendant les
négociations de paix, E.
Barak s'était contenté de démanteler, avec l'accord des
dirigeants colons, une poignée d'implantations sauvages.
Sa coalition, qui additionnait les contraires et mêlait religieux et laïcs,
colombes et faucons, a fini par voler en éclats.
Le départ des ministres du
Meretz, bêtes noires des rabbins, n'a pas empêché celui des ultra-orthodoxes du
Shass dès l'annonce de la tenue du sommet de Camp David.
Hostiles à tout abandon
du rêve du "Grand Israël", le Parti national religieux et Israël Be Aliya ont
quitté à leur tour la coalition.
En plein marchandage diplomatique, E.
Barak ne
disposait plus que du soutien de 42 députés sur 120.
Fin de l'isolement diplomatique
Le bilan de l'année 1999-2000 à l'intérieur était tout aussi contrasté.
Le pays
a continué de s'enfoncer dans la crise économique (pour la cinquième année
consécutive).
Le taux de chômage a atteint 9 % fin 1999, 18 % de la population
vivant au-dessous du seuil de pauvreté.
E.
Barak, après un an de pouvoir,
pouvait tout de même se prévaloir d'un grand succès : il a rompu l'isolement
diplomatique dont souffrait son pays sous le mandat de B.
Netanyahou.
Du "numéro
deux" chinois, Li Peng, au pape Jean-Paul II, en passant par le Premier ministre
français Lionel Jospin, les dignitaires étrangers se sont à nouveau succédé en
Israël.
La normalisation a repris avec le Maghreb (Tunisie et Maroc) et des pays
du Golfe (Oman et le Qatar).
Un rapprochement a été entamé avec l'Algérie.
Mais
l'ouverture vers le monde arabe est restée tributaire de la poursuite du
processus de paix.
la plus à droite de sa coalition ne lui a pas pardonné l'accord
israélo-palestinien dit "de Wye Plantation" conclu le 23 octobre 1998 avec le
président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat.
Le texte qui prévoit le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓