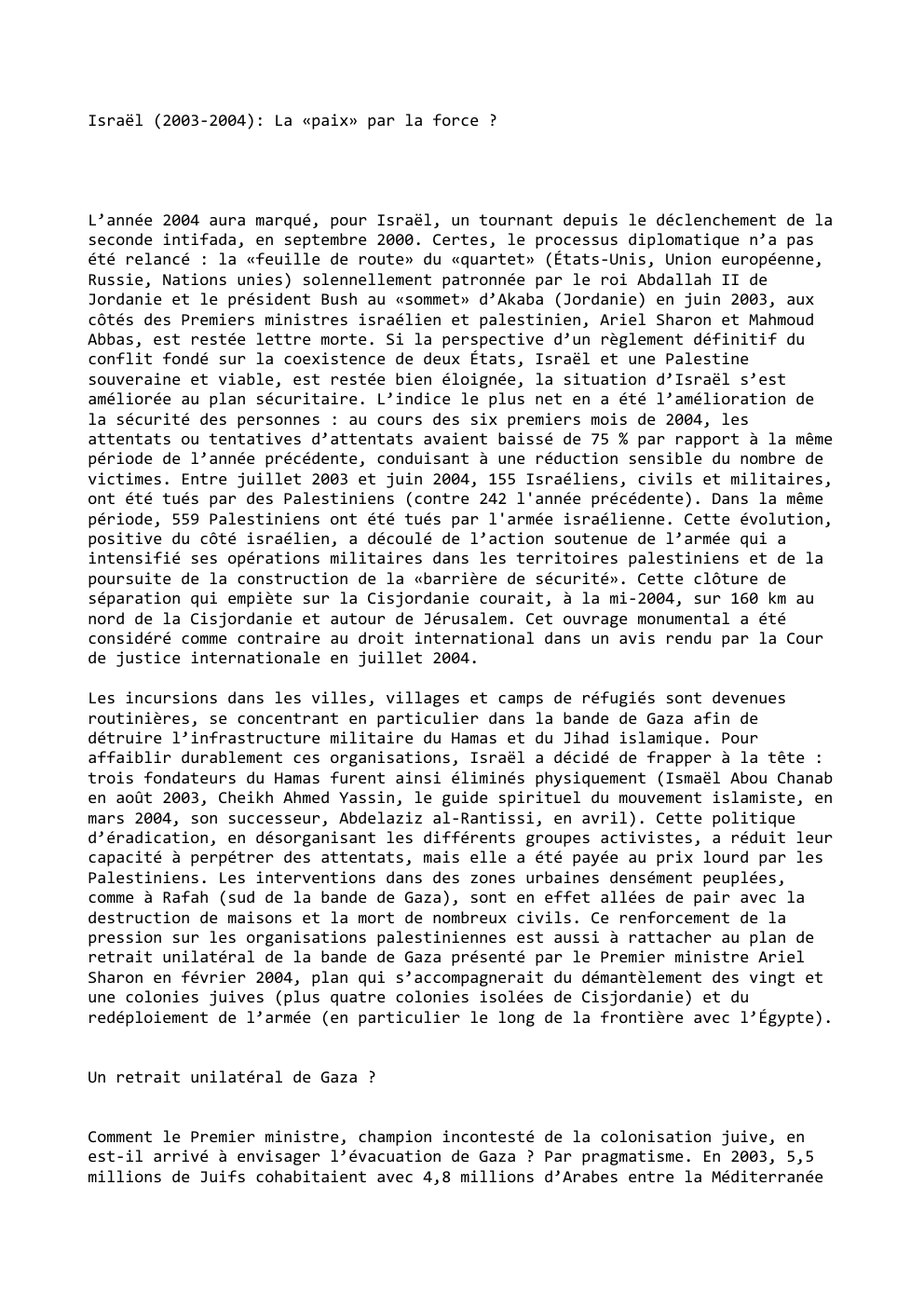Israël (2003-2004): La «paix» par la force ? L’année 2004 aura marqué, pour Israël, un tournant depuis le déclenchement de...
Extrait du document
«
Israël (2003-2004): La «paix» par la force ?
L’année 2004 aura marqué, pour Israël, un tournant depuis le déclenchement de la
seconde intifada, en septembre 2000.
Certes, le processus diplomatique n’a pas
été relancé : la «feuille de route» du «quartet» (États-Unis, Union européenne,
Russie, Nations unies) solennellement patronnée par le roi Abdallah II de
Jordanie et le président Bush au «sommet» d’Akaba (Jordanie) en juin 2003, aux
côtés des Premiers ministres israélien et palestinien, Ariel Sharon et Mahmoud
Abbas, est restée lettre morte.
Si la perspective d’un règlement définitif du
conflit fondé sur la coexistence de deux États, Israël et une Palestine
souveraine et viable, est restée bien éloignée, la situation d’Israël s’est
améliorée au plan sécuritaire.
L’indice le plus net en a été l’amélioration de
la sécurité des personnes : au cours des six premiers mois de 2004, les
attentats ou tentatives d’attentats avaient baissé de 75 % par rapport à la même
période de l’année précédente, conduisant à une réduction sensible du nombre de
victimes.
Entre juillet 2003 et juin 2004, 155 Israéliens, civils et militaires,
ont été tués par des Palestiniens (contre 242 l'année précédente).
Dans la même
période, 559 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne.
Cette évolution,
positive du côté israélien, a découlé de l’action soutenue de l’armée qui a
intensifié ses opérations militaires dans les territoires palestiniens et de la
poursuite de la construction de la «barrière de sécurité».
Cette clôture de
séparation qui empiète sur la Cisjordanie courait, à la mi-2004, sur 160 km au
nord de la Cisjordanie et autour de Jérusalem.
Cet ouvrage monumental a été
considéré comme contraire au droit international dans un avis rendu par la Cour
de justice internationale en juillet 2004.
Les incursions dans les villes, villages et camps de réfugiés sont devenues
routinières, se concentrant en particulier dans la bande de Gaza afin de
détruire l’infrastructure militaire du Hamas et du Jihad islamique.
Pour
affaiblir durablement ces organisations, Israël a décidé de frapper à la tête :
trois fondateurs du Hamas furent ainsi éliminés physiquement (Ismaël Abou Chanab
en août 2003, Cheikh Ahmed Yassin, le guide spirituel du mouvement islamiste, en
mars 2004, son successeur, Abdelaziz al-Rantissi, en avril).
Cette politique
d’éradication, en désorganisant les différents groupes activistes, a réduit leur
capacité à perpétrer des attentats, mais elle a été payée au prix lourd par les
Palestiniens.
Les interventions dans des zones urbaines densément peuplées,
comme à Rafah (sud de la bande de Gaza), sont en effet allées de pair avec la
destruction de maisons et la mort de nombreux civils.
Ce renforcement de la
pression sur les organisations palestiniennes est aussi à rattacher au plan de
retrait unilatéral de la bande de Gaza présenté par le Premier ministre Ariel
Sharon en février 2004, plan qui s’accompagnerait du démantèlement des vingt et
une colonies juives (plus quatre colonies isolées de Cisjordanie) et du
redéploiement de l’armée (en particulier le long de la frontière avec l’Égypte).
Un retrait unilatéral de Gaza ?
Comment le Premier ministre, champion incontesté de la colonisation juive, en
est-il arrivé à envisager l’évacuation de Gaza ? Par pragmatisme.
En 2003, 5,5
millions de Juifs cohabitaient avec 4,8 millions d’Arabes entre la Méditerranée
et le Jourdain, les deux populations devant sous peu être à parité en l’absence
de vague migratoire massive provenant de la diaspora.
Israël se trouverait dès
lors dans une situation impossible : comment, en effet, préserver un
fonctionnement démocratique normal tout en maintenant une domination militaire
sur 3,5 millions de Palestiniens et en contrôlant 1,3 million de citoyens arabes
en Israël ? Pour sortir de ce piège, la réduction de la pression démographique
est impérieuse, et la bande de Gaza, peuplée de 1,3 million de Palestiniens – au
milieu desquels se trouvent 7 500 colons israéliens –, apparaissait idéale pour
atteindre cet objectif.
Ce plan pourrait-il devenir réalité ? Il bénéficie de
deux atouts.
Le premier est sa popularité : plus des deux tiers des Israéliens
le soutenaient à la mi-2004.
Le second est l’appui que lui a donné en avril le
président George W.
Bush.
Ce dernier a salué un «acte historique et courageux»
et a reconnu de fait, au passage, préalablement à toute négociation, que les
blocs de colonies les plus denses seraient annexés par Israël.
La position
américaine a alimenté une forte crainte chez les Palestiniens, mais aussi chez
les dirigeants européens : celle....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓