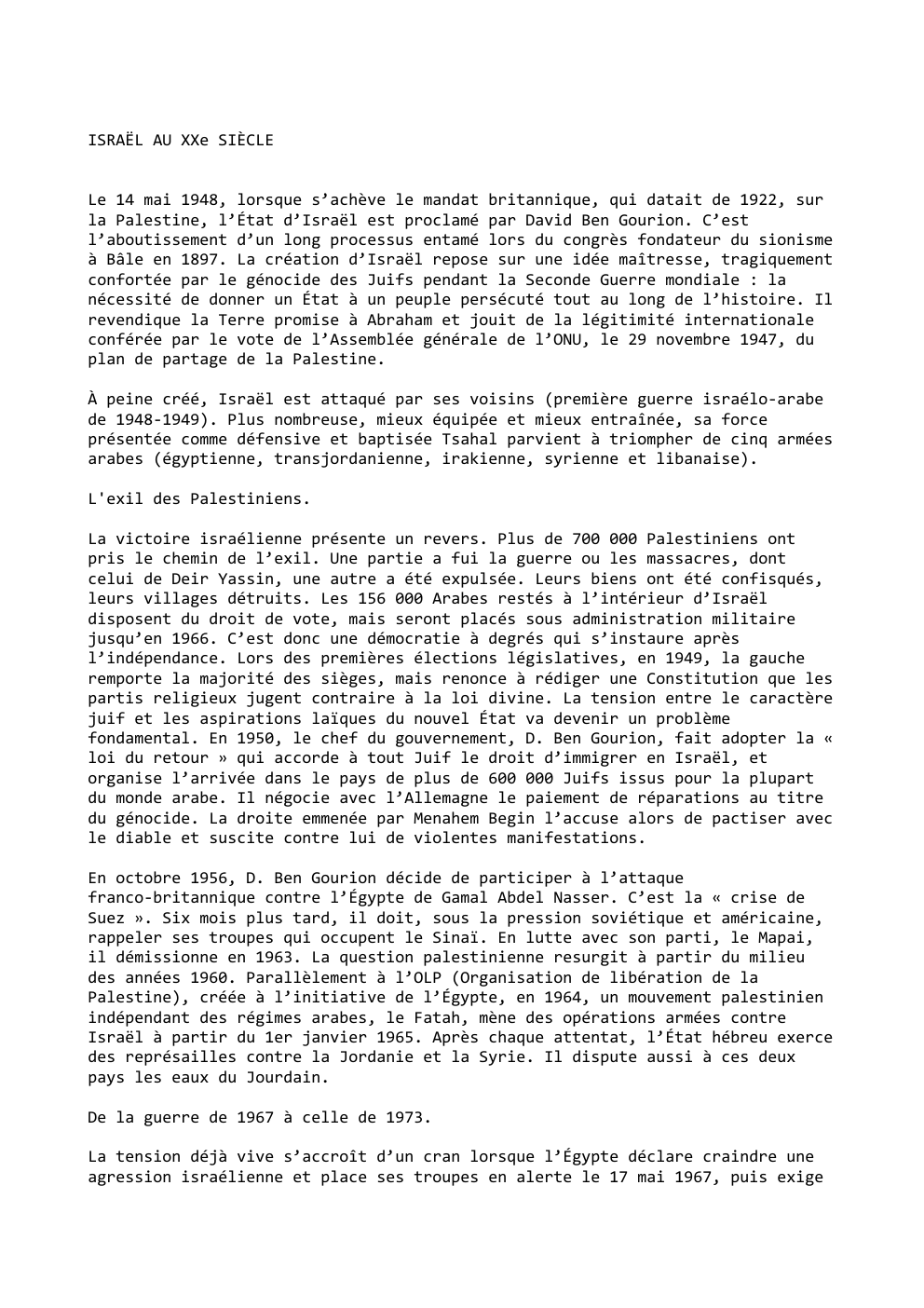ISRAËL AU XXe SIÈCLE Le 14 mai 1948, lorsque s’achève le mandat britannique, qui datait de 1922, sur la Palestine,...
Extrait du document
«
ISRAËL AU XXe SIÈCLE
Le 14 mai 1948, lorsque s’achève le mandat britannique, qui datait de 1922, sur
la Palestine, l’État d’Israël est proclamé par David Ben Gourion.
C’est
l’aboutissement d’un long processus entamé lors du congrès fondateur du sionisme
à Bâle en 1897.
La création d’Israël repose sur une idée maîtresse, tragiquement
confortée par le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale : la
nécessité de donner un État à un peuple persécuté tout au long de l’histoire.
Il
revendique la Terre promise à Abraham et jouit de la légitimité internationale
conférée par le vote de l’Assemblée générale de l’ONU, le 29 novembre 1947, du
plan de partage de la Palestine.
À peine créé, Israël est attaqué par ses voisins (première guerre israélo-arabe
de 1948-1949).
Plus nombreuse, mieux équipée et mieux entraînée, sa force
présentée comme défensive et baptisée Tsahal parvient à triompher de cinq armées
arabes (égyptienne, transjordanienne, irakienne, syrienne et libanaise).
L'exil des Palestiniens.
La victoire israélienne présente un revers.
Plus de 700 000 Palestiniens ont
pris le chemin de l’exil.
Une partie a fui la guerre ou les massacres, dont
celui de Deir Yassin, une autre a été expulsée.
Leurs biens ont été confisqués,
leurs villages détruits.
Les 156 000 Arabes restés à l’intérieur d’Israël
disposent du droit de vote, mais seront placés sous administration militaire
jusqu’en 1966.
C’est donc une démocratie à degrés qui s’instaure après
l’indépendance.
Lors des premières élections législatives, en 1949, la gauche
remporte la majorité des sièges, mais renonce à rédiger une Constitution que les
partis religieux jugent contraire à la loi divine.
La tension entre le caractère
juif et les aspirations laïques du nouvel État va devenir un problème
fondamental.
En 1950, le chef du gouvernement, D.
Ben Gourion, fait adopter la «
loi du retour » qui accorde à tout Juif le droit d’immigrer en Israël, et
organise l’arrivée dans le pays de plus de 600 000 Juifs issus pour la plupart
du monde arabe.
Il négocie avec l’Allemagne le paiement de réparations au titre
du génocide.
La droite emmenée par Menahem Begin l’accuse alors de pactiser avec
le diable et suscite contre lui de violentes manifestations.
En octobre 1956, D.
Ben Gourion décide de participer à l’attaque
franco-britannique contre l’Égypte de Gamal Abdel Nasser.
C’est la « crise de
Suez ».
Six mois plus tard, il doit, sous la pression soviétique et américaine,
rappeler ses troupes qui occupent le Sinaï.
En lutte avec son parti, le Mapai,
il démissionne en 1963.
La question palestinienne resurgit à partir du milieu
des années 1960.
Parallèlement à l’OLP (Organisation de libération de la
Palestine), créée à l’initiative de l’Égypte, en 1964, un mouvement palestinien
indépendant des régimes arabes, le Fatah, mène des opérations armées contre
Israël à partir du 1er janvier 1965.
Après chaque attentat, l’État hébreu exerce
des représailles contre la Jordanie et la Syrie.
Il dispute aussi à ces deux
pays les eaux du Jourdain.
De la guerre de 1967 à celle de 1973.
La tension déjà vive s’accroît d’un cran lorsque l’Égypte déclare craindre une
agression israélienne et place ses troupes en alerte le 17 mai 1967, puis exige
le départ de la force d’urgence des Nations unies déployée dans le Sinaï et à
Gaza et, enfin, ferme le golfe d’Akaba aux bateaux israéliens (22 mai).
L’État-Major de Tsahal, favorable à une attaque préventive, entre en conflit
avec Levi Eshkol (1895-1969), le successeur de D.
Ben Gourion, qui, à la demande
des États-Unis, prône la retenue.
Lorsque, le 31 mai, la Jordanie rejoint le
pacte militaire syro-égyptien, les partisans de la guerre, en Israël,
l’emportent.
Le 1er juin, L.
Eshkol forme un cabinet d’union nationale avec le
général Moshe Dayan (1915-1981) à la Défense.
Le 5 juin, Tsahal frappe tour à
tour l’Égypte, la Jordanie et la Syrie et s’empare en six jours du Sinaï, de
Gaza, de la Cisjordanie et du Golan.
Cette guerre restera dans l’histoire comme
celle des Six-Jours.
Israël qui s’identifiait à David, face à un Goliath arabe, devient une puissance
occupante qui tient entre ses mains le sort d’un autre peuple.
Un million de
Palestiniens se retrouve sous sa domination.
300 000 habitants de Gaza et de
Cisjordanie ont rejoint la masse des réfugiés.
La conquête des sites les plus
sacrés du judaïsme suscite au sein du sionisme la montée d’un courant
messianique.
Les jeunes du Parti national religieux forment le Goush Emounim
(Bloc de la foi) et entament la colonisation des Territoires occupés
palestiniens au nom de la Torah.
Le Premier ministre Golda Meir rejette les solutions diplomatiques, notamment le
plan Rogers présenté par les États-Unis.
Elle ne voit pas venir la montée des
périls ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.
Les Palestiniens, selon elle, «
n’existent pas » plus que le clivage entre Séfarades (Juifs orientaux) et
Ashkénazes (Juifs européens).
« Ce ne sont pas de gentils....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓