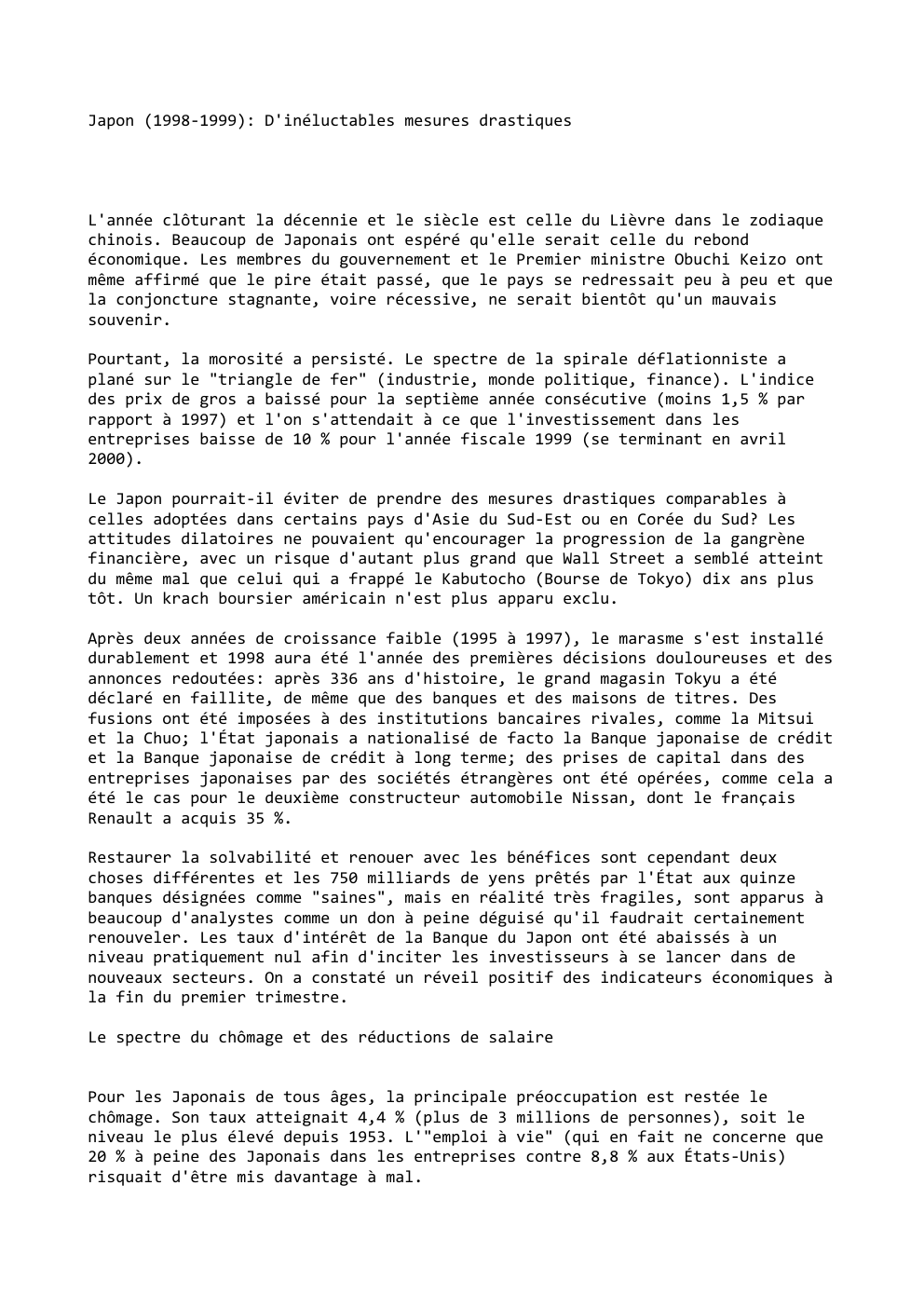Japon (1998-1999): D'inéluctables mesures drastiques L'année clôturant la décennie et le siècle est celle du Lièvre dans le zodiaque chinois....
Extrait du document
«
Japon (1998-1999): D'inéluctables mesures drastiques
L'année clôturant la décennie et le siècle est celle du Lièvre dans le zodiaque
chinois.
Beaucoup de Japonais ont espéré qu'elle serait celle du rebond
économique.
Les membres du gouvernement et le Premier ministre Obuchi Keizo ont
même affirmé que le pire était passé, que le pays se redressait peu à peu et que
la conjoncture stagnante, voire récessive, ne serait bientôt qu'un mauvais
souvenir.
Pourtant, la morosité a persisté.
Le spectre de la spirale déflationniste a
plané sur le "triangle de fer" (industrie, monde politique, finance).
L'indice
des prix de gros a baissé pour la septième année consécutive (moins 1,5 % par
rapport à 1997) et l'on s'attendait à ce que l'investissement dans les
entreprises baisse de 10 % pour l'année fiscale 1999 (se terminant en avril
2000).
Le Japon pourrait-il éviter de prendre des mesures drastiques comparables à
celles adoptées dans certains pays d'Asie du Sud-Est ou en Corée du Sud? Les
attitudes dilatoires ne pouvaient qu'encourager la progression de la gangrène
financière, avec un risque d'autant plus grand que Wall Street a semblé atteint
du même mal que celui qui a frappé le Kabutocho (Bourse de Tokyo) dix ans plus
tôt.
Un krach boursier américain n'est plus apparu exclu.
Après deux années de croissance faible (1995 à 1997), le marasme s'est installé
durablement et 1998 aura été l'année des premières décisions douloureuses et des
annonces redoutées: après 336 ans d'histoire, le grand magasin Tokyu a été
déclaré en faillite, de même que des banques et des maisons de titres.
Des
fusions ont été imposées à des institutions bancaires rivales, comme la Mitsui
et la Chuo; l'État japonais a nationalisé de facto la Banque japonaise de crédit
et la Banque japonaise de crédit à long terme; des prises de capital dans des
entreprises japonaises par des sociétés étrangères ont été opérées, comme cela a
été le cas pour le deuxième constructeur automobile Nissan, dont le français
Renault a acquis 35 %.
Restaurer la solvabilité et renouer avec les bénéfices sont cependant deux
choses différentes et les 750 milliards de yens prêtés par l'État aux quinze
banques désignées comme "saines", mais en réalité très fragiles, sont apparus à
beaucoup d'analystes comme un don à peine déguisé qu'il faudrait certainement
renouveler.
Les taux d'intérêt de la Banque du Japon ont été abaissés à un
niveau pratiquement nul afin d'inciter les investisseurs à se lancer dans de
nouveaux secteurs.
On a constaté un réveil positif des indicateurs économiques à
la fin du premier trimestre.
Le spectre du chômage et des réductions de salaire
Pour les Japonais de tous âges, la principale préoccupation est restée le
chômage.
Son taux atteignait 4,4 % (plus de 3 millions de personnes), soit le
niveau le plus élevé depuis 1953.
L'"emploi à vie" (qui en fait ne concerne que
20 % à peine des Japonais dans les entreprises contre 8,8 % aux États-Unis)
risquait d'être mis davantage à mal.
Des multinationales telles que Sony ont annoncé une réduction de 17 000 emplois
d'ici 2003, soit 10 % de l'ensemble des effectifs.
Pour sa part, NEC a supprimé
15 000 postes (10 % environ également).
Hitachi a annoncé quant à lui la
suppression de 4 000 postes, tout en augmentant la durée du travail d'un quart
d'heure par jour et en réduisant les salaires de 5 %.
Kanebo devait lui aussi
sacrifier 10 % de ses effectifs.
La production de véhicules chez Toyota, le
"numéro un" japonais, a baissé de 30 % en 1998 (de 4,2 à moins de 3,2 millions
de véhicules, sur une production nationale inférieure à 6 millions en 1998).
La
chaîne de supermarchés Seyu a annoncé la suppression de 1 000 emplois d'ici 2002
et la compagnie d'électricité de Tokyo 2 000 d'ici 2003.
Dans les petites et moyennes entreprises, le salaire a pu être réduit de 10 % ou
plus.
Les compressions de personnel ont affecté l'emploi des jeunes (seulement
50 postes offerts pour 100 demandes au printemps 1999).
C'est pourquoi le
gouvernement a lancé au début de mars 1999 un plan pour la création de 770 000
nouveaux emplois dans des secteurs tels que la santé et les soins aux personnes
âgées, l'information et les télécommunications, le tourisme et le logement.
Selon les experts, une croissance de 2 % était à attendre pour 2001.
Beaucoup
considéraient qu'il fallait attendre l'horizon 2008 ou 2010 pour que le système
bancaire retrouve un équilibre.
La balance des échanges avec les États-Unis aura
cependant augmenté de plus de 33 % en 1998, ce qui ne pouvait qu'accroître
d'autant les tensions bilatérales.
Pendant combien de temps encore pourront être
ajournés l'inéluctable restructuration du système bancaire et le constat de
faillite des secteurs sinistrés?
Plus largement, de nombreux analystes ont plaidé pour des suppressions d'emplois
et des mises à la retraite anticipée dans les secteurs où la rentabilité
apparaît insuffisante, afin de mieux faire face à la concurrence mondiale.
La
presse s'est régulièrement fait l'écho de plusieurs types de scénario, tel celui
d'augmenter la masse monétaire de 25 % à 30 % pour enrayer une possible
déflation.
Il existe un écart très grand entre les propos rassurants voire incantatoires de
nombreux hommes politiques et spécialistes économiques et les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓