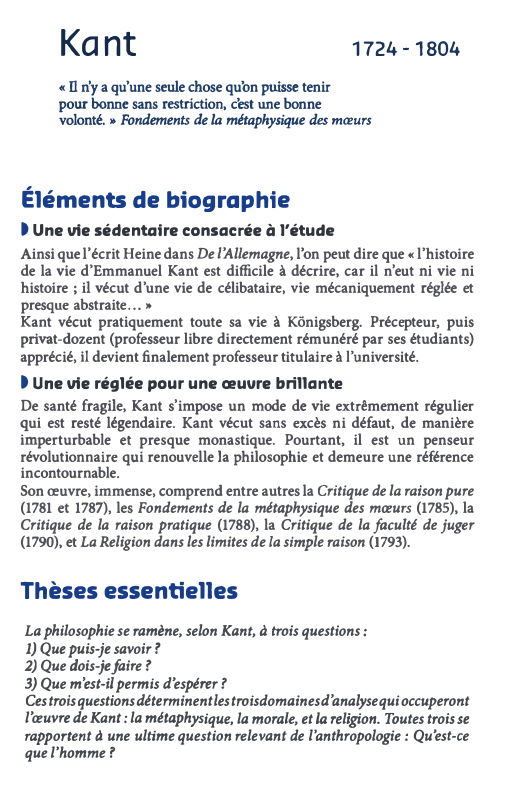Kant 1724-1804 « Il n'y a qu'une seule chose quon puisse tenir pour bonne sans restriction, c'est une bonne volonté....
Extrait du document
«
Kant
1724-1804
« Il n'y a qu'une seule chose quon puisse tenir
pour bonne sans restriction, c'est une bonne
volonté.
» Fondements de la métaphysique des mœurs
Éléments de biographie
t Une uie sédentaire consacrée à l'étude
Ainsi que l'écrit Heine dans De fAllemagne, l'on peut dire que « l'histoire
de la vie d'Emmanuel Kant est difficile à décrire, car il n'eut ni vie ni
histoire ; il vécut d'une vie de célibataire, vie mécaniquement réglée et
presque abstraite ...
»
Kant vécut pratiquement toute sa vie à Kônigsberg.
Précepteur, puis
privat-dozent (professeur libre directement rémunéré par ses étudiants)
apprécié, il devient finalement professeur titulaire à l'université.
t Une uie réglée pour une œuure brillante
De santé fragile, Kant s'impose un mode de vie extrêmement régulier
qui est resté légendaire.
Kant vécut sans excès ni défaut, de manière
imperturbable et presque monastique.
Pourtant, il est un penseur
révolutionnaire qui renouvelle la philosophie et demeure une référence
incontournable.
Son œuvre, immense, comprend entre autres la Critique de la raison pure
(1781 et 1787), les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), la
Critique de la raison pratique (1788), la Critique de la faculté de juger
(1790), et La Religion dans les limites de la simple raison (1793).
Thèses essentielles
La philosophie se ramène, selon Kant, à trois questions :
1) Que puis-je savoir ?
2) Que dois-jefaire ?
3) Que m'est-il permis d'espérer?
Ces trois questions déterminent lestroisdomaines danalyse qui occuperont
l'œuvre de Kant: la métaphysique, la morale, et la religion.
Toutes trois se
rapportent à une ultime question relevant de l'anthropologie : Qu'est-ce
que l'homme?
KANT
t le problème de la connaissance
Réveillé de son sommeil dogmatique par Hume, Kant entreprend
l'analyse de notre pouvoir de connaître : pour déterminer les pouvoirs
et les limites de la raison, il élabore une Critique de la raison pure.
La science progresse, alors que la métaphysique, qui analyse ce qui
n'est pas objet d'expérience (l'âme, le monde, Dieu et la liberté), est
un « champ de bataille » où se livrent des combats sans fin.
Face à ce
constat, il faut interroger le statut de la métaphysique et la légitimité de
nos connaissances.
Deux écoles de pensée s'affrontent.
Le rationalisme dogmatique
affirme que la raison humaine peut tout connaître en droit, et que la
vérité est l'adéquation entre notre représentation des choses et ce que
sont les choses objectivement.
Au contraire, l'empirisme sceptique
affirme que nos représentations sont issues de l'expérience, que nous
ne pouvons en sortir pour appréhender les choses en soi, et qu'il est
illusoire de prétendre détenir une vérité certaine.
t la révolution copernicienne
Alternative au rationalisme et à l'empirisme, le criticisme kantien opère
une révolution copernicienne dans la théorie de la connaissance :
Copernic avait inversé les places respectives du Soleil et de la Terre en
affirmant l'héliocentrisme.
De même, selon Kant, dans la connaissance,
ce n'est pas le sujet qui tourne autour de l'objet, mais l'objet qui se règle
sur le sujet.
En effet, s'opposant au réalisme qui admet que l'objet nous est donné,
et que notre connaissance doit se modeler sur lui, Kant montre que
l'esprit est actif dans l'élaboration de la connaissance.
Le réel est pour
nous une construction : « nous ne connaissons a priori des choses
que ce que nous y mettons nous-mêmes ».
L'objet est perçu par nous
selon la structure de notre esprit, et non pas en soi (en tant que chose
indépendante de notre manière de l'appréhender).
t Matière et forme de la connaissance
La connaissance des objets dépend du sujet connaissant au moins
autant que de l'objet connu.
Elle suppose certes l'expérience, comme
l'affirment les empiristes, mais cette expérience ne saurait exister
sans une synthèse, une mise en forme opérée par le sujet : « si toutes
nos connaissances commencent avec l'expérience, il n'en résulte pas
qu'elles dérivent toutes de l'expérience » (Critique de la raison pure).
Connaître, c'est mettre en forme une matière donnée.
Il faut donc
distinguer la matière de la connaissance, qui est a posteriori (elle
dépend de l'objet de l'expérience), et la forme de la connaissance, qui
est a priori (elle dépend du sujet et est antérieure à toute expérience).
• 142
Le XVIII' siècle
• Sensibilité et entendement
Tout objet connu ou connaissable est appréhendé dans l'espace et le
temps par la sensibilité.
Or, espace et temps ne sont ni des concepts
empiriques (qui dérivent de l'expérience : ce ne sont pas des propriétés
externes des choses), ni des concepts de l'entendement : ce sont des
formes a priori de la sensibilité, des cadres qui conditionnent la
perception des objets.
Temps et espace sont des intuitions pures, ils
structurent et conditionnent toute perception en tant qu'ils sont a
priori (non dérivés de l'expérience).
Dans la connaissance, les objets se règlent également sur le!l concepts
a priori de notre entendement, les catégories qui sont les structures
logiques de la pensée (par exemple le concept de causalité).
L'objet est donc d'une part donné à la sensibilité par l'intuition sensible,
et d'autre part pensé par l'entendement et ses concepts.
• les limites de la connaissance
Nous ne pouvons connaître que les phénomènes, les objets tels que
nous les présente notre faculté de connaître.
Mais ni les choses en soi
(les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes, indépendamment de
la connaissance humaine), ni les noumènes (les réalités intelligibles,
les idées métaphysiques telles que Dieu, l'âme, ou encore le monde) ne
sont connaissables.
La connaissance est subjective, non pas relative, elle ne vaut pas que
pour l'individu, mais elle dépend néanmoins du sujet connaissant
compris comme universel.
L'objectivité caractérise une représentation
universellement valable, mais limitée à la saisie des phénomènes.
L'idéalisme transcendantal kantien pose donc que tout objet de
connaissance est déterminé a priori par la nature même de notre
faculté de connaître, tout en se distinguant de l'idéalisme de Berkeley,
puisqu'il affirme l'existence, en dehors de la perception, d'une réalité
externe insaisissable en tant que telle par l'esprit humain.
• le statut de la métaphysique
Les objets de la métaphysique (l'âme, Dieu, le monde, la liberté) ne
peuvent être connus : ce sont de pures idées non expérimentables.
La
raison, faculté de désirer, erre dès lors qu'elle occulte ses limites et veut
conférer l'existence à ce qui n'est qu'idée.
Les illusions naissent d'un
usage illégitime de la raison.
La métaphysique ne produit que des pensées, non des connaissances :
elle s'égare lorsqu'elle croit connaît re ce qu'elle ne peut que penser.
« La connaissance suppose en effet deux éléments: d'abord le concept,
par lequel, en général, un objet est pensé (la catégorie), et ensuite,
l'intuition par laquelle il est donné » (Critique de la raison pure).
143 •
Cependant, les idées de la métaphysique sont régulatrices : elles orientent
notre effort pour connaître vers une exigence de systématisation et
d'unité.
t les postulats de la ratson pratique
La métaphysique joue donc un rôle dans le domaine pratique.
Les idées
acquièrent le statut de postulats nécessaires de la raison pratique: des
idées qu'il faut admettre, sans pour autant pouvoir les prouver, afin de
rendre possible la morale et de donner sens à la vie.
Nous ne pouvons prouver l'existence de la liberté: l'analyse de cette
idée mène à une antinomie.
Deux thèses contradictoires s'affrontent
sans que l'on puisse trancher pour l'une plus que pour l'autre.
Si, comme
le montre la science, le monde paraît déterminé, et si la liberté semble
n'être qu'illusion, il est cependant nécessaire d'admettre l'existence de
la liberté, d'une cause première, afin de rendre compte des phénomènes.
Puisque l'on ne peut ni nier ni prouver l'existence de la liberté, il faut
la postuler, sans quoi l'on ne pourrait concevoir la possibilité de
l'autonomie de la volonté.
t Moraltté et légalité
ttre moral, ce n'est pas chercher son bonheur, mais être autonome, obéir
aux lois que l'on s'est soi-même données : non à n'importe quelle loi qui
résulterait de la sensibilité ou de l'affect, mais aux lois universelles et
inconditionnées de la raison pratique.
L'action moralement bonne est d'abord l'action désintéressée, l'action
accomplie avec bonne volonté, par pur respect pour la loi morale,
indépendamment de tout mobile sensible.
Il faut donc distinguer la
légalité de l'action et la moralité de l'action: est légale l'action qui est
conforme au devoir, mais elle peut être immorale si elle est accomplie
en vue d'intérêts sensibles (par exemple, un commerçant honnête qui
ne l'est que parce qu'il sait qu'il ne peut garder ses clients qu'à ce prix);
est morale l'action qui n'est accomplie que par devoir, par seul respect
pour la loi morale.
t l'impératif catégorique
Parmi les impératifs (commandements qui guident nos actions), certains
sont hypothétiques.
Ils renvoient à des fins particulières, et prennent la
forme suivante : « si tu veux ceci, alors tu dois faire cela ».
Conditionnés,
de tels impératifs ne revêtent pas la forme d'impératifs moraux.
L'impératif est catégorique, en revanche, et purement moral lorsqu'il
prend la forme suivante : « tu dois », et ce, quelles que soient les
circonstances.
Inconditionné, il exprime l'universalité de la loi morale.
Le premier impératif catégorique est : « Agis comme si la maxime
de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de
la nature.
» Le mensonge, même efficace, pour sauver quelqu'un par
exemple, est immoral : la maxime de l'action, pour être morale, doit
être universalisable sans contradiction.
Or, vouloir que tous les hommes
mentent serait contradictoire.
La morale suppose de concevoir l'homme comme un être raisonnable,
digne, respectable en tant que personne.
Ainsi, la seconde formulation
de l'impératif catégorique appelle au respect:« Agis de telle sorte que tu
traites l'humanité aussi bien dans....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓