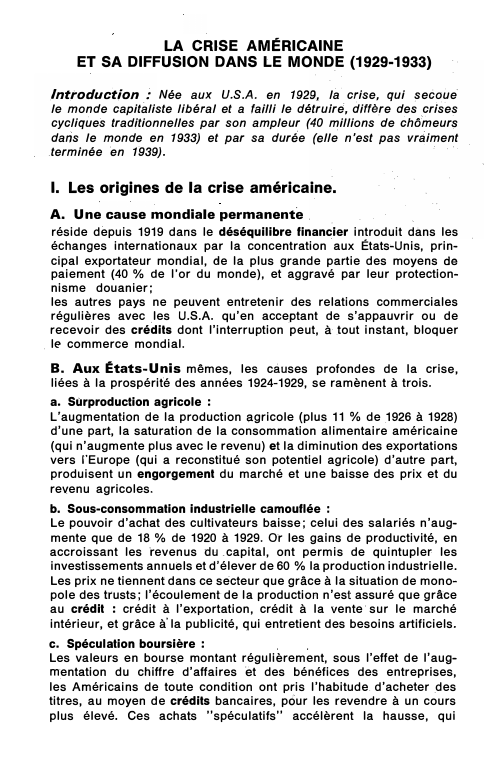LA CRISE AMÉRICAINE ET SA DIFFUSION DANS LE MONDE (1929-1933) Introduction : Née aux U.S.A. en 1929, la crise, qui...
Extrait du document
«
LA CRISE AMÉRICAINE
ET SA DIFFUSION DANS LE MONDE (1929-1933)
Introduction : Née aux U.S.A.
en 1929, la crise, qui secoue
le monde capitaliste libéral et a failli le détruire, diffère des crises
cycliques traditionnelles par son ampleur (40 millions de chômeur/!/
dans le monde en 1933) et par sa durée (elle n'est pas vraiment
terminée en 1939).
1.
Les origines de la crise américaine.
A.
Une cause mondiale permanente
réside depuis 1919 dans le déséquilibre financier introduit dans les
échanges internationaux par la concentration aux États•Unis, prin
cipal exportateur mondial, de la plus grande partie des moyens de
paiement (40 % de l'or du monde), et aggravé par leur protection
nisme douanier;
les autres pays ne peuvent entretenir des relations commerciales
régulières avec .les U.S.A.
qu'en acceptant de s'appauvrir ou de
recevoir des crédits dont l'interruption peut, à tout instant, bloquer
.
le commerce mondial.
B.
Aux États-Unis mêmes, les causes profondes de la crise,
liées à la prospérité des années 1924-1929, se ramènent à trois.
a.
Sùrproduclion agricole :
L'augmentation de la production agricole (plus 11 % de .1926 à 1928)
d'une part, la saturation de la consommation alimentaire américaine
(qui n'augmente plus avec le revenu) et la diminution des exportations
vers l'Europe (qui a reconstitué son potentiel agricole) d'autre part,
produisent un engorgement du marché et une baisse des prix et du
revenu agricoles.
b.
Sous-consommation industrielle camouflée :
Le pouvoir d'achat des cultivateurs baisse; celui des salariés n'aug
mente que de 18 % de 1920 à 1929.
Or les gains de productivité, en
accroissant les revenus du .capital, ont permis de quintupler les
investissements annuels et d'élever de 60 % la production industrielle.
Les prix ne tiennent dans ce secteur que grâce à la situation de mono
pole des trusts; l'écoulement de la production n'est assuré que grâce
au crédit : crédit à l'exportation, crédit à la vente· sur le marché
intérieur, et grâce à' la publicité, qui entretient des besoins artificiels.
c.
Spéculation boursière :
.
.
Les valeurs en bours.e montant régulièrement, sous l'effet de l'aug
mentation du chiffre d'affaires ët des bénéfices des entreprises,
les Américains de to1.1te condition ont pris l'habitude.
d'acheter .des
titres, au moyen de crédits bancaires, péur les revendre à un cours
plus élevé.
Ces achats "spéculatifs" accélèrent la hausse, qui
devient artificielle : les titres cotés à Wall Street atteignent une
valeur globale de 87 milliards de dollars en octobre 1929, contre
27 milliards en 1925; de toute évidence la valeur des entreprises
qu'ils représentent n'a pas été multipliée par 3,5 en quatre ans.
Ce sont les bénéfices de la bourse qui permettent de rembouser les
crédits à la consommation : échafaudage de crédit fragile, puisqu'il
repose sur la hausse.
factice des actions.
Il.
Les manifestations de la crise aux États-Unis.
A.
Le "Krach de Wall Street".
La tendance à la hausse s'inverse le 22 octobre 1929, et la baisse
prend des proportions de catastrophe le jeudi 24 (black thursday);
la baisse moyenne, 25 % au 1er janvier 1930, atteindra pour certaines
actions 90 % (Du Pont de Nemours), 96 % (Chrysler) de 1929 à 1933.
La chute est due à l'afflux massif d'ordres de vente.
a.
Les spéculateurs avertis jugent le moment venu de réaliser.
des
"prises de bénéfices" (la faillite du holding londonien Hatry sept.
1929 -vient de montrer la vulnérabilité des affaires "soufflées").
b.
L'inflation de la demande de crédits auprès des banques (par
les spéculateurs qui veulent ne pas se dessaisir d'actions en hausse
et en acheter d'autres), coïncidant avec d'importantes exportations
de capitaux vers l'étranger, a fait monter le taux moyen de l'intérêt
de 4,06 % en 1927 à 7,6 % en 1929, de sorte que, dans de nombreux
cas, la hausse des actions n'est plus suffisante pour couvrir les frais
des emprunts au jour le jour (call loans); il faut donc vendre.
c.
Phénomène "boule de neige" : les premiers ordres de vente
faisant baisser les actions, tous les porteurs se hâtent de vendre
pour perdre le moins possible.
B.
Les autres manifestations de la crise.
a.
La chute des actions ruine les spéculateurs, arrête les ventes.
à
crédit, place les bénéficiaires de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓