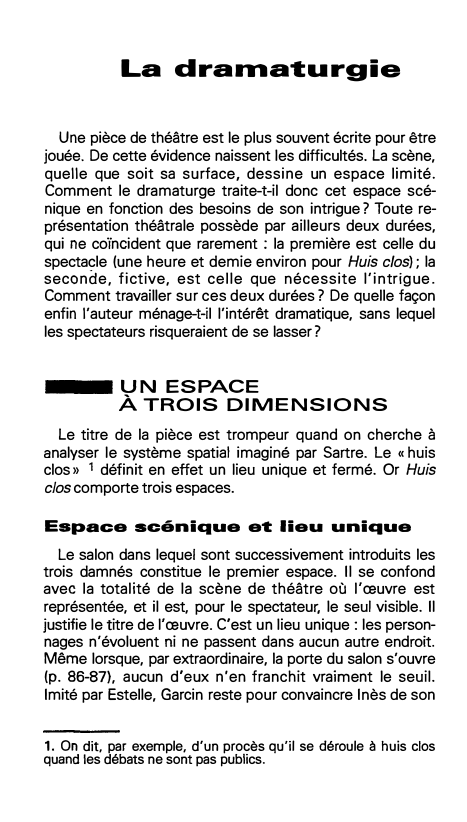La dramaturgie Une pièce de théâtre est le plus souvent écrite pour être jouée. De cette évidence naissent les difficultés....
Extrait du document
«
La dramaturgie
Une pièce de théâtre est le plus souvent écrite pour être
jouée.
De cette évidence naissent les difficultés.
La scène,
quelle que soit sa surface, dessine un espace limité.
Comment le dramaturge traite-t-il donc cet espace scé
nique en fonction des besoins de son intrigue? Toute re
présentation théâtrale possède par ailleurs deux durées,
qui ne coïncident que rarement : la première est celle du
spectacle (une heure et demie environ pour Huis clos); la
seconde, fictive, est celle que nécessite l'intrigue.
Comment travailler sur ces deux durées? De quelle façon
enfin l'auteur ménage-t-il l'intérêt dramatique, sans lequel
les spectateurs risqueraient de se lasser?
UN ESPACE
À TROIS DIMENSIONS
Le titre de la pièce est trompeur quand on cherche à
analyser le système spatial imaginé par Sartre.
Le « huis
clos » 1 définit en effet un lieu unique et fermé.
Or Huis
clos comporte trois espaces.
Espace scénique et lieu unique
Le salon dans lequel sont successivement introduits les
trois damnés constitue le premier espace.
Il se confond
avec la totalité de la scène de théâtre où l'œuvre est
représentée, et il est, pour le spectateur, le seul visible.
Il
justifie le titre de l'œuvre.
C'est un lieu unique: les person
nages n'évoluent ni ne passent dans aucun autre endroit.
Même lorsque, par extraordinaire, la porte du salon s'ouvre
(p.
86-87), aucun d'eux n'en franchit vraiment le seuil.
Imité par Estelle, Garein reste pour convaincre Inès de son
1.
On dit.
par exemple, d'un procès qu'il se déroule à huis clos
quand les débats ne sont pas publics.
(supposé) héroïsme.
C'est en outre un lieu clos, qui fonctionne comme un piège.
Le trio est condamné à y vivre
éternellement.
L'absence de fenêtres, privant de toute vue
sur l'extérieur, accentue la sensation de clôture.
L'espace de l'enfer
au-delà du lieu scénique
Un deuxième lieu, englobant le premier, existe pourtant.
Le salon n'est en effet qu'une partie de l'enfer qui est, lui,
beaucoup plus vaste.
C'est un espace invisible aux spectateurs et inconnu de Garein, d'Estelle et d'Inès.
Une des
fonctions du « garçon d'étage» est d'en suggérer la réalité
et l'immensité.
On reprendra ici les informations données
dans le chapitre 7 sur le caractère inquiétant de la topographie (voir ci-dessus, p.
50).
Grâce à deux procédés simples, cet espace en principe
inimaginable devient concevable.
D'une part, l'enfer apparaît comme une reproduction sans fin du salon, qui en est
l'unité de base: « Il y a d'autres chambres et d'autres couloirs et des escaliers» (p.
19).
D'autre part, les damnés
proviennent de la terre entière.
À chaque peuple correspond un mobilier particulier (p.
14).
Par le procédé de la
multiplication à l'identique et par celui de l'expansion démographique, se trouve ainsi suggérée l'idée d'un infernal
infini.
L'espace terrestre
et le lieu scénique
Le troisième et dernier lieu est celui de la Terre.
Si
Sartre prend bien soin de ne pas localiser l'enfer et s'il le
situe dans un ailleurs indéterminé, des liens visuels ne
s'en établissent pas moins entre l'enfer et la Terre.
L'une
des sources du fantastique, a-t-on déjà noté (voir ci-dessus, p.
52), réside dans la faculté provisoire qu'ont les personnages d'observer ce qui se passe ici-bas.
Chacun d'eux
décrit les activités de ceux qu'ils ont laissés en mourant.
Garein aperçoit sa femme s'éloigner de la caserne où il fut
fusillé, et marcher « toute noire dans la rue déserte»
(p.
32); puis, il voit la salle de rédaction, où il était journaliste (p.
33).
Inès contemple la chambre qu'elle occupait
74
avec Florence (p.
55).
Estelle observe la danse de Pierre et
d'Olga (p.
70).
Visibles pour les personnages, ces différents lieux ne le sont pas pour les spectateurs.
Mais ces
derniers, entendant les descriptions qui sont faites de ces
lieux, peuvent se les représenter mentalement.
Par brefs
surgissements, l'espace terrestre interfère avec l'espace
de l'enfer.
Contrairement à ce que le titre de la pièce pourrait laisser croire, le traitement de l'espace s'avère complexe et
très élaboré.
UN TEMPS MUTILÉ
Le chapitre 8 a déjà abordé la manière par laquelle
Sartre réussit l'exploit de suggérer l'éternité dans une
pièce relativement brève.
On s'y reportera pour l'essentiel
(voir ci-dessus, p.
53 à 56).
Comme ce chapitre étudiait les
rapports des personnages avec le temps ou, si l'on préfère, de la subjectivité d'une conscience avec la chronologie 1, il importe de compléter cette analyse par quelques
remarques relevant plus directement de la dramaturgie.
La co·■·ncidence du temps fictif
et du temps réel
Peu nombreuses sont les pièces qui, dans l'histoire du
théâtre,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓