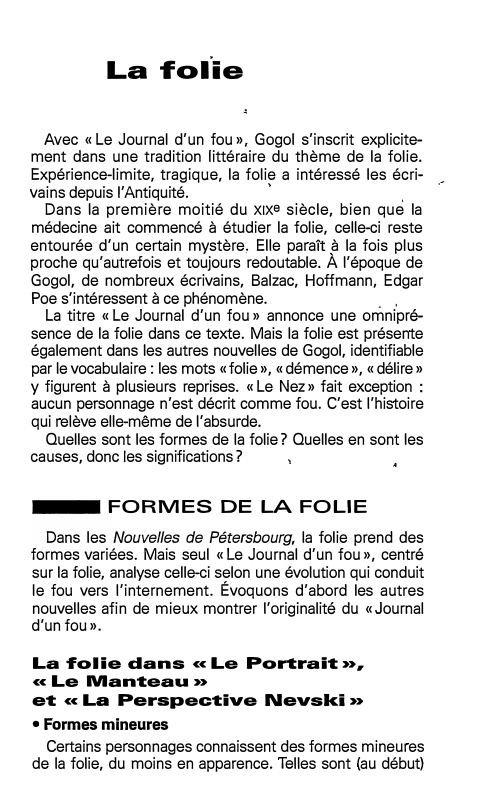La folie Avec « Le Journal d'un fou», Gogol s'inscrit explicite ment dans une tradition littéraire du thème de la...
Extrait du document
«
La folie
Avec « Le Journal d'un fou», Gogol s'inscrit explicite
ment dans une tradition littéraire du thème de la folie.
Expérience-limite, tragique, la folie a intéressé les écrivains depuis !'Antiquité.
Dans la première moitié du x1xe siècle, bien que la
médecine ait commencé à étudier la folie, celle-ci reste
entourée d'un certain mystère, Elle paraît à la fois plus
proche qu'autrefois et toujours redoutable.
À l'époque de
Gogol, de nombreux écrivains, Balzac, Hoffmann, Edgar
Poe s'intéressent à ce phénomène.
.
.
La titre « Le Journal d'un fou» annonce une omnipré
sence de la folie dans ce texte.
Mais la folie est présente
également dans les autres nouvelles de Gogol, identifiable
par le vocabulaire : les mots «folie», «démence», «délire»
y figurent à plusieurs reprises.
« Le Nez» fait exception :
aucun personnage n'est décrit comme fou.
C'est l'histoire
qui relève elle-même de l'absurde.
Quelles sont les formes de la folie? Quelles en sont les
causes, donc les significations?
FORMES DE LA FOLIE
Dans les Nouvelles de Pétersbourg, la folie prend des
formes variées.
Mais seul « Le Journal d'un fou», centré
sur la folie, analyse celle-ci selon une évolution qui conduit
le fou vers l'internement.
Évoquons d'abord les autres
nouvelles afin de mieux montrer l'originalité du «Journal
d'un fou».
La folie dans « Le Portrait»,
« Le Manteau »
et « La Perspective Nevski »
• Formes mineures
Certains personnages connaissent des formes mineures
de la folie, du moins en apparence.
Telles sont (au début)
la « joie délirante» (p.
123) de Tchartkov, invité dans la
haute société, ou celle du « personnage important» du
«Manteau» recevant son titre d'excellence(« ...
son esprit
s'égara», p.
266).
Mais, à moyen terme, Tchartkov, devenu peintre à la
mode, perdra son talent.
Il se sera donc perdu lui-même.
À
court terme, la folie du « personnage important» l'amènera à perdre « tout contrôle sur soi-même » (p.
266) et à
se comporter de façon « insupportable» envers ses inférieurs.
Cette folie provoquera la mort d'Akaki puis sa vengeance posthume.
• La folie furieuse
La perte de soi-même, celle d'autrui, ou les deux, sont
les conséquences de formes de folie furieuse.
Dans « Le Portrait», la folie furieuse domine, que ce soit
celle de Tchartkov ou celle du peintre B***.
Ils en sont
atteints lorsqu'ils ont pris conscience de la perte de leur
talent et deviennent tourmentés par l'envie.
·
Chez Tchartkov ce sont d'abord, devant le chef-d'œuvre
d'un autre peintre, des réactions qui échappent au contrôle
de sa raison : larmes, sanglots (p.
135}.
Puis il gravit un
palier dans la folie par ses actes de vandalisme.
Il se conduit
alors en bête féroce : « Quand il avait payé très cher un
tableau, il [.
,.] se jetait dessus comme un tigre pour le
lacérer, le mettre en pièces, le piétiner en riant de plaisir»
(p.
137).
Enfin cette folie devenue « infernale manie»,
« monstrueuse passion », le transforme aux yeux de son
entourage en démon et en « terrible fléau» (p.
137).
Il
n'est plus lui-même mais agit comme un instrument du
« ciel en courroux» (p.
137).
Dans la seconde partie du «Portrait», la folie furieuse
pousse des personnages vers la persécution, le meurtre
ou la tentative de meurtre.
Tels sont le mécène, avec ses
« effroyables accès de folie furieuse» (p.
148) et le prince
R***.
Seul le père du peintre se domine, après avoir été
dominé par l'envie.
Il retourne son agressivité contre le
portrait maléfique qu'il a lui-même peint: « Il [...
] s'empara
du portrait de l'usurier, réclama un· couteau et fit allumer
du ·feu afin de le couper en morceaux et de le livrer aux
flammes» (p.
155-156).
C'est opposer le feu purificateur
au feu de l'enfer et donc, ici, sortir de la folie.
En revanche, cette folie furieuse finit par dévorer
Tchartkov comme Akaki Akakiévitch, dont le narrateur
décrit l'agonie ainsi : il « délira sans arrêt jusqu'à sa dernière heure» (p.
270).
À propos de Tchartkov, Gogol prend soin de distinguer, à
l'aide de termes médicaux, les maladies physiques
(« fièvre maligne», « phtisie galopante») et « les symptômes d'une démence incurable» (p.
138).
Il note deux
séries de symptômes auxquels ressemblent ceux qui
affectent Akaki lorsqu'il est à l'agonie : des hallucinations
et un dérèglement du langage.
Pour Tchartkov comme pour Akaki, le lecteur peut observer des effets de grossissement des souvenirs.
Ceux-ci se
transforment en visions : d'«yeux» chez le premier, d'un
effrayant « manteau » chez le second.
Chez le peintre
s'ajoutent des effets de multiplication des visions et de
déformation du réel: « la pièce s'élargissait, se prolongeait
à l'infini» (p.
138).
On rapprochera également les « paroles décousues»
et les « abominables lamentations » de Tchartkov des
« horribles jurons» et des « paroles incohérentes» d'Akaki
(p.,.270).
Dans « La Perspective Nevski », le narrateur suit étape
par étape la folie du peintre Piskariov à partir de la première déception que lui cause sa belle «inconnue».
C'est
d'abord un rêve.
Il rêve qu'il cherche la femme aimée au
milieu d'une foule, proliférante, étouffante : « Il se précipita
comme un fou à travers la cohue» (p.
66).
Puis, le narrateur évoque le début d'une schizophrénie du héros, c'està-dire d'un dédoublement de sa personnalité, ici entre des
journées vides et des nuits peuplées de songes.
Le héros
prend certes conscience de ce dédoublement, un « éternel
divorce entre le rêve et la réalité» (p.
70-71 ), mais il l'a
déjà accru par l'opiomanie : « L'usage de l'opium surexcitait davantage encore ses pensées» (p.
71 ).
L'échec de sa demande en mariage, et surtout les propos, vulgaires et « l'existence vile» (p.
74) de la jeune
femme, aggravent encore la folie de Piskariov.
Gogol
évoque l'errance de Piskariov et son apparence hallucinée:
« blême, l'air hagard, les cheveux en désordre, le visage
marqué des signes de la folie» (p.
74).
L"'originalité
du « Journal d'un fou »
« Le Journal d'un fou» est apparu dans la tradition littéraire comme un exemple d'analyse clinique de la folie.
Il
se distingue des autres Nouvelles de Pétersbourg comme
le seul récit qui soit écrit à la première personne.
Mais cette écriture à la première personne n'est pas
l'originalité essentielle du texte, ni par rapport aux œuvres
de l'époque sur la folie, ni par rapport aux autres nouvelles.
Cette originalité réside dans le statut inhabituel du
personnage de fou.
En effet, ce n'est ni un artiste ni un
esthète riche et oisif.
La folie touche ici un « conseiller titulaire», c'est-à-dire un petit fonctionnaire 1 , Gogol rend ainsi
la folie de son héros encore plus proche du lecteur.
Ainsi, Gogol se met à la place de son fou.
Il parvient à nous
montre~, palier par palier, la progression de Poprichtchine
vers l'aliénation mentale, au sens de trouble, qui rend
étranger à soi-même (alius: « un autre»).
• La montée de la folie
Pour le lecteur, les signes de la folie de Poprichtchine
sont présents dès le début de son journal où l'employé
attribue à son chef de section ce soupçon sur sa santé
mentale : « Comment se fait-il que tu aies toujours un
pareil brouillamini dans la cervelle, frère? » (p.
167.) Et,
comme nous l'avons vu2, sa perception d'une conversation entre deux chiennes n'a qu'une explication naturelle :
la folie.
Les propos qu'il dit avoir adressés à la jeune maîtresse de la chienne Fidèle : « J'ai besoin de parler à votre
chienne» (p.
178) traduisent à coup sûr un comportement
déviant.
C'est ce que confirme la réaction de la jeune fille:
«Je crois que la jeune fille m'a pris pour un fou car elle a
semblé extrêmement effrayée» (p.
179).
Il prétend alors
qu'il a réussi à intercepter une correspondance entre deux
chiennes, Fidèle et Medji, la chienne de la fille de son
directeur.
Mais au fur et à mesure que Poprichtchine lit et transcrit
cette correspondance, ses commentaires laissent percevoir
1.
Voir le chapitre 14.
2.
Voir le chapitre 9.
une aggravation de son état morbide.
Peu à peu, des commentaires qui traduisent la confusion mentale (« Peut-être
y trouverons-nous quelque chose de plus sensé», p.
181)
font place à d'autres qui marquent une évolution vers la
paranoïa puis vers la schizophrénie.
• Vers la paranoïa et la schizophrénie
La lecture des propos que Medji aurait écrits à son sujet
(«avorton» par exemple) entraîne chez Poprichtchine un
sentiment âe persécution.
Il se croit victime de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓