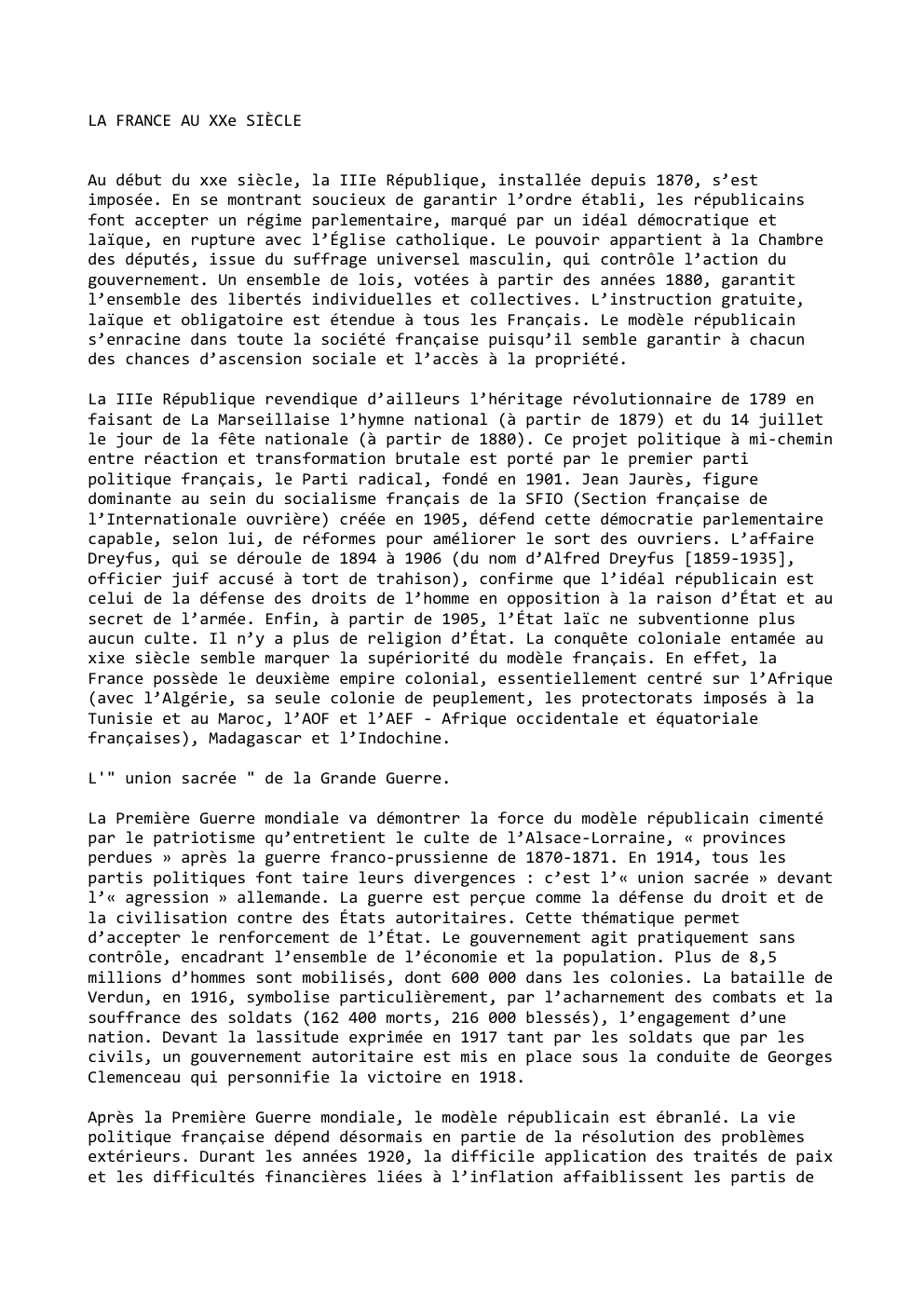LA FRANCE AU XXe SIÈCLE Au début du xxe siècle, la IIIe République, installée depuis 1870, s’est imposée. En se...
Extrait du document
«
LA FRANCE AU XXe SIÈCLE
Au début du xxe siècle, la IIIe République, installée depuis 1870, s’est
imposée.
En se montrant soucieux de garantir l’ordre établi, les républicains
font accepter un régime parlementaire, marqué par un idéal démocratique et
laïque, en rupture avec l’Église catholique.
Le pouvoir appartient à la Chambre
des députés, issue du suffrage universel masculin, qui contrôle l’action du
gouvernement.
Un ensemble de lois, votées à partir des années 1880, garantit
l’ensemble des libertés individuelles et collectives.
L’instruction gratuite,
laïque et obligatoire est étendue à tous les Français.
Le modèle républicain
s’enracine dans toute la société française puisqu’il semble garantir à chacun
des chances d’ascension sociale et l’accès à la propriété.
La IIIe République revendique d’ailleurs l’héritage révolutionnaire de 1789 en
faisant de La Marseillaise l’hymne national (à partir de 1879) et du 14 juillet
le jour de la fête nationale (à partir de 1880).
Ce projet politique à mi-chemin
entre réaction et transformation brutale est porté par le premier parti
politique français, le Parti radical, fondé en 1901.
Jean Jaurès, figure
dominante au sein du socialisme français de la SFIO (Section française de
l’Internationale ouvrière) créée en 1905, défend cette démocratie parlementaire
capable, selon lui, de réformes pour améliorer le sort des ouvriers.
L’affaire
Dreyfus, qui se déroule de 1894 à 1906 (du nom d’Alfred Dreyfus [1859-1935],
officier juif accusé à tort de trahison), confirme que l’idéal républicain est
celui de la défense des droits de l’homme en opposition à la raison d’État et au
secret de l’armée.
Enfin, à partir de 1905, l’État laïc ne subventionne plus
aucun culte.
Il n’y a plus de religion d’État.
La conquête coloniale entamée au
xixe siècle semble marquer la supériorité du modèle français.
En effet, la
France possède le deuxième empire colonial, essentiellement centré sur l’Afrique
(avec l’Algérie, sa seule colonie de peuplement, les protectorats imposés à la
Tunisie et au Maroc, l’AOF et l’AEF - Afrique occidentale et équatoriale
françaises), Madagascar et l’Indochine.
L'" union sacrée " de la Grande Guerre.
La Première Guerre mondiale va démontrer la force du modèle républicain cimenté
par le patriotisme qu’entretient le culte de l’Alsace-Lorraine, « provinces
perdues » après la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
En 1914, tous les
partis politiques font taire leurs divergences : c’est l’« union sacrée » devant
l’« agression » allemande.
La guerre est perçue comme la défense du droit et de
la civilisation contre des États autoritaires.
Cette thématique permet
d’accepter le renforcement de l’État.
Le gouvernement agit pratiquement sans
contrôle, encadrant l’ensemble de l’économie et la population.
Plus de 8,5
millions d’hommes sont mobilisés, dont 600 000 dans les colonies.
La bataille de
Verdun, en 1916, symbolise particulièrement, par l’acharnement des combats et la
souffrance des soldats (162 400 morts, 216 000 blessés), l’engagement d’une
nation.
Devant la lassitude exprimée en 1917 tant par les soldats que par les
civils, un gouvernement autoritaire est mis en place sous la conduite de Georges
Clemenceau qui personnifie la victoire en 1918.
Après la Première Guerre mondiale, le modèle républicain est ébranlé.
La vie
politique française dépend désormais en partie de la résolution des problèmes
extérieurs.
Durant les années 1920, la difficile application des traités de paix
et les difficultés financières liées à l’inflation affaiblissent les partis de
droite (le Bloc national, 1919-1924) et de gauche (le Cartel des gauches,
1924-1926) qui se sont succédé au pouvoir avec le même président du Conseil,
Aristide Briand.
Né de la rupture avec la SFIO au congrès de Tours en 1920, le
parti communiste, SFIC (Section française de l’Internationale communiste), se
démarque en menant, selon les consignes de Moscou, un violent combat
antimilitariste et anticolonialiste.
Les années 1930, marquées par la crise de
1929 et l’essor des totalitarismes en Europe, voient la montée de
l’antiparlementarisme incarné par les ligues, mouvements paramilitaires
d’inspiration nationaliste ou fasciste.
En réaction, les partis de gauche,
socialistes, communistes et radicaux, unissent leurs forces dans un Front
populaire que conduit de 1936 à 1937 le leader socialiste Léon Blum.
Malgré son
échec, le Front populaire apparaît comme novateur en donnant à l’État un rôle
d’arbitre et de législateur dans le domaine social et en réintégrant le monde
ouvrier dans la vie politique française.
Durant cette période, la grandeur de
l’empire colonial est célébrée, alors que les premiers mouvements nationalistes
s’affirment, parfois violemment comme au Maroc (guerre du Rif, 1925-1926) ou en
Indochine (1930-1931).
De la défaite au régime de Vichy.
La IIIe République tombe en 1940 à la suite de la défaite devant les armées
allemandes en mai-juin.
L’armistice, signé le 22 juin 1940 à la demande du
maréchal Philippe Pétain, impose une partition de la France en deux zones.
Le
gouvernement et le Parlement se replient à Vichy, dans la zone sud, dite « libre
» car non occupée par les Allemands jusqu’en novembre 1942.
Par 569 voix contre
80 et 17 abstentions, le Parlement, députés et sénateurs réunis, accorde les
pleins pouvoirs à P.
Pétain qui instaure l’État français.
En rupture complète
avec le régime républicain, le gouvernement de Vichy appelle à une « révolution
nationale » capable, autour d’un pouvoir personnel, de restaurer les « valeurs
éternelles » de la France.
Il collabore ouvertement avec l’Allemagne nazie,
participant activement à la déportation des Juifs.
Parallèlement, de nombreuses
entreprises travaillent pour l’effort de guerre allemand, tandis que des
intellectuels défendent l’idéologie nazie.
La fin de la « zone libre » (11
novembre 1942) et les exigences croissantes de l’occupant déconsidèrent le
gouvernement de Vichy et renforcent les mouvements de la Résistance qui, issus
de tous les milieux, refusent en France la logique de la défaite.
Depuis son
appel de Londres le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle n’a de cesse de
continuer la lutte militaire aux côtés des Alliés et de faire reconnaître la
légitimité d’une France résistante.
Sa force provient du ralliement des
mouvements clandestins, des anciens partis politiques et syndicats.
À la
Libération, à partir de juin 1944, le Gouvernement provisoire de la République
française (GPRF), sous la conduite de De Gaulle, restaure l’autorité de l’État
républicain.
La France retrouve son rang de puissance internationale.
La nécessaire reconstruction du pays entraîne, dès 1945, de nouvelles structures
économiques et sociales fondées sur l’action d’un État-providence (création de
la Sécurité sociale et nationalisations).
En s’appuyant sur les entreprises
nationalisées et la réorganisation du crédit, l’État oriente l’activité
économique à travers les indications du Commissariat au Plan.
Dans le domaine
politique, les hommes issus de la Résistance affirment leur volonté de rénover
la république, comme le prouve l’extension du droit de vote aux femmes en 1944.
Trois partis dominent alors la vie politique : le Parti communiste français
(PCF) à l’influence grandissante, la SFIO rénovée et le MRP....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓