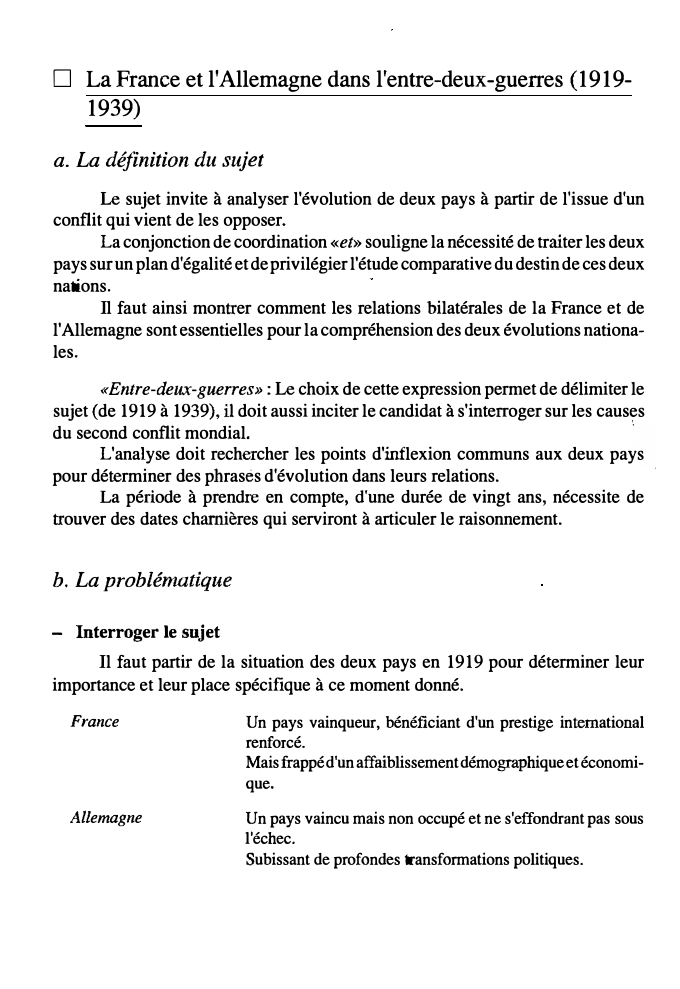□ La France et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres (19191939) a. La définition du sujet Le sujet invite à analyser l'évolution de...
Extrait du document
«
□
La France et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres (19191939)
a.
La définition du sujet
Le sujet invite à analyser l'évolution de deux pays à partir de l'issue d'un
conflit qui vient de les opposer.
La conjonction de coordination «et» souligne la nécessité de traiter les deux
pays sur un plan d'égalité et de privilégier l'étude comparative du destin de ces deux
nations.
Il faut ainsi montrer comment les relations bilatérales de la France et de
l'Allemagne sont essentielles pour la compréhension des deux évolutions nationa
les.
«Entre-deux-guerres» : Le choix de cette expression permet de délimiter le
sujet (de 1919 à 1939), il doit aussi inciter le candidat à s'interroger sur les causes
du second conflit mondial.
L'analyse doit rechercher les points d'inflexion communs aux deux pays
pour déterminer des phrasés d'évolution dans leurs relations.
La période à prendre en compte, d'une durée de vingt ans, nécessite de
trouver des dates charnières qui serviront à articuler le raisonnement.
b.
La problématique
- Interroger le sujet
Il faut partir de la situation des deux pays en 1919 pour déterminer leur
importance et leur place spécifique à ce moment donné.
France
Un pays vainqueur, bénéficiant d'un prestige international
renforcé.
Mais frappé d'un affaiblissement démographique et économi
que.
Allemagne
Un pays vaincu mais non occupé et ne s'effondrant pas sous
l'échec.
Subissant de profondes transformations politiques.
La signature du traité de Versailles (28 juin 1919) constitue une date
essentielle: le poids des exigences françaises renforce l'antagonisme entre les deux
pays.
Pourquoi
France : Elle manifeste une volonté politique d'exploiter sa
victoire, de faire payer l'Allemagne.
Allemagne : Elle n'a de cesse de remettre en cause les
exigences du vainqueur.
Cette divergence entrâme une phase d'affrontement et d'~ostilité mutuelle.
Quelles sont les formes Les deux pays recherchent des alliés, leurs relations sont de
cette hostilité ?
agressives.
Mais : les deux pays sont confrontés à des difficultés économiques communes liées aux conséquences du conflit.
Le contexte politique évolue
Donc: tentative de rapprochement: 1924-1929
Comment?
Intense activité diplomatique, négociations
Mais : déclenchement de la crise économique mondiale de
1929.
Quel est l'impact
Allemagne : crise précoce.
Pourquoi ?
économique de la crise ? France : crise tardive.
Pourquoi ?
Quel est l'impact
politique de la crise ?
France : maintien de la démocratie.
Pourquoi ?
Allemagne : succès du nazisme.
Pourquoi ?
Alors?
La divergence idéologique accentue l'opposition des deux
pays et entraîne une nouvelle phase d'affrontement.
Pourquoi?
Les deux pays ont des objectifs différents :
France : maintien du statu quo européen
Allemagne : remise en cause de l'équilibre européen
Dégager la problématique
L'évolution politique des deux pays est dominée par leur contentieux.
Il
explique l'alternance de phases de rapprochement et d'affrontement.
Structurer la problématique
Le devoir doit s'organiser autour d'une date capitale: 1929.
Les relations franco-allemandes connaissent une évolution indécise brutalement tranchée par le déclenchement de la crise de 1929 qui accentue les
divergences et conduit à la guerre.
c.
L'élaboration du plan
-
Les grandes idées du plan
I.
Une décennie incertaine: de la méfiance à l'entente
1.
l'hostilité de l'après-guerre
2.
un intermède de rapprochement
Il.
Une évolution divergente liée à la grande crisè
1.
un impact variable de la crise
2.
Le retour à l'affrontement
Mobilisation des connaissances (p.
53)
- Le plan détaillé (p.
53)
d.
Conclusion
La France et l'Allemagne connaissent de 1919 à 1939 une évolution qui ne
peut se comprendre qu'au travers d'une étude des destins croisés de ces deux
nations.
Incapables, pour l'une de surmonter le vertige de la victoire, pour l'autre
l'humiliation de la défaite, elles s'engagentsur des voies de plus en plus divergentes.
La réconciliation que leur commun statut de démocratie n'avait pas permis de
réaliser n'est plus concevable quand s'opposent à partir de 1933 deux régimes
politiques aux objectifs antinomiques.
L'analyse des relations bilatérales francoallemandes tradùit à quel point celles-ci sont pesantes sur le destin de l'Europe
durant cette période.
L'affrontement graduel qui progressivement détériore le
climat international ne peut trouver d'autre issue que dans un nouveau conflit.
La
deuxième guerre mondiale apparaît comme l'issue logique de ce dialogue raté.
f.
Introduction
Le 11 novembre 1918, la France sort vainqueur du premier conflit mondial
et conforte son prestige en Europe.
Cette guerre a profondément et durablement
affaibli le pays sur le plan démographique et économique.
L'Allemagne vaincue,
sans que sa défaite n'entrame un effondrement de la nation, subit dès la fin des
hostilités de violents soubresauts politiques marqués par l'avènement de la République et l'échec d'une tentative de révolution.
La signature du traité de Versailles
qui met un terme à la guerre, loin d'apaiser le différend franco-allemand, renforce
un antagonisme qui ne permet pas la réconciliation des deux pays.
Dès lors, le
Mobilisation des connaissances
Un lourd bilan humain et économique
La proclamation de la République allemande
Le traité de Versailles -------Le succès du Bloc national en France
L'instabilité de la République de Weimar
La recherche commune d'alliés
L'occupation de la Ruhr - L'effondrement économique allemand
Le succès des partis extrémistes allemands
Les difficultés financières de la France
Le plan Dawes
-------------------.
.
__________
L'élection d'Hindenburg ~
~
Le succès du Cartel des Gauches - ~
Le traité de Locarno
Plan détaillé
I.
Une décennie incertaine : d'une défiance mutuelle à une entente éphémère (1919-1929).
1.
Les difficiles années d'après-guerre : une hostilité renforcée (19191924)
L'entrée
l'Allemagne à l:~S~-~D~.N~.~~~~~~~~~~~==="'-"'Le pacte de
Briand-Kellogg
La coopération économique
IL
La rapide paralysie de l'économie allemande ~ d u
L'économie française reste un temps épargnée
La coalition de Weimar mise à mal - - - 1.
LLea rigu~urdéco ~omique en France face à la c r i s e ~ ~
succes es 1igues
~
La poussée du N.S.D.A.P.
en Allemagne
.
le lourd contentieux franco-allemand
l'impossible dialogue
une diplomatie agressive
Un intermède de rapprochement (1924-1929)
des difficultés communes
un nouveau contexte politique
le triomphe de l'esprit de Genève
Les deux pays face à la grande crise : une évolution divergente source
second conflit mondial (1929-1939)
Un impact variable de la crise
- deux économies diversement ébranlées
-
deux démocraties inégalement contestées
Hitler est nommé chancelier ~~~~~~~~~~~~~~~=-
deux choix politiques différents
Le rôle pondérateur du parti radical en France
Le succès du Front Populaire Le retrait allemand de la S.D.N.
- - - _
L
t
, l'affr
L~ rétablissement du service militaire en Allemagne-======------=-==-- 2· e re our a
ontement
La volonté française d'isoler l'Allemagne ~
la liquidation du traité de Versailles
La remilitarisation de la Rhénanie
~
un nazisme agressif non contenu
Le rapprochement de l'Allemagne et l ' I t a l i ~ la guerre
Les annexions allemandes en Europe orientale - - Le pacte germano-soviétique ~
La déclaration de guerre
=-------
problème des rapports bilatéraux domine l'orientation des politiques intérieure et
extérieure en France et en Allemagne.
Phases d'affrontement et de rapprochement
alternent au gré des oscillations du contexte international.
Une profonde hostilité
mutuelle née du contentieux de la guerre et de l'application du traité de paix domine
les rapports franco-allemands dans l'immédiat après-guerre.
Elle laisse place à
partir de 1924 au dialogue et à un net rapprochement sous les auspices de la S.D.N.
La crise de 1929 brise net ce cheminement vers la normalisation des relations.
France et Allemagne apportent des réponses divergentes aux problèmes auxquels
elles sont confrontées.
L'opposition idéologique ravive les litiges anciens et
conduit sur le terrain d'une rivalité génératrice du second conflit mondial.
f Développement
La signature de l'armistice à Rethondes met un terme à un conflit de plus de
quatre ans qui a ravagé l'Europe et bouleversé sa physionomie.
L'antagonisme
franco-allemand loin d'être désamorcé est exacerbé par les conditions de la fin des
combats et la signature du traité de paix.
La population française éprouve un profond ressentiment à l'égard de
l'Allemagne plus que jamais ennemie héréditaire.
La terrible saignée subie par les
troupes (plus de 1 300 000 morts) touche jusqu'au plus petit village.
Les paysages
de désolation qu'offrent les régions des combats témoignent de l'ampleur des
destructions.
Les saccages gratuits auxquels se sont livrés les Allemands lors de
leur retraite (mines hoyées, machines détruites dans les usines) avivent une haine
tenace à l'égard de l'adversaire.
En Allemagne, la République est proclamée le 9 novembre 1918 à la suite
des mouvements insurrectionnels de Bavière et de Berlin et de l'abdication de
Guillaume II.
Elle apparaît aux yeux de l'opinionI comme le régime de la défaite et
de l'étranger.
La tentative révolutionnaire spartakiste de janvier 1919 augmente les
craintes de la population et sa défiance envers un régime qui a beaucoup de mal à
s'imposer.
La rigueur du traité de Versailles qui ampute l'Allemagne du l/7ème de
son territoire, limite ses prérogatives en matière de défense et la rend responsable
du conflit (article 231) et redevable à ce titre de lourdes indemnités, envenime la
situation.
L'absence de l'Allemagne à la conférence de Paris renforce le caractère
de «Diktat» du traité.
Cette maladresse initiale conforte les Allemands dans leur
analyse : la France entend exploiter sa victoire pour humilier son adversaire.
La
France apparaît comme le principal responsable d'un traité considéré comme
inique, les États-Unis et la Grande-Bretagne ayant cherché à tempérer les exigences de Clemenceau.
Cette situation explique l'impossibilité pour les deux nations de renouer le
dialogue dans l'immédiat après-guerre.
La France victorieuse veut faire payer
chèrement à l'ennemi les pertes humaines et les destructions du conflit.
L'Allemagne mortifiée se replie sur elle-même et rêve de revanche.
L'attitude rigide des forces politiques des deux l!ations est un obstacle
majeur au rétablissement de relations normales.
En France, le Bloc national
remporte une écrasante majorité aux élections.
Cette chambre «bleu horizon»
exige l'application intégrale des dispositions du traité de Versailles.
La France
espère appuyer son redressement économique sur le paiement des réparations
allemandes.
Le ministre des finances Klotz l'affirme sans détours : «L'Allemagne
paiera».
Le sentiment anti-allemand est trop puissant dans l'opinion pour qu'un
gouvernement puisse envisager la moindre clémence à l'égard du vaincu.
En Allemagne, la coalition âe Weimar formée du S.P.D.
et du Centre
catholique dispose d'une marge de manœuvre trop limitée pour envisager toute
initiative politique d'envergure.
Dénoncée au Reichstag par les députés de la droite
monarchiste qui l'accusent d'avoir bradé les intérêts nationaux lors de la signature
du traité de paix, elle doit bientôt subir les assauts d'une extrême-droite factieuse.
La tentative de coup d'État de Kapp en mars 1920 marquée par l'occupation de·
ministères à Berlin par les membres de corps francs n'échoue qu'à la suite d'une
grève générale déclenchée par les syndicats : la Reichswehr n'a pas apporté son
soutien au gouvernement.
La multiplication des crimes politiques traduit un climat
de guerre civile larvée : le député catholique Erzberger qui a dirigé la délégation
allemande signataire des accords de paix paye de sa vie son geste symbolique.
A
l'autre extrême de l'échiquier politique, le K.P.D.
qui ne pardonne pas au gouvernement la sanglante répression du mouvement spartakiste accentue sa pression sur
l'État par un soutien sans faille à tous les mouvements sociaux.
Ce contexte politique difficile explique la dureté des relations francoallemandes dans l'immédiat après-guerre.
Chaque pays recherche des appuis pour
une éventuelle reprise des combats.
La France apporte son soutien aux nouveaux
États de l'Europe danubienne : envoi de juristes pour la mise en place des nouvelles
constitutions, d'experts militaires pour l'organisation des forces armées.
Elle
constitue de 1920 à 1921 la Petite Entente, alliance de revers formée à la suite
d'accords croisés entre Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie et Pologne.
Cette volonté de prendre l'Allemagne en tenaille se place dans la même logique
d'affrontement que le traité franco-russe précédant le premier conflit mondial.
L'Allemagne, de son côté, cherche à s'affranchir des contraintes les plus pesantes
du traité de Versailles et à sortir de son isolement diplomatique.
Le traité de
Rapallo, signé avec la Russie soviétique en 1922, apparaît comme une réponse à
la Petite Entente : l'Allemagne envoie former en Russie des officiers spécialistes
des armes qui lui sont interdites (blindés, artillerie, aviation).
La confrontation directe se produit en janvier 1923 quand, prétextant une
non-livraison de matériel dans le cadre des réparations de guerre, l'armée française
investit la Ruhr à la demande de Poincaré.
La population allemande réplique par
la résistance passive à l'occupant: sabotages et grève générale dérèglent totalement
les activités économiques du poumon industriel allemand.
L'occupation de la Ruhr constitue l'ultime épisode de.la phase de défiance
mutuelle.
La grève générale a des répercussions dramatiques sur l'économie
allemande: le mark s'effondre, le chômage triple en l'espace de quelques semaines.
•La misère guette de nombreuses catégories sociales : rentiers, ouvriers, fonctionnaires, petits patrons.
L'électorat se radicalise: les classes moyennes se tournent
vers l'extrême-droite.
La tentative de putsch du 8 novembre 1923 par Ludendorff
et Hitler à Munich est à replacer dans ce contexte d'exaspération d'une frange
grandissante de l'opinion à l'égard d'un gouvernement considéré comme incapable.
La classe ouvrière délaisse le S.P.D.
au profit du K.P.D.
dont l'électorat passe de
600 000 voix à 4 000 000 de voix de 1920 à 1924.
La prudence pousse la coalition de Weimar vers le chemin de la conciliation.
La nomination de G.
Stresemann à la tête du ministère des affaires étrangères
constitue une date qécisive dans- l'évolution politique de l'Allemagne.
La France doit réduire ses prétentions in_temationales.
Le retrait américain
des affaires de l'Europe restreint ses possibilités d'action.
Le pays est aussi
confronté à de sérieuses difficultés financières.
L'endettement chronique et la
lenteur du redémarrage économique entraînent une chute du franc.
L'inflation
amène les petits épargnants à se détourner des bons du trésor.
Les projets d'emprunt
forcé envisagés par le gouvernement du Cartel des Gauches d'E.
Herriot pour faire
face au double déficit du budget et des échanges se traduisent par un exode massif
des capitaux vers l'étranger.
La France n'a plus les moyens de sa politique.
La
griserie des défilés de la victoire laisse place à la triste réalité des faits.
Le plan
Dawes de réaménagement du paiement des dettes allemandes en fonction de son
indice de prospérité, imposé par les Américains en 1924 sanctionne cette situation
nouvelle.
L'heure est à la négociation.
Un nouveau contexte politique favorise cette évolution.
Le succès de la
coalition de Weimar aux élections de 1924 conforte le gouvernement.
L'élection
du vieux maréchal Hindenburg à la présidence l'année suivante renforce les assises
du régime.
Les conservateurs se rallient à un régime qu'ils ont longtemps combattu.
En France, le succès du Cartel des Gauches en 1924 constitue une avancée
importante.
Le profond antigermanisme des partis du Bloc national laisse place à
une volonté de négociation.
Le pacifisme est à l'ordre du jour.
G.
Stresemann et A.
Briand vont incarner cet esprit nouveau sous les auspices de la S.D.N.
En l'espace
de quelques mois, des négociations vont aboutir à une normalisation des relations
entre les deux pays.
Par le traité de Locarno (octobre 1925), l'Allemagne confirme
son renoncement définitif à l'Alsace et à la Lorraine.
Ce traité librement consenti
efface en partie le «Diktat» de Versailles.
L'entrée de l'Allemagne à la S.D.N.
en
1926 sur proposition de la France constitue l'aboutissement de cette politique de
rapprochement.
A.
Briand peut déclarer à cette occasion avec beaucoup de
lyrisme : «Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons.
Place à la conciliation,
à l'arbitrage, à la paix».
A.
Briand et G.
Stresemann les artisans patients de cette
entente nouvelle reçoivent conjointement en 1926 le prix Nobel de la paix.
Le pacte
Briand-Kellogg de renoncement à la guerre de 1928 est ratifié par l'Allemagne.
L'esprit de Genève laisse entrevoir une ère nouvelle dans les relations internationales.
Les industriels s'associent à cette initiative : !'Entente internationale de
l'acier voit le jour en 1926.
Ce cartel européen regroupe entre autres les sidérurgistes allemands et français.
La courte période de prospérité de 1924 à 1929 est insuffisante pour
désamorcer un antagonisme solidement ancré dans les esprits.
La crise de 1929
brise net cet élan et ravive une tension que les événements contribuent à accentuer.
*
*
*
La crise se traduit de façon très différente dans les deux pays.
L'Allemagne
est le premier pays européen touché par les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓