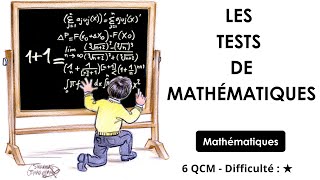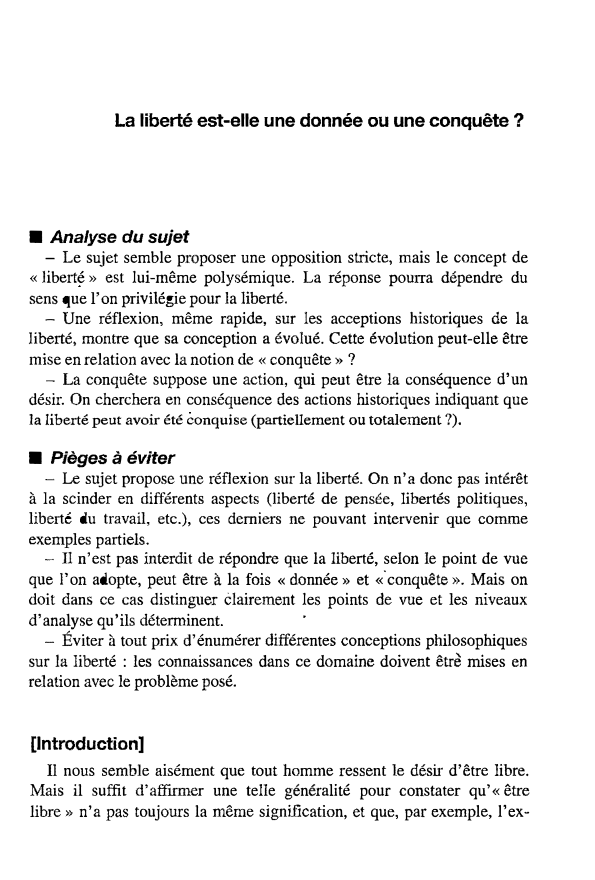La liberté est-elle une donnée ou une conquête ? ■ Analyse du sujet - Le sujet semble proposer une opposition...
Extrait du document
«
La liberté est-elle une donnée ou une conquête ?
■ Analyse du sujet
- Le sujet semble proposer une opposition stricte, mais le concept de
« liberté» est lui-même polysémique.
La réponse pourra dépendre du
sens que l'on privilégie pour la liberté.
- Une réflexion, même rapide, sur les acceptions historiques de la
liberté, montre que sa conception a évolué.
Cette évolution peut-elle être
mise en relation avec la notion de « conquête » ?
- La conquête suppose une action, qui peut être la conséquence d'un
désir.
On cherchera en conséquence des actions historiques indiquant que
la liberté peut avoir été conquise (partiellement ou totalement ?).
■
Pièges à éviter
- Le sujet propose une réflexion sur la liberté.
On n'a donc pas intérêt
à la scinder en différents aspects (liberté de pensée, libertés politiques,
liberté du travail, etc.), ces derniers ne pouvant intervenir que comme
exemples partiels.
- Il n'est pas interdit de répondre que la liberté, selon le point de vue
que l'on adopte, peut être à la fois «donnée» et «·conquête».
Mais on
doit dans ce cas distinguer ëlairement les points de vue et les niveaux
d'analyse qu'ils déterminent.
- Éviter à tout prix d'énumérer différentes conceptions philosophiques
sur la liberté : les connaissances dans ce domaine doivent ê� mises en
relation avec le problème posé.
[Introduction]
Il nous semble aisément que tout homme ressent le désir d'être libre.
Mais il suffit d'affirmer une telle généralité pour constater qu'« être
libre» n'a pas toujours la même signification, et que, par exemple, l'ex-
pression ne désigne pas la même chose pour le citoyen d'une démocratie
moderne que pour l'habitant d'un pays en voie de développement, pour
un paysan du Moyen Âge que pour un commerçant contemporain.
Cette
variabilité historique et culturelle du concept mène à penser que
«liberté» ne désigne pas toujours la même réalité, les mêmes possibilités
pour l'homme.
Cependant, il pourrait se faire qu'à l'arrière-plan de ces
évolutions, il existe un fond constant, comme une donnée permanente qui
se réaliserait de manières diverses, en fonction des contextes historiques,
sociaux, ·culturels.
De ce point de vue, il pourrait exister un«donné» ini
tial de liberté, à partir duquel s'effectueraient des variantes.
Mais ces der
nières doivent-elles être conçues comme se développant en quelque sorte
toutes seules, ou comme résultant des actions humaines ? La liberté est
elle un donné ou une conquête ?
[I.
La liberté par rapport à la nature]
En termes très généraux, la liberté doit au moins être définie comme la
possibilité, proprement humaine, d'échapper aux déterminismes de la
nature.
Cela ne saurait signifier que l'homme ne connaît aucun détermi
nisme (son corps obéit à des lois biologiques), mais cela indique que les
qualités qui le distinguent de la pure animalité montrent une indétermina
tion qui lui est propre, et que l'on assinµle à son abse11,ce de«nature».
Le
comportement animal est en effet prédéterminé par des instincts ;
l'homme, dépourvu d'instincts, doit au contraire inventer ses comporte
ments, et c'est ce qui lui permet d'élaborer un univers culturel, par défini
tion opposé à l'ordre naturel.
On peut, de ce point de vue anthropologique, nommer «liberté» cette
absence de nature.
C'est par exemple ce que fait Sartre, lorsqu'il affirme
que «la liberté, c'est l'irréductibilité de l'ordre culturel à l'ordre
naturel», désignant ainsi la coupure qui se manifeste entre la nature et la
culture.
Dire que la liberté est un donné pour l'homme, c'est simplement
rappeler que, lorsque celui-ci se distingue de l'animalité naturelle, s'ou
vrent à lui une infinité de possibles, parmi lesquels les choix effectués
définissent chaque culture.
La notion même de «donné» paraît renvoyer
à une situation initiale, originelle, ou naturelle, mais le «donné» que
serait cette liberté première de l'homme est dû, de manière un peu para
doxale, à l'absence de nature dans l'homme..
Cette liberté initiale peut être rapprochée de ce que certains philosophes
ont nommé «indépendance naturelle».
Pour les uns (comme Hobbes),
elle ne paraît guère positive, dans la mesure où, entraînant l'homme vers
un comportement égoïste, elle ne peut mener qu'à des conflits.
Pour
d'autres (notamment pour Rousseau), elle semble plus «neutre», ni
bonne ni mauvaise, s'il est vrai qu'elle ne caractérise qu'un homme vivant
SUJETS CORRIGÉS
isolé, sans pensée ni conscience, et qu'elle ne peut en conséquence pas
être qualifiée.
[Il.
De l'indépendance à la liberté conquise]
Ce qui différencie toutefois cette « indépendance naturelle » de la
liberté comme qualité rendant possible les élaborations culturelles, c'est
que la première devient conflictuelle dès que l'homme ne vit plus seul,
tandis que la seconde est conçue comme actualisée dans les communautés
culturelles.
li n'en reste pas moins que ces dernières peuvent ensuite
mettre au point des conceptions très diverses de la liberté - ce qui pourrait
d'ailleurs s'énoncer de manière à nouveau un peu paradoxale : l'homme
est libre jusque dans sa conception de ce que peut être la liberté.
Adoptant le point de vue historique qui lui est habituel, Hegel souligne
que le concept de liberté a connu une évolution synonyme d' élargissement ou d'approfondissement progressif.
Ainsi, le tyran «oriental» est
d'abord le seul qui puisse bénéficier de liberté, tous les autres étant soumis à son pouvoir.
En....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓