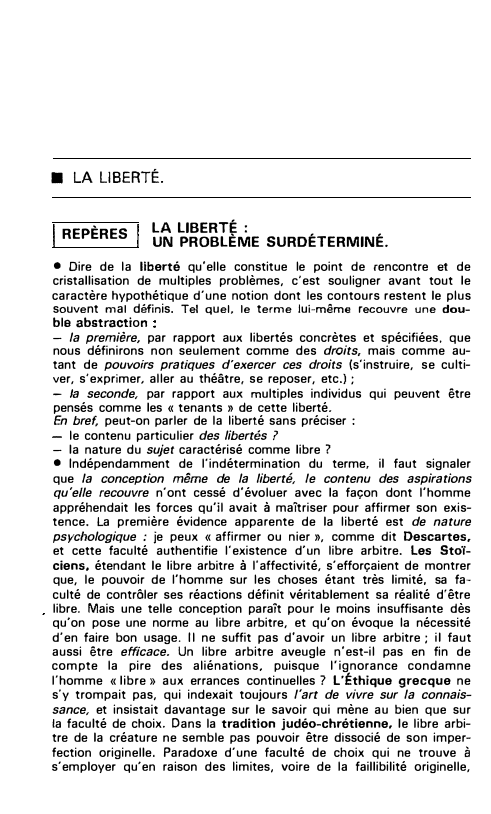■ LA LIBERTÉ. REPÈRES LA LIBERTÉ: UN PROBLÈME SURDÉTERMINÉ. • Dire de la liberté qu'elle constitue le point de rencontre...
Extrait du document
«
■ LA LIBERTÉ.
REPÈRES
LA LIBERTÉ:
UN PROBLÈME SURDÉTERMINÉ.
• Dire de la liberté qu'elle constitue le point de rencontre et de
cristallisation de multiples problèmes, c'est souligner avant tout le
caractère hypothétique d'une notion dont les contours restent le plus
souvent mal définis.
Tel quel, le terme lui-même recouvre une dou
ble abstraction
- la première, par rapport aux libertés concrètes et spécifiées, que
nous définirons non seulement comme des droits, mais comme au
tant de pouvoirs pratiques d'exercer ces droits (s'instruire, se culti
ver, s'exprimer, aller au théâtre, se reposer, etc.) ;
- la seconde, par rapport aux multiples individus qui peuvent être
pensés comme les « tenants » de cette liberté.
En bref, peut-on parler de la liberté sans préciser :
le contenu particulier des libertés ?
- la nature du sujet caractérisé comme libre ?
• Indépendamment de l'indétermination du terme, il faut signaler
que la conception même de la liberté, le contenu des aspirations
qu'elle recouvre n'ont cessé d'évoluer avec la façon dont l'homme
appréhendait les forces qu'il avait à maîtriser pour affirmer son exis
tence.
La première évidence apparente de la liberté est de nature
psychologique : je peux « affirmer ou nier », comme dit Descartes,
et cette faculté authentifie l'existence d'un libre arbitre.
Les Stoî
ciens, étendant le libre arbitre à l'affectivité, s'efforçaient de montrer
que, le pouvoir de l'homme sur les choses étant très limité, sa fa
culté de contrôler ses réactions définit véritablement sa réalité d'être
libre.
Mais une telle conception parait pour le moins insuffisante dès
qu'on pose une norme au libre arbitre, et qu'on évoque la nécessité
d'en faire bon usage.
Il ne suffit pas d'avoir un libre arbitre ; il faut
aussi être efficace.
Un libre arbitre aveugle n'est-il pas en fin de
compte la pire des aliénations, puisque l'ignorance condamne
l'homme « libre » aux errances continuelles ? l'Éthique grecque ne
s'y trompait pas, qui indexait toujours l'art de vivre sur la connais
sance, et insistait davantage sur le savoir qui mène au bien que sur
la faculté de choix.
Dans la tradition judéo-chrétienne, le libre arbi
tre de la créature ne semble pas pouvoir être dissocié de son imper
fection originelle, Paradoxe d'une faculté de choix qui ne trouve à
s'employer qu'en raison des limites, voire de la faillibilité originelle,
ces), puis la philosophie critique (théorie kantienne des facultés de
connaissance);
- avènement du sujet-individu de l'économie politique (dissolution
historique progressive des groupements féodaux).
Formulation de
l'égalitarisme juridique qui permet d'émanciper le sujet économique
(initiative individuelle) et politique (modèle du contrat).
L'essor des sciences humaines et l'élucidation corrélative des as
pects concrets de la réalité ont problématisé·· la définition tradition
nelle du sujet, en soulignant l'importance décisive des facteurs rela
tionnels dans la formation du psychisme (cf.
Freud), la maturation
intellectuelle (cf.
Piaget) et le statut des individus eux-mêmes (cf.
Marx : classes sociales et rapports de production).
Dans le contexte
de ces apports, on peut ressaisir l'intérêt d'une philosophie comme
celle de Spinoza, qui assignait à la réalité humaine une place bien
précise dans une totalité vivante où s'enchaînent des causalités mul
tiples, et problématisait l'idée traditionnelle d'un libre arbitre défini
comme propriété d'un sujet préconstitué.
• Les différentes (< figures >> prises par la liberté renvoient donc à
des conceptions générales, liées à des points de vue différents :
- Tantôt pouvoir de l'être sur lui-même; maîtrise de soi.
[Si cette
question a un sens au niveau du libre arbitre psychologique des Stoî
ciens ou de la pensée classique, elle est complètement transformée
et renouvelée dans ses termes à la lumière de la psychologie mo
derne et de la psychanalyse.]
Tantôt pouvoir de l'être sur les choses; maîtrise de la nature
[liberté comme transformation active du donné].
- Tantôt pouvoir de l'être sur la société; maîtrise du développe
ment économique et social [avec, entre autres, neutralisation des
illusions idéologiques diverses et transformation active du contexte
social].
• Il semble bien, en définitive, que la liberté recouvre autant de
mythes que de problèmes réels.
Proclamer la liberté en droit sans la
promouvoir en fait est une duperie à fonction idéologique évidente.
La dissociation des principes et de la réalité effective reste toujours
suspecte de ce point de vue.
Quant à la triple maîtrise de l'homme
sur les choses, la société et lui-même, elle ne peut apparaître en fin
de compte dans son unité qu'au terme d'une longue et difficile
conquête historique, où la conscience de la nécessité mène plus vite
au but que d'illusoires libertés qui tiennent à la méconnaissance des
déterminismes réels.
• La distinction ainsi établie entre l'expérience intérieure de la liberté
(sentiment de « pouvoir choisir»} et l'accomplissement progressif
d'une libération (conquête de pouvoirs réels) permet de récuser l'op
position stérile entre l'abstraction du libre arbitre et le fatalisme qui
se transforme en alibi (« Nous sommes déterminés, donc non respon
sables »l.
Si l'homme ressent une certaine liberté intérieure (de pen
ser ou de vivre sa condition comme il l'entend), il n'en éprouve pas
moins un certain vertige dès qu'il doit définir les normes de son
action.
Sa volonté, théoriquement libre, n'est-elle pas assujettie aux
limites d'une connaissance forcément partielle, qui ne lui livre pas
tous les éléments en jeu dans une situation donnée ? Si tout n'est
pas prévisible, tout n'est pas maîtrisable.
L'homme doit donc à la
fois maintenir l'exigence d'une lucidité toujours plus vive, et savoir
prendre des risques.
Cette part de risque est peut-être ce qu'il y a
d'irréductible et de spécifique dans le problème de la liberté.
Sur une
échelle allant du plus bas degré du savoir (qui est l'ignorance non
consciente d'elle-même et occultée par des préjugés) à l'idéal
asymptotique d'une connaissance dont la plénitude rendrait certaine
la réussite de toute action envisagée, s'inscrivent tous les degrés
d'une liberté qui, comme le dit Sartre, est toujours « en situation >l.
Le volontarisme d'un libre arbitre abstrait conduit à augmenter la
part de risque, et ce au nom de la promptitude nécessaire de l'ac
tion.
Combinant la précipitation et un certain obscurantisme pragma
tique, il aboutit souvent à l'inefficacité, quand il n'entretient pas les
dangereuses illusions du spontanéisme.
Le fatalisme qui transforme
en alibi la référence aux circonstances repose.
lui aussi, sur une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓