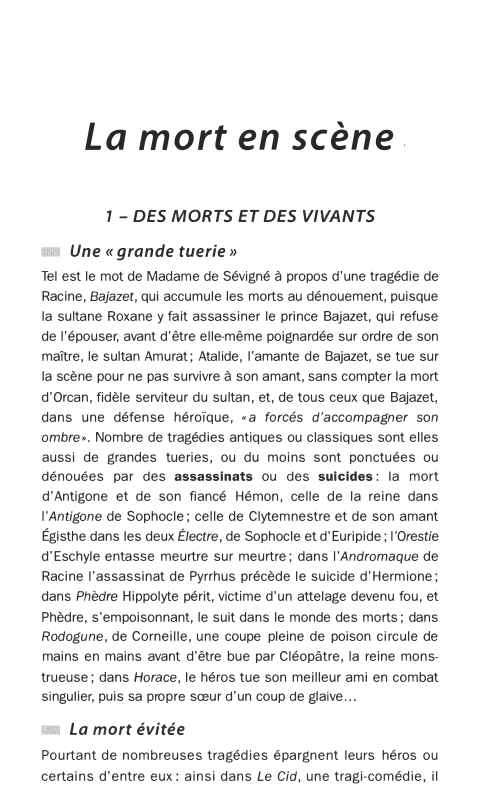La mort en scène. 1 - DES MORTS ET DES VIVANTS • Une « grande tuerie» Tel est le mot...
Extrait du document
«
La mort en scène.
1 - DES MORTS ET DES VIVANTS
• Une « grande tuerie»
Tel est le mot de Madame de Sévigné à propos d'une tragédie de
Racine, Bajazet, qui accumule les morts au dénouement, puisque
la sultane Roxane y fait assassiner le prince Bajazet, qui refuse
de l'épouser, avant d'être elle-même poignardée sur ordre de son
maître, le sultan Amurat; Atalide, l'amante de Bajazet, se tue sur
la scène pour ne pas survivre à son amant, sans compter la mort
d'Orcan, fidèle serviteur du sultan, et, de tous ceux que Bajazet,
dans une défense héroïque, «a forcés d'accompagner son
ombre».
Nombre de tragédies antiques ou classiques sont elles
aussi de grandes tueries, ou du moins sont ponctuées ou
dénouées par des assassinats ou des suicides: la mort
d'Antigone et de son fiancé Hémon, celle de la reine dans
!'Antigone de Sophocle; celle de Clytemnestre et de son amant
Égisthe dans les deux Électre, de Sophocle et d'Euripide; l'Orestie
d'Eschyle entasse meurtre sur meurtre; dans !'Andromaque de
Racine l'assassinat de Pyrrhus précède le suicide d'Hermione;
dans Phèdre Hippolyte périt, victime d'un attelage devenu fou, et
Phèdre, s'empoisonnant, le suit dans le monde des morts; dans
Rodogune, de Corneille, une coupe pleine de poison circule de
mains en mains avant d'être bue par Cléopâtre, la reine mons
trueuse; dans Horace, le héros tue son meilleur ami en combat
singulier, puis sa propre sœur d'un coup de glaive ...
• La mort évitée
Pourtant de nombreuses tragédies épargnent leurs héros ou
certains d'entre eux: ainsi dans Le Cid, une tragi-comédie, il
est vrai, plutôt qu'une tragédie, mais aussi dans Cinna, pre
mière tragédie française à fin heureuse, tout entière bâtie sur
la clémence d'Auguste.
Horace, après avoir tué sa sœur,
échappe à la mort, absous de son crime.
Le théâtre optimiste
de Corneille répugne à tuer ses héros: aucun mort dans
Nicomède.
Il arrive au sombre Racine d'en faire autant, dans
Bérénice par exemple, que le dramaturge n'hésite pas à intitu
ler "tragédie»; Andromaque survit, triomphante, dans la pièce
qui porte son nom; les jeunes amants de Mithridate sont en fin
de compte sauvés et promis au bonheur.
• Le débat des cc doctes»
Il semble donc qu'il y ait oscillati on entre deux conceptions
divergentes de la tragédie ou du tragique: les accidents funes
tes, les dénouements horribles et sanglants sont-ils ou non
nécessaires au genre? Aristote ne refusait pas les issues heu
reuses; un "docte» du XVII' siècle, l'abbé d' Aubignac, auteur
d'une Pratique du théâtre (1657), reconnaîtra aux tragédies de
son temps la possibilité de finir «ou par l'infortune des princi
paux personnages ou par une prospérité telle qu'ils l'avaient pu
souhaiter».
Une formule entre les deux, un moyen terme, dans de nom
breuses tragédies de Corneille notamment, est de donner au
dénouement la forme suivante:
« Le personnage antipathique, qui est un tyran ou un traître,
est tué, et par suite de cette mort les personnages sympa
thiques sont heureux et peuvent conclure les mariages qui
étaient auparavant impossibles.
On a donc du sang au
dénouement, mais aussi une impression de soulagement et de
satisfaction.
»
Jacques Scherer.
Ainsi dans Rodogune, dans Mithridate et Esther.
Ce qui compte au fond, pour fournir au dramatique, à cette
action qui est au cœur du genre tragique, c'est le péril de mort,
et non pas la mort elle-même.
Celle-ci, menaçante, suffit au
pathétique, en ce qu'elle ne cesse de rappeler l'ultime limite, la
plus insupportable, la plus scandaleuse, de la condition hu
maine.
Et si le héros finit par lui échapper, il ne l'en a pas moins
regardée en face; ce tête-à-tête avec la mort est l'épreuve
héroïque par excellence (dans de nombreux mythes, dans les
épopées aussi, qui contiennent, comme l'Odyssée ou l'Énéide,
des «descentes aux Enfers»).
En acceptant sans faiblir le risque
de mort, en affrontant, s'il le faut, la mort cruelle - c'est tout
un! - pour rester fidèle à son idéal, à une valeur, pour aller jus
qu'au bout de sa passion, le héros tragique s'éprouve et se
forge comme tel.
2 - LE SPECTACLE DE LA MORT
• La mort théâtrale
Les tragédies antiques n'hésitent pas à exhiber, sous les yeux
du public, mourants et cadavres.
Dans !'Agamemnon d'Eschyle
la porte du palais s'ouvre pour laisser voir le corps abattu, nu
et ensanglanté du roi.
Dans !'Hippolyte d'Euripide le héros, qui
a été broyé par un char, est ramené, pour y mourir, sur la scène.
Dans Les Troyennes, du même, Hécube, la vieille reine de Troie,
se lamente sur le cadavre de son petit-fils Astyanax, que les
Grecs lui apportent dans le bouclier d'Hector, après l'avoir pré
cipité au bas des murailles de la cité.
Dans Rodogune, Cléo
pâtre agonise en scène:....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓