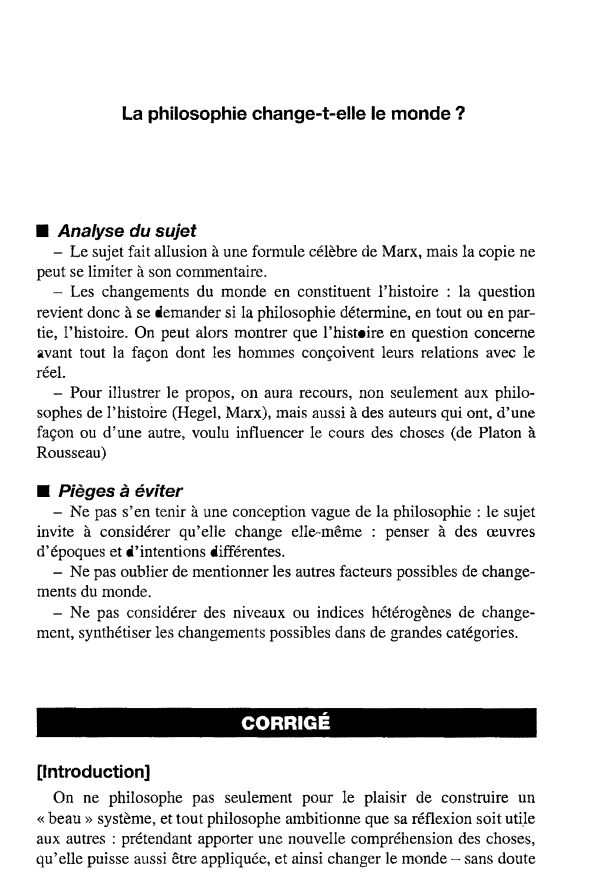La philosophie change-t-elle le monde ? ■ -Analyse du sujet Le sujet fait allusion à une formule célèbre de Marx,...
Extrait du document
«
La philosophie change-t-elle le monde ?
■ -Analyse
du sujet
Le sujet fait allusion à une formule célèbre de Marx, mais la copie ne
peut se limiter à son commentaire.
- Les changements du monde en constituent l'histoire : la question
revient donc à se demander si la philosophie détermine, en tout ou en par
tie, l'histoire.
On peut alors montrer que l'histoire en question concerne
avant tout la façon dont les hommes conçoivent leurs relations avec le
réel.
- Pour illustrer le propos, on aura recours, non seulement aux philo
sophes de l'histol:re (Hegel, Marx), mais aussi à des auteurs qui ont, d'une
façon ou d'une autre, voulu influencer le cours des choses (de Platon à
Rousseau)
■
Pièges à éviter
- Ne pas s'en tenir à une conception vague de la philosophie: le sujet
invite à considérer qu'elle change elle-même : penser à des œuvres
d'époques et d'intentions différentes.
- Ne pas oublier de mentionner les autres facteurs possibles de change
ments du monde.
- Ne pas considérer des niveaux ou indices hétérogènes de change
ment, synthétiser les changements possibles dans de grandes catégories.
CORRIGÉ
[Introduction]
On ne philosophe pas seulement pour le plaisir de construire un
« beau » système, et tout philosophe ambitionne que sa réflexion soit uti_le
aux autres : prétendant apporter une nouvelle compréhension des choses,
qu'elle puisse aussi être appliquée, et ainsi changer le monde- sans doute
CORRIGé23
pas en totalité (quelle philosophie pourrait modifier le cours des planètes ?), mais au moins dans les relations que les hommes entretiennent
avec lui, et entre eux.
Mais la philosophie est-elle capable de changer le
monde ? Quels sont les moyens dont elle dispose pour cela ? Se présentant comme un domaine de pure réflexion, ne se coupe-t-elle pas dès le
départ de toute mise en pratique possible ?
[I.
La philosophie veut changer le monde]
Marx veut instaurer une modification profonde dans la philosophie :
s'il est vrai que« jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter
le monde, il s'agit désormais de le transformer» (XI• Thèse sur
Feuerbach).
Avant Marx, la philosophie aurait eu une tâche limitée à l'interprétation (et donc impuissante); avec lui, au contraire, une nouvelle
tâêhe apparaît : la philosophie sera désormais capable de changer le
monde.
Cette opposition est pourtant discutable : dès Platon, le projet de transformer la réalité se manifeste, puisqu'on peut admettre que le système
platonicien culmine dans le programme politique de La République qui,
s'il trouve à s'appliquer, modifiera bien la communauté des hommes.
C'est très diversement, et à différents niveaux, que les philosophes ont
conçu l'impact de leur pensée sur le réel.
Dans l' Antiquité, la quête de la
« sagesse » ambitionne de modifier les conduites.
Épicure, par exemple, a
pour projet de délivrer ses contemporains de la crainte des dieux et de la
mort - ce qui changerait sans doute leur existence.
Descartes précise ses buts dans le sous-titre du Discours de la
méthode : il s'agit de « bien mener sa raison pour trouver la vérité dans
les sciences».
Or l'accès à la vérité n'est pas inefficace puisque le même
Discours affirme dans sa dernière partie qu'en multipliant les sciences et
leurs applications, l'homme se rendra « comme maître et possesseur de la
nature », et de surcroît jouira d'une vie plus longue.
C'est ainsi la place de
l'homme dans l'univers qui sera changée en même temps que son existence : le vrai n'est pas seulement une satisfaction intellectuelle, il est
aussi doté d'une efficacité transformatrice.
D'un autre·point de vue, ce n'est pas pour le seul plaisir d'articuler des
concepts que Rousseau rédige le Contrat social; c'est au contraire pour
guérir du malheur contemporain qu'il propose sa conception de la fondation du corps politique, et, en parallèle, sa conception, dans Émile, de ce
que doit être l'éducation d'un citoyen capable de s'intégrer dans une
société justement organisée.
Cette fois- encore, la réflexion veut aboutir à
un résultat pratique, et l'on sait que le Contrat social a pu exercer même
1131
SUJETS CORRIGÉS
au prix d'infidélités à sa lettre une influence non négligeable sur certains acteurs de la Révolution.
Marx n'ignorait pas ces exemples, parmi d'autres.
Mais il constate que
les philosophes qui l'ont précédé ont échoué dans leur volonté de changer
le monde.
C'est parce qu'ils n'avaient pas encore une juste conception du
réel et des voies par lesquelles on doit le transformer.
[Il.
Autres acteurs de changement]
Ces philosophes étaient, même involontairement, « idéalistes », alors
que le système de Marx s'annonce comme «matérialiste».
Il semble en
effet logique d'admettre que, pour changer le monde, la philosophie doit
disposer, d'une part, d'une connaissance du monde synonyme d'une véritable «prise» sur celui-ci, et de l'autre, des moyens pratiques capables
d'entraîner le changement.
L'existence d'une histoire signifie que des changements ont bien lieu.
On peut se demander en fonction de quoi, si ce n'est pas en fonction de ce
qu'affirmèrent des philosophes bloqués dans l'interprétation.
Il est vrai
que la cité platonicienne n'a pas eu de réalisation - pas plus que les programmes officiellement «utopiques» d'un Thomas More ou d'un Campanella.
Il est vrai aussi que, malgré Descartes, l'homme ne devient que
rarement centenaire.
Si donc on cherche, d'un point de vue « matérialiste», ce qui peut transformer le monde, une réponse s'impose : c'est le
travail des hommes....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓