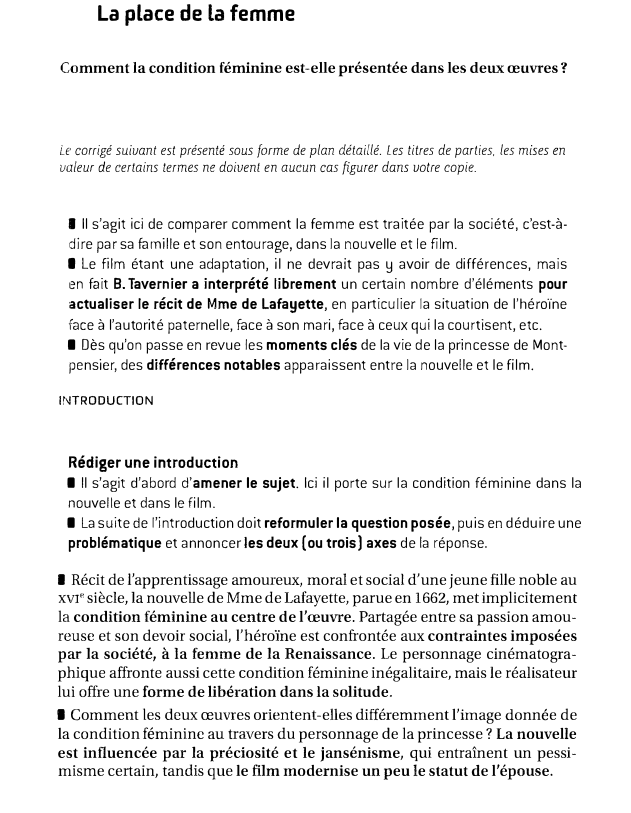La place de la femme Comment la condition féminine est-elle présentée dans les deux œuvres? Le corrigé suivant est présenté...
Extrait du document
«
La place de la femme
Comment la condition féminine est-elle présentée dans les deux œuvres?
Le corrigé suivant est présenté sous forme de plan détaillé.
Les titres de parties.
les mises en
valeur de certains termes ne doivent en aucun cas figurer dans votre copie.
ÉMARRONS ENSEMBLE
1 Il s'agit ici de comparer comment la femme est traitée par la société, c'est-à
dire par sa famille et son entourage, dans la nouvelle et le film.
1 Le film étant une adaptation, il ne devrait pas y avoir de différences, mais
en fait 8- Tavernier a interprété librement un certain nombre d'éléments pour
actualiser le récit de Mme de Lafayette, en particulier la situation de l'héroïne
face à l'autorité paternelle, face à son mari, face à ceux qui la courtisent, etc.
1 Dès qu'on passe en revue les moments clés de la vie de la princesse de Mont
pensier, des différences notables apparaissent entre la nouvelle et le film.
lt\JTRODUCTION
POINT MÉTHODE
Rédiger une introduction
1 Il s'agit d'abord d'amener le sujet.
Ici il porte sur la condition féminine dans la
nouvelle et dans le film.
1 La suite de l'introduction doit reformuler la question posée, puis en déduire une
problématique et annoncer les deux (ou trois] axes de la réponse.
1 Récit de l'apprentissage amoureux, moral et social d'une jeune fille noble au
xvr siècle, la nouvelle de Mme de Lafayette, parue en 1662, met implicitement
la condition féminine au centre de l'œuvre.
Partagée entre sa passion amou
reuse et son devoir social, l'héroïne est confrontée aux contraintes imposées
par la société, à la femme de la Renaissance.
Le personnage cinématogra
phique affronte aussi cette condition féminine inégalitaire, mais le réalisateur
lui offre une forme de libération dans la solitude.
1 Comment les deux œuvres orientent-elles différemment l'image donnée de
la condition féminine au travers du personnage de la princesse ? La nouvelle
est influencée par la préciosité et le jansénisme, qui entraînent un pessi
misme certain, tandis que le film modernise un peu le statut de l'épouse.
DÉVELOPPEMENT
Le mariage imposé remis en cause
1 Mme de Lafayette a suivi la mode la préciosité durant sa jeunesse, elle a
fréquenté les salons précieux de Mme de Rambouillet et de Mlle de Scudéry.
Amie de la marquise de Sévigné, elle a elle-même tenu son propre salon par la
suite, fréquenté par les poètes formés à la préciosité, comme Ménage, Segrais
et Huet.
Or la préciosité est une forme de revendication féministe avant
l'heure.
Les «Précieuses» considèrent que le mariage imposé
La dame impose
n'est plus acceptable, que les femmes ont droit à l'amour et à
des épreuves
l'éducation.
Elles veulent ne se marier qu'après avoir été longue
amoureuses à son
ment courtisées, à la manière de l' amour courtois du Moyen Âge
prétendant pour
et du fin'amor de la Renaissance.
Elles veulent aussi s'instruire,
s'assurer de ses
sentiments.
se cultiver et accéder à la littérature et à l'écriture comme le fit
Mme de Lafayette elle-même.
■ La Princesse de Montpensier met en scène une toute jeune fille qui tente de
résister à l'autorité familiale lui imposant un mariage avec un jeune homme
qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle en aime un autre.
Mais cette résistance
est vaine face aux« tourments» imposés par ses parents et elle doit leur obéir,
tout en exhortant le duc de Guise, qui l'aime, à ne pas s'opposer à son mariage.
Ensuite, séjournant seule avec le comte de Chabannes à Champigny, celui
ci « la rendit en peu de temps une des personnes du monde la plus ache
vée» sans que l'auteur ne précise cette formation - spirituelle, intellectuelle,
morale, sociale? Enfin, malgré sa volonté affichée de refuser toute galanterie,
elle écoute les paroles élogieuses du duc d'Anjou et du duc de Guise sans les
repousser lors de l'épisode de la rivière près de Loches.
La princesse de Mont
pensier ne peut être dénommée «précieuse», ce qui serait un anachronisme,
mais elle en a certaines caractéristiques.
Une émancipation moderne progressive
1 Dans le film de B.
Tavernier, Marie de Mézières s'oppose farouchement à son
père à propos de son mariage avec le jeune Montpensier, les cris et les coups
dramatisent la scène, et c'est sa mère qui s'interpose pour lui éviter d'être
plus sérieusement frappée, et pour lui faire la morale, en dissociant mariage
et amour, comme ce fut le cas pour son propre mariage.
Ensuite elle essaie
de satisfaire son mari, mais sa réponse à la demande de celui-ci d'être aimé:
« Quand vous me le commanderez.
» montre la distance et la froideur provo
quées par la contrainte de ce mariage.
Le réalisateur a accentué la révolte üu
personnage très inspirée de la préciosité.
1 La galanterie avec le duc de Guise et avec le duc d'Anjou est plus appuyée
dans le film, où les contacts physiques et la sensualité sont explicites.
Quant
à la passion avec Guise, elle ne demeure pas platonique, comme dans la nou
veUe inspirée par les préceptes précieux régissant les relations amoureuses,
où la dimension charnelle n'intervient que tardivement voire pas du tout, à la
manière de l'amour courtois.
Le film modernise la relation amoureuse en y
introduisant la sensualité et la sexualité.
1 Enfin le film insiste sur l'apprentissage intellectuel et culturel de la prin
œsse.
Elle apprend....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓