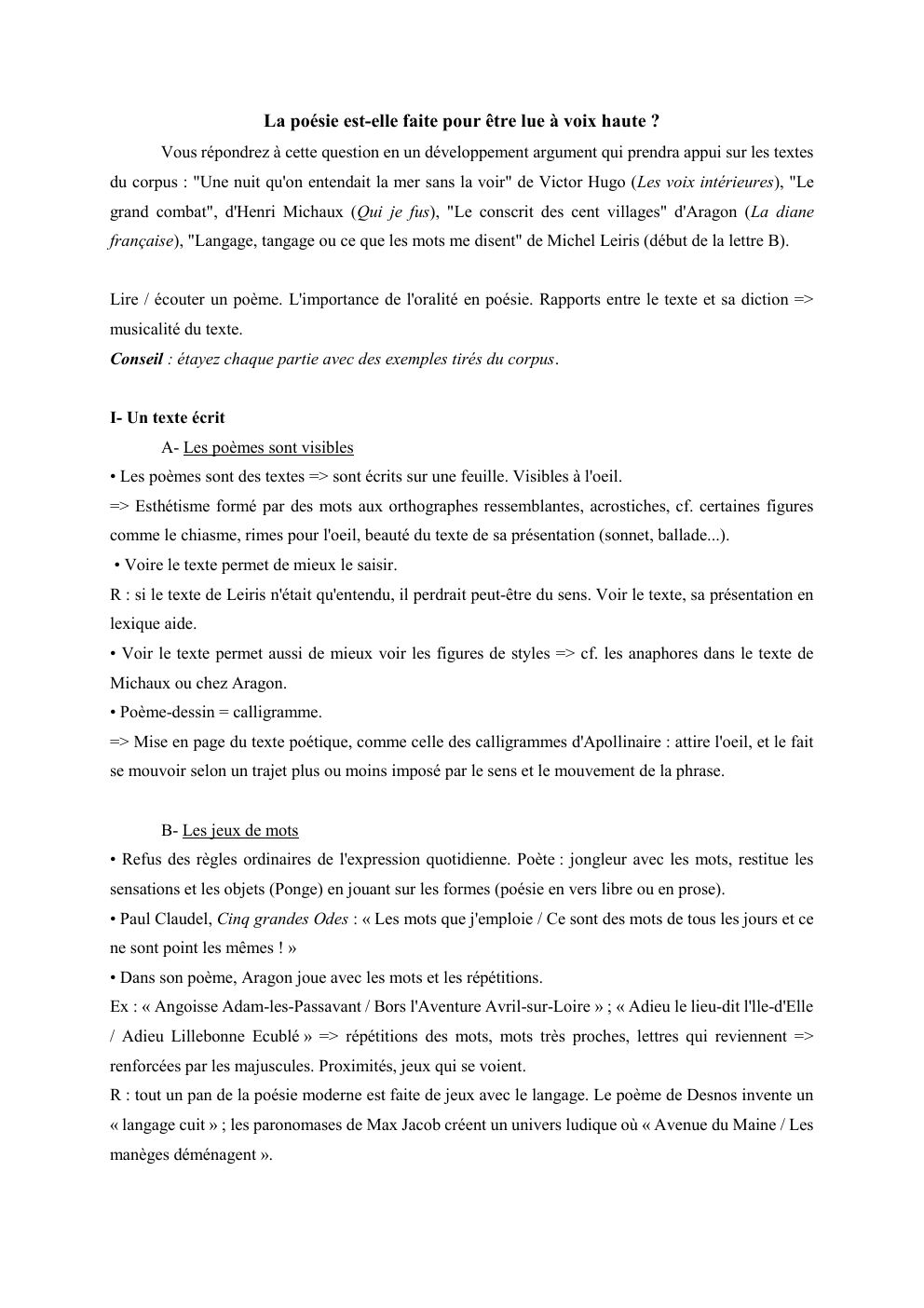La poésie est-elle faite pour être lue à voix haute ? Vous répondrez à cette question en un développement argument...
Extrait du document
«
La poésie est-elle faite pour être lue à voix haute ?
Vous répondrez à cette question en un développement argument qui prendra appui sur les textes
du corpus : "Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir" de Victor Hugo (Les voix intérieures), "Le
grand combat", d'Henri Michaux (Qui je fus), "Le conscrit des cent villages" d'Aragon (La diane
française), "Langage, tangage ou ce que les mots me disent" de Michel Leiris (début de la lettre B).
Lire / écouter un poème.
L'importance de l'oralité en poésie.
Rapports entre le texte et sa diction =>
musicalité du texte.
Conseil : étayez chaque partie avec des exemples tirés du corpus.
I- Un texte écrit
A- Les poèmes sont visibles
• Les poèmes sont des textes => sont écrits sur une feuille.
Visibles à l'oeil.
=> Esthétisme formé par des mots aux orthographes ressemblantes, acrostiches, cf.
certaines figures
comme le chiasme, rimes pour l'oeil, beauté du texte de sa présentation (sonnet, ballade...).
• Voire le texte permet de mieux le saisir.
R : si le texte de Leiris n'était qu'entendu, il perdrait peut-être du sens.
Voir le texte, sa présentation en
lexique aide.
• Voir le texte permet aussi de mieux voir les figures de styles => cf.
les anaphores dans le texte de
Michaux ou chez Aragon.
• Poème-dessin = calligramme.
=> Mise en page du texte poétique, comme celle des calligrammes d'Apollinaire : attire l'oeil, et le fait
se mouvoir selon un trajet plus ou moins imposé par le sens et le mouvement de la phrase.
B- Les jeux de mots
• Refus des règles ordinaires de l'expression quotidienne.
Poète : jongleur avec les mots, restitue les
sensations et les objets (Ponge) en jouant sur les formes (poésie en vers libre ou en prose).
• Paul Claudel, Cinq grandes Odes : « Les mots que j'emploie / Ce sont des mots de tous les jours et ce
ne sont point les mêmes ! »
• Dans son poème, Aragon joue avec les mots et les répétitions.
Ex : « Angoisse Adam-les-Passavant / Bors l'Aventure Avril-sur-Loire » ; « Adieu le lieu-dit l'lle-d'Elle
/ Adieu Lillebonne Ecublé » => répétitions des mots, mots très proches, lettres qui reviennent =>
renforcées par les majuscules.
Proximités, jeux qui se voient.
R : tout un pan de la poésie moderne est faite de jeux avec le langage.
Le poème de Desnos invente un
« langage cuit » ; les paronomases de Max Jacob créent un univers ludique où « Avenue du Maine / Les
manèges déménagent ».
R : La poésie par ses jeux sur le langage peut apparaître comme une ornementation ou un écart face au
langage quotidien.
Le poète apparaît comme un technicien jouant gratuitement avec le langage.
C- Une nouvelle langue
• La poésie engage un usage particulier du mot : recherches lexicales, images.
Les poètes insistent
souvent sur le travail qu'ils opèrent sur la langue.
=> La poésie utilise aussi son propre langage
Cf.
le « Sonnet des Voyelles » de Rimbaud.
La poésie tend à créer un langage qui lui est propre.
• Cf.
le texte d'H.
Michaux => il crée de nouveaux mots « Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;/ Il
le rague et le roupéte jusqu'à son drâle ; / Il le pratéle et le libucque et lui baroufle les ouillais ».
=>
Et pourtant, même si on ne connaît pas les mots, on comprend.
Travail des mots, travail de la langue.
Mots-valises, néologismes...
=> le poète a inventé un langage mais qui est finalement compris de tous.
R : Mais ces rapprochements visuels s'entendent aussi => La poésie se fonde sur des recherches autour
des rimes et des jeux phoniques, est un travail sur les jeux métriques et rythmiques.
∆) Le poète => artisan des mots.
Des poèmes virtuoses des grands Rhétoriqueurs du Moyen Age aux «
objeux » de Ponge, la poésie a toujours travaillé pour créer un nouveau langage, en utilisant à sa façon
le lexique, la phrase, la syntaxe, la forme, l'inscription du texte dans la page, la typographie...
Cependant, si la poésie peut être lue dans sa tête, si le texte peut être apprécié, elle peut aussi être dite.
II- Le son et le sens
A- Une origine lyrique
• Dans l'Antiquité, genre lyrique : poésie accompagnée d'une lyre.
Au Moyen Âge, formes poétiques
accompagnées de musique....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓