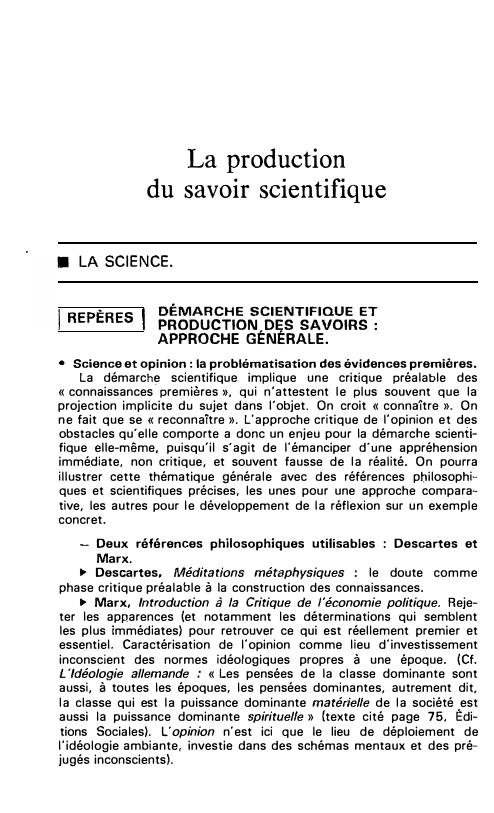La production du savoir scientifique ■ LA SCIENCE. REPÈRES DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET PRODUCTION DES SAVOIRS: APPROCHE GÉNÉRALE. • Science et...
Extrait du document
«
La production
du savoir scientifique
■
LA SCIENCE.
REPÈRES
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET
PRODUCTION DES SAVOIRS:
APPROCHE GÉNÉRALE.
• Science et opinion : la problématisation des évidences premières.
La démarche scientifique implique une critique préalable des
«connaissances· premières ».
qui n'attestent le plus souvent que la
projection implicite du sujet dans l'objet.
On croit «connaître».
On
ne fait que se «reconnaître».
L'approche critique de l'opinion et des
obstacles qu'elle comporte a donc un enjeu pour la démarche scienti
fique elle-même, puisqu'il s'agit de l'émanciper d'une appréhension
immédiate, non critique, et souvent fausse de la réalité.
On pourra
illustrer cette thématique générale avec des références p))ilosophi
ques et scientifiques précises, les unes pour une approche compara
tive, les autres pour le développement de la réflexion sur un exemple
concret.
Deux références philosophiques utilisables : Descartes et
Marx.
► Descartes, Méditations métaphysiques : le doute comme
phase critique préalable à la construction des connaissances.
► Marx, Introduction à la Critique de l'économie politique.
Reje
ter les apparences (et notamment les déterminations qui semblent
les plus immédiates) pour retrouver ce qui est réellement premier et
essentiel.
Caractérisation de l'opinion comme lieu d'investissement
inconscient des normes idéologiques propres à une époque.
(Cf.
L 'Idéologie allemande : « Les pensées de la classe dominante sont
aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit,
la classe qui est la puissance dominante matérielle de la société est
aussi la puissance dominante spirituelle» (texte cité page 75, Édi
tions Sociales).
L'opinion n'est ici que le lieu de déploiement de
l'idéologie ambiante, investie dans des schémas mentaux et des pré
jugés inconscients).
- Deux exemples de rupture épistémologique dans la pensée
scientifique.
On peut prendre dans l'histoire des sciences plusieurs exemples
illustrant le nécessaire rapport critique de la science à l'opinion
La naissance d'une astronomie scientifique avec Copernic.
(Dans sa lettre-préface au De revolutionibus orbium cœfestium, Co
pernic montre que l'opinion courante, qui véhicule le géocentrisme
comme évidence empirique et dogme de référence, correspond à une
illusion de perspective dont la théorie scientifique - l'héliocentrisme
rend compte en expliquant la position relative du sujet percevant.)
- L'essor d'une anthropologie culturelle et d'une ethnologie
scientifique a nécessité l'abandon du point de vue « ethnocentriste »
par lequel l'opinion commune tend à ériger en normes et références
universelles les données d'une culture particulière.
(Cf.
sur ce point
Lévi-Strauss : Race et Histoire, et les commentaires du même au
teur sur la signification critique de l'œuvre de Rousseau.)
• Le développement et la progression des sciences.
Aucune science n· est définitive (une théorie peut être à la fois
vraie et relative).
Il faut donc penser le devenir des sciences, les
transformations et les remaniements qu'elles subissent en surmon
tant les obstacles qu'elles tendent elles-mêmes à engendrer (sclérose
des théories, dogmatisme).
Exemples d'analyse : étude des « crises »
de la pensée mathématique (élargissement progressif de la concep
tion du nombre) ; étude de l'évolution de la physique scientifique
(avec, par exemple, la remise en question de la représentation new
tonienne de la masse comme constante).
Le devenir des sciences, procédant par dépassements successifs
et intégration, peut être pensé comme un processus dialectique, que
I'épistémologue interprète à partir de l'état actuel du savoir.
Cf.
sur
ce point les analyses de Bachelard dans L'Activité rationaliste de la
physique contemporaine (Éditions 10-18, pages 35, 36 et 37) : « On
doit donc comprendre l'importance d'une dialectique historique pro
pre à la pensée scientifique.
En somme, il faut sans cesse former et
reformer la dialectique d'histoire périmée et d'histoire sanctionnée
par la science autrement active.
>> Cf.
aussi La Philosophie du non
(Presses Universitaires de France) pour une approche des remanie
ments successifs des théories scientifiques.
• Une analyse opératoire de l'épistémologie contemporaine : la
théorie des obstacles épistémologiques selon Bachelard.
- La théorie des obstacles épistémologiques.
Cf.
La Formation
de l'esprit scientifique (Éditions Vrin, premier chapitre).
L'épistémolo
gie de Gaston Bachelard opère une distinction entre deux types
d'obstacles épistémologiques
► Ceux qui précèdent la démarche scientifique et l'entravent ou
même l'empêchent complètement (ce sont en général les valorisa
tions subjectives inconscientes et les données immédiates du rapport
perceptif qui investissent d'emblée la représentation du monde).
Obstacles préscientifiques.
► Ceux qui résultent du développement même de la science.
Théories admises fonctionnant de façon autoritaire et fermée, se po
sant comme définitives.
Thème de I'« induration», de «l'inertie» des
idées (résistance au changement).
Obstacles intrascientifiques.
particulières, c'est-à-dire en identifiant l'Être en tant qu'être.
De ce
point de vue, elle intègre la recherche scientifique, et la parachève.
tout en s'en distinguant à tout moment par une exigence spécifique
qu'elle s· attache à faire valoir.
{MAROC-DAKAR-DJIBOUTI CDE]
Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude
ordonnée:
« On pourrait dire de la vie, comme de la conscience, qu'à chaque
instant elle crée quelque chose.
Mais contre cette idée de l'originalité et de l'imprévisibilité absolues
des formes toute notre intelligence s'insurge.
Notre intelligence, telle que
l'évolution de la vie l'a modelée, a pour fonction essentielle d'éclairer
notre conduite, de préparer notre action sur les choses, de prévoir, pour
une situation donnée, les événements favorables ou défavorables qui pour
ront s'ensuivre.
'Elle isole donc instinctivement, dans une situation, ce qui
ressemble au déjà connu ; elle cherche le même, afin de pouvoir appli
quer son principe que « le même produit l e même».
En cela consiste la
prévision de l'avenir par le sens commun.
La science porte cette opération
au plus....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓