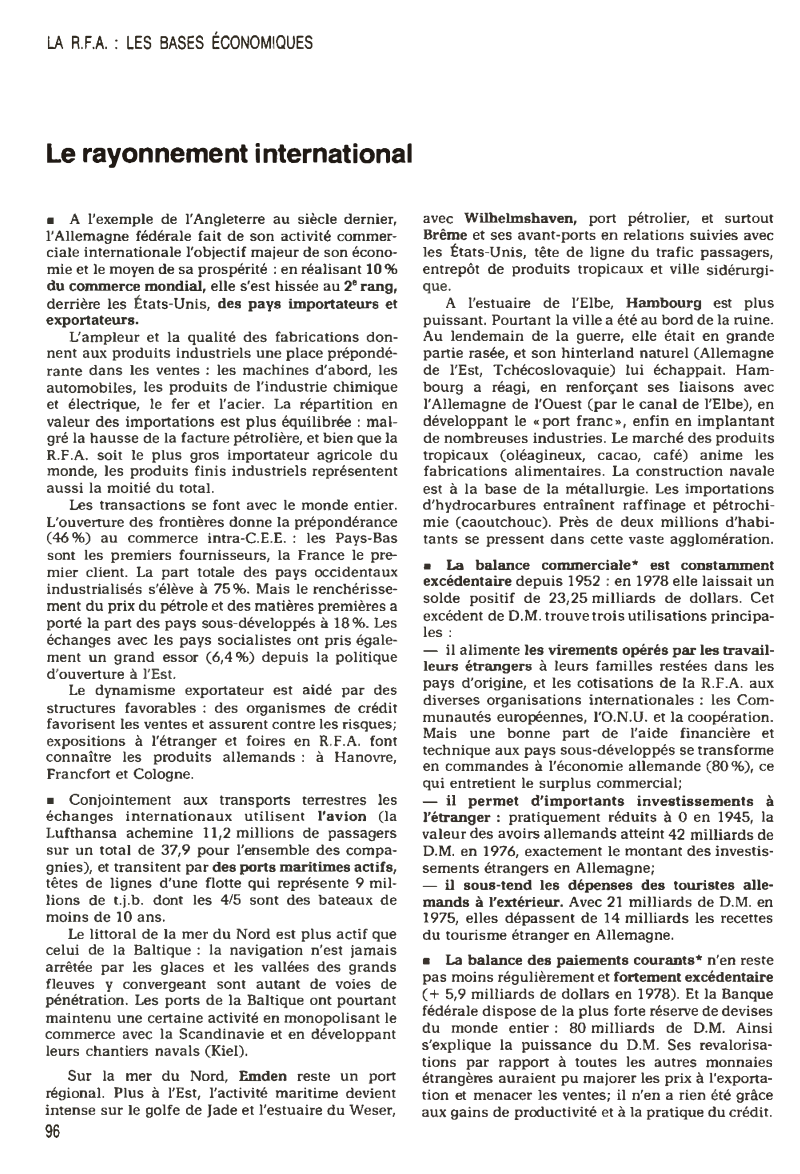LA R.F.A. : LES BASES ÉCONOMIQUES Le rayonnement international ■ A l'exemple de l'Angleterre au siècle dernier, l'Allemagne fédérale fait...
Extrait du document
«
LA R.F.A.
: LES BASES ÉCONOMIQUES
Le rayonnement international
■ A l'exemple de l'Angleterre au siècle dernier,
l'Allemagne fédérale fait de son activité commer
ciale internationale l'objectif majeur de son écono
mie et le moyen de sa prospérité : en réalisant 10 %
du commerce mondial, elle s'est hissée au 2" rang,
derrière les États-Unis, des pays importateurs et
exportateurs.
L'ampleur et la qualité des fabrications don
nent aux produits industriels une place prépondé
rante dans les ventes : les machines d'abord, les
automobiles, les produits de l'industrie chimique
et électrique, le fer et l'acier.
La répartition en
valeur des importations est plus équilibrée : mal
gré la hausse de la facture pétrolière, et bien que la
R.F.A.
soit le plus gros importateur agricole du
monde, les produits finis industriels représentent
aussi la moitié du total.
Les transactions se font avec le monde entier.
L'ouverture des frontières donne la prépondérance
(46 %) au commerce intra-C.E.E.
: les Pays-Bas
sont les premiers fournisseurs, la France le pre
mier client.
La part totale des pays occidentaux
industrialisés s'élève à 75 %.
Mais le renchérisse
ment du prix du pétrole et des matières premières a
porté la part des pays sous-développés à 18%.
Les
échanges avec les pays socialistes ont pris égale
ment un grand essor (6,4 %) depuis la politique
d'ouverture à l'Est.
Le dynamisme exportateur est aidé par des
structures favorables : des organismes de crédit
favorisent les ventes et assurent contre les risques;
expositions à l'étranger et foires en R.F.A.
font
connaitre les produits allemands : à Hanovre,
Francfort et Cologne.
• Conjointement aux transports terrestres les
échanges internationaux utilisent l'avion (la
Lufthansa achemine 11,2 millions de passagers
sur un total de 37,9 pour l'ensemble des compa
gnies), et transitent par des ports maritimes actifs,
têtes de lignes d'une flotte qui représente 9 mil
lions de t.j.b.
dont les 4/5 sont des bateaux de
moins de 10 ans.
Le littoral de la mer du Nord est plus actif que
celui de la Baltique : la navigation n'est jamais
arrêtée par les glaces et les vallées des grands
fleuves y convergeant sont autant de voies de
pénétration.
Les ports de la Baltique ont pourtant
maintenu une certaine activité en monopolisant le
commerce avec la Scandinavie et en développant
leurs chantiers navals (Kiel).
Sur la mer du Nord, Emden reste un port
régional.
Plus à l'Est, l'activité maritime devient
intense sur le golfe de Jade et l'estuaire du Weser,
96
avec Wilhelmshaven, port pétrolier, et surtout
Brême et ses avant-ports en relations suivies avec
les États-Unis, tête de ligne du trafic passagers,
entrepôt de produits tropicaux et ville sidérurgi
que.
A l'estuaire de l'Elbe, Hambourg est plus
puissant.
Pourtant la ville a été au bord de la ruine.
Au lendemain de la guerre, elle était en grande
partie rasée, et son hinterland naturel (Allemagne
de l'Est, Tchécoslovaquie) lui échappait.
Ham
bourg a réagi, en renforçant ses liaisons avec
l'Allemagne de l'Ouest (par le canal de l'Elbe), en
développant le « port franc», enfin en implantant
de nombreuses industries.
Le marché des produits
tropicaux (oléagineux, cacao, café) anime les
fabrications alimentaires.
La construction navale
est à la base de la métallurgie.
Les importations
d'hydrocarbures entraînent raffinage et pétrochi
mi e (caoutchouc).
Près de deux millions d'habi
tants se pressent dans cette vaste agglomération.
■ La balance commerciale* est constamment
excédentaire depuis 1952 : en 1978 elle laissait un
solde positif de 23,25 milliards de dollars.
Cet
excédent de O.M.
trouve trois utilisations principa
les:
- il....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓