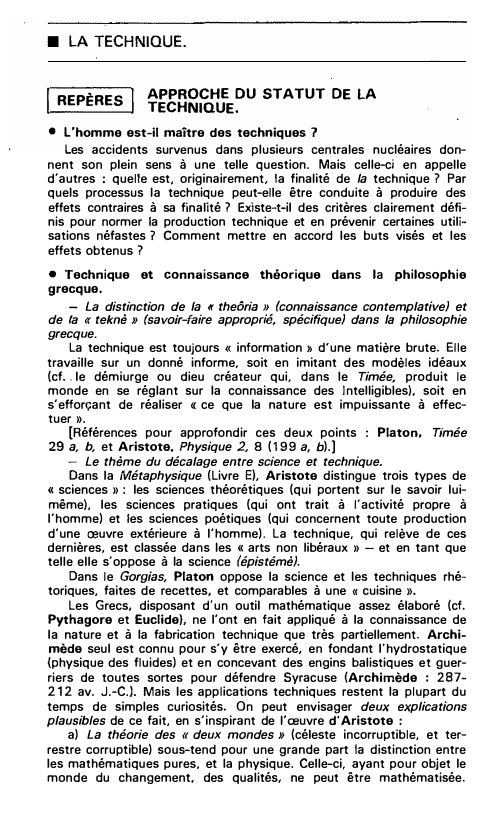■ LA TECHNIQUE. APPROCHE DU STATUT DE LA 1 REPÈRES j TECHNIQUE. • L'homme est-il maître des techniques? Les accidents...
Extrait du document
«
■ LA TECHNIQUE.
APPROCHE DU STATUT DE LA
1 REPÈRES j TECHNIQUE.
• L'homme est-il maître des techniques?
Les accidents survenus dans plusieurs centrales nucléaires don
nent son plein sens à une telle question.
Mais celle-ci en appelle
d'autres : quelle est, originairement, la finalité de la technique? Par
quels processus la technique peut-elle être conduite à produire des
effets contraires à sa finalité? Existe-t-il des critères clairement défi
nis pour normer la production technique et en prévenir certaines utili
sations néfastes ? Comment mettre en accord les buts visés et les
effets obtenus?
• Technique et connaissance théorique dans la philosophie
grecque.
- La distinction de la « theôria » (connaissance contemplative) et
de la « teknè » (savoir-faire approprié, spécifique) dans la philosophie
grecque.
La technique est toujours « information>> d'une matière brute.
Elle
travaille sur un donné informe, soit en imitant des modèles idéaux
(cf.
, le démiurge ou dieu créateur qui, dans le Timée, produit le
monde en se réglant sur la connaissance des Intelligibles), soit en
s'efforçant de réaliser (< ce que la nature est impuissante à effec
tuer».
[Références pour approfondir ces deux points : Platon, Timée
29 a, b, et Aristote.
Physique 2, 8 ( 199 a, b).]
- Le thème du décalage entre science et technique.
Dans la Métaphysique (Livre El, Aristote distingue trois types de
« sciences» : les sciences théorétiques (qui portent sur le savoir lui
même), les sciences pratiques (qui ont trait à l'activité propre à
l'homme) et les sciences poétiques (qui concernent toute production
d'une œuvre extérieure à l'homme).
La technique, qui relève de ces
dernières, est classée dans les « arts non libéraux » - et en tant que
telle elle s'oppose à la science (épistémè).
Dans le Gorgias, Platon oppose la science et les techniques rhé
toriques, faites de recettes, et comparables à une « cuisine >>.
Les Grecs, disposant d'un outil mathématique assez élaboré (cf.
Pythagore et Euclide), ne l'ont en fait appliqué à la connaissance de
la nature et à la fabrication technique que très partiellement.
Archi
mède seul est connu pour s·y être exercé, en fondant l'hydrostatique
{physique des fluides) et en concevant des engins balistiques et guer
riers de toutes sortes pour défendre Syracuse (Archimède : 287212 av.
J.-C.J.
Mais les applications techniques restent la plupart du
temps de simples curiosités.
On peut envisager deux explications
plausibles de ce fait, en s'inspirant de l'œuvre d'Aristote :
a) La théorie des « deux mondes » (céleste incorruptible, et ter
restre corruptible) sous-tend pour une grande part 1a distinction entre
les mathématiques pures, et la physique.
Celle-ci, ayant pour objet le
monde du changement, des qualités, ne peut être mathématisée.
L'élaboration d'une physique scientifique rendant possible une techni
que rigoureuse et méthodique ne peut s'inscrire dans une telle pro
blématique.
b) La théorie aristotélicienne de l'esclavage assigne le domaine
de la production matérielle et de la technique à la sphère de I'« habi
leté pratique acquise par habitude » (cf.
l'opposition de l'habileté et
de la théorie comme « connaissance des causes ».
in Métaphysique
A, 1, 981 b, Éditions Vrin, page 7).
Le rôle économique des escla
ves, tel qu'il est pensé par Aristote, est associé à une justification
de la nécessité du travail producteur.
L'automation qui rendrait inu
tile ce travail, et partant l'esclavage, n'est envisagée que comme
hypothèse.
Cf.
sur ce point Aristote.
Politique 1, 4 : « Si les navet
tes tissaient d'elles-mêmes (...
) ni les chefs d'artisans n'auraient be
soin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves »...
{Éditions Vrin, page 35).
• Science et technique dans l'épistémologie moderne.
Depuis Bacon et Descartes, l'idéal d'une maîtrise de la nature
rendue possible par une connaissance rigoureuse de ses déterminis
mes n'a cessé de se confirmer (cf.
Descartes, Discours de la mé
thode : l'homme sera comme « maître et possesseur de la nature »).
Avec l'épistémologie moderne, c'est le rapport entre science et tech
nique qui est pensé aussi méthodiquement que possible.
L'opposition
entre les techniques empiriques et les techniques reposant sur une
théorie scientifique rigoureuse pourra être illustrée par un texte de
Bachelard concernant la « découverte » de la lampe électrique (cf.
Bachelard, Le Rationalisme appliqué, pages 105 et suivantes, édi
tion des Presses Universitaires de France).: la théorie de la combus
tion (combinaison du corps qui brûle avec l'oxygène de l'air) conduit
à la technique de la lampe où l'on fait le vide pour préserver le
filament porté à incandescence.
C'est bien une théorie (la chimie de
l'oxygène et de la combustion) qui rend ici possible une conquête
technique d'importance
...
« Il faut avoir compris qu'une combustion est une combinaison,
et non pas le développement d'une puissance substantielle, pour em
pêcher cette combustion.
La chimie de l'oxygène a réformé -de fond
en comble la connaissance des combustions.
Dans une technique de
non-combustion, Edison crée l'ampoule électrique, le verre de lampe
fermé, la lampe sans tirage.
L'ampoule n'est pas faite pour empêcher
la lampe d'être agitée par les courants d'air.
Elle est faite pour gar
der le vide autour du filament.
La lampe électrique n'a absolument
aucun caractère constitutif commun avec la lampe ordinaire.
>> (Ou
vrage cité, même référence.)
• Art et technique : des activités historiquement déterminées.
L'analyse générale des historiens de l'art et de la civilisation tend
à mettre en évidence les parentés effectives existant entre les diffé
rentes formes de l'activité humaine à une même époque : art et
technique sont solidaires au niveau de leurs thèmes, de leurs nor
mes, des formes de représentation qu'ils mettent en œuvre (cf.
sur
ce point l'ouvrage de Pierre Francastel, Art et technique, Éditions
Gonthier, collection « Médiations »J.
On peut donner un exemple illustrant ces parentés : celui de la
naissance d'une nouvelle représentation de l'espace (notamment
avec une construction mathématique de la perspective} au début de
la Renaissance italienne dans l'art pictural (cf.
Francastel.
Peinture
et société, Éditions Gallimard, collection « Idées-arts »}.
[ROUEN FGH]
L'ouvrier adhère à l'expérience ; il ne perd jamais le contact; mais le
théoricien aussi, à sa manière ; et le technicien se trouve placé entre ces
deux extrêmes.
Palissy (1 ), autant qu'on sait, était un ouvrier d'émaux;
mais non pas un pur ouvrier, car il cherchait.
Le propre de l'ouvrier c'est
qu'il invente sans chercher,· et peut-être en refusant de chercher.
Guidé
par la chose, par l'invariable outil, par la tradition, il ne se fie jamais à
ce qui est nouveau ; il invente par des changements imperceptibles à
lui-même.
La pirogue, la voile, l'arc, le moulin à vent, l'agriculture, la
cuisine, l'art de dresser et d'élever les animaux, sont dus à cette pratique
serrée et prudente, pendant une immense durée, de maître en apprenti,
et, plus anciennement de père en fils.
L'art du luthier (2) est un de ceux
où l'on peut admirer un lent progrès par pure imitation.
La technique s'y
met présentement, et l'on tente de produire des sons de violoncelle sans
violoncelle.
A l'autre extrême, un Helmholtz (3) analyse les timbres, et
nous apprend de quels sons harmoniques se composent les voyelles.
Tous
suivent l'expérience, et interrogent la chose.
Le premier suit les procédés
connus ; le second invente des procédés; Je troisième cherche à compren
dre, c'est-à-dire à débrouiller ses propres idées.
ALAIN
(11 Bernard Palissy ( 1510-1590) : célèbre potier qui rechercha le secret des faïences
émaillées.
(2) Luthier : fabricant d'instruments de musique à cordes.
(3) Helmholtz : physicien allemand ( 1821-1894) qui a publié, entre autres, une théorie
mathématique des sons.
1 °) Qu'est-ce qui, dans ce texte, réunit et distingue à la fois l'ouvrier (ou
l'artisan), le technicien et le théoricien?
2") Comment le théoricien adhère-t-il « à sa manière" à l'expérience?
3°) Expliquez, puis discutez brièvement : « Le propre de l'ouvrier c'est
qu'il invente sans chercher, et peut-être en refusant de chercher.
"
4°) Après avoir lu ce texte, comment définiriez-vous les rapports entre
science et technique?
■ L'ART.
REPÈRES
LA RE PRÉSENT ATION ARTISTIQUE
ÉLÉMENTS D'ANALYSE.
• Point de vue terminologique.
La différenciation de l'art comme activité particulière au sein de la
vie sociale est assez récente dans notre culture.
Avant de désigner
ce qui se rapporte à l'expression esthétique proprement dite, l'art,
dans le droit fil de I'éthymologie latine (ars), recouvrait tout savoir-
faire approprié, c'est-à-dire propre à un objet déterminé.
Aujourd'hui
encore, la distinction entre l'artiste et l'artisan peut sembler quelque
fois floue.
On comprend que la recherche d'un critère permettant
d'identifier « l'art esthétique», que Kant oppose à « l'art mécani
que» (Critique de la faculté de juger, 1, § 44) fasse l'objet d'une
réflexion particulière.
Peut-on encore parler de « représentation artis
tique» et, si oui, comment qualifier cette représentation ? Le déve
loppement de l'art moderne éclaire cette question sous un angle
nouveau en libérant toujours plus l'expression artistique des « modè
les naturels» (cf.
Dora Valier, L 'Art abstrait, Livre de poche).
• Première approche : l'art comme représentation, et le pro
blème du beau artistique.
On connaît la célèbre formule de Kant : « L'art est la belle repré
sentation d'une chose et non la représentation d'une belle chose»
(cf.
Critique de la faculté de juger, 1, § 48, Éditions Vrin, pages 141
et suivantes).
L'analyse des implications de cette formule est intéres
sante à plus d'un titre.
La citation se présente d'emblée comme l'énoncé de deux thè
ses : ce que l'art est; ce que l'art n'est pas.
Vise-t-elle, dans l'op
position de ces thèses, à définir l'essence même de l'art, saisi
comme donnée spécifique, ou se réduit-elle à une simple caractérisa
tion de l'art, qui pourrait être par ailleurs défini autrement ? Les deux
thèses en présence semblent désigner deux activités distinctes, qu'il
nous appartiendra de définir.
Notons simplement que les deux thèses
se refèrent au beau, mais d'une manière inverse.
Dans le premier
cas, le beau caractérise une activité ou son produit (« représenta
tion») ; dans le second cas, il se rapporte à un objet qui sert de
modèle (ou de prétexte) pour la représentation.
Cette seule inversion
semble fournir le critère distinctif de l'art, mais elle implique toute
une série de déterminations qu'il' convient de dégager.
En mettant
l'accent sur l'activité productrice comme visée d'un effet particulier
(une « belle représentation»), la citation semble émanciper l'art de
toute fonction strictement figurative.
La conformité au modèle passe
au second plan, la « manière» ou le « style» devient l'essentiel.
Mais dans le même temps, on maintient la référence à la « représen
tation d'une chose».
Paradoxe apparent, qui ne signifie pas autre
chose, semble-t-il, qu'une exigence de conciliation....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓