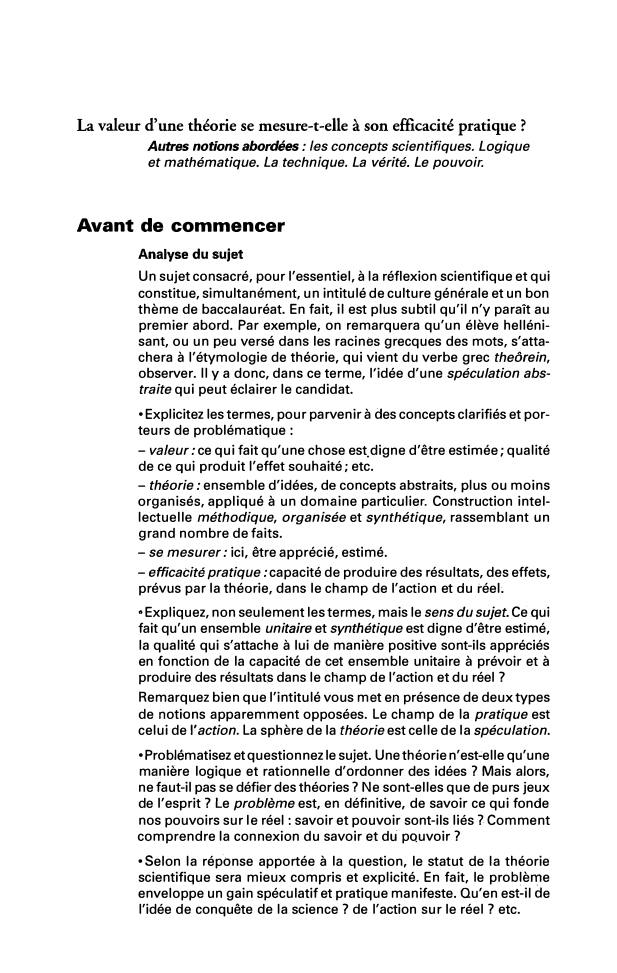La valeur d'une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pratique? Autres notions abordées: les concepts scientifiques. Logique et mathématique. La....
Extrait du document
«
La valeur d'une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pratique?
Autres notions abordées: les concepts scientifiques.
Logique
et mathématique.
La.
technique.
La vérité.
Le pouvoir.
Avant de commencer
Analyse du sujet
Un sujet consacré, pour l'essentiel, à la réflexion scientifique et qui
constitue, simultanément, un intitulé de culture générale et un bon
thème de baccalauréat.
En fait, il est plus subtil qu'il n'y paraît au
premier abord.
Par exemple, on remarquera qu'un élève helléni
sant, ou un peu versé dans les racines grecques des mots, s'atta
chera à l'étymologie de théorie, qui vient du verbe grec theôrein,
observer.
Il y a donc, dans ce terme, l'idée d'une spéculation abs
traite qui peut éclairer le candidat.
• Explicitez les termes, pour parvenir à des concepts clarifiés et por
teurs de problématique:
- valeur: ce qui fait qu'une chose est.
digne d'être estimée; qualité
de ce qui produit l'effet souhaité; etc.
- théorie: ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins
organisés, appliqué à un domaine particulier.
Construction intel
lectuelle méthodique, organisée et synthétique, rassemblant un
grand nombre de faits.
- se mesurer: ici, être apprécié, estimé.
- efficacité pratique: capacité de produire des résultats, des effets,
prévus par la théorie, dans le champ de l'action et du réel.
• Expliquez, non seulement les termes, mais le sens du sujet.
Ce qui
fait qu'un ensemble unitaire et synthétique est digne d'être estimé,
la qualité qui s'attache à lui de manière positive sont-ils appréciés
en fonction de la capacité de cet ensemble unitaire à prévoir et à
produire des résultats dans le champ de l'action et du réel?
Remarquez bien que l'intitulé vous met en présence de deux types
de notions apparemment opposées.
Le champ de la pratique est
celui de l'action.
La sphère de la théorie est celle de la spéculation.
• Problématisez et questionnez le sujet.
Une théorie n'est0elle qu'une
manière logique et rationnelle d'ordonner des idées ? Mais alors,
ne faut-il pas se défier des théories 7 Ne sont-elles que de purs jeux
de l'esprit? Le problème est, en définitive, de savoir ce qui fonde
nos pouvoirs sur le réel: savoir et pouvoir sont-ils liés? Comment
comprendre la connexion du savoir et dü pouvoir?
• Selon la réponse apportée à la question, le statut de la théorie
scientifique sera mieux compris et explicité.
En fait, le problème
enveloppe un gain spéculatif et pratique manifeste.
Qu'en esHI de
l'idée de conquête de la science? de l'action sur le réel? etc.
Plan
Quel plan appliquer à l'intitulé, à quelle organisation recourir? En
fait, l'énoncé est tel, à travers la formulation de termes antithé
tiques, qu'il est difficile de résister à l'appel du plan dialectique,
par thèse, antithèse et synthèse.
Voici ce plan
Introduction
Problématique: comment saisir le lien du savoir et du pouvoir?
Discussion
A) La valeur d'une théorie ne se mesure pas à son efficacité pratique
(thèse)
Une théorie vaut d'abord par son libre jeu spéculatif.
B) Le seul critère du vrai étant l'action, la valeur d'une théorie se
mesure au critère de l'activité pratique (antithèse)
Une théorie vaut quand elle transforme le monde.
C) Théorie et pratique sont les deux facettes de l'esprit en marche
(synthèse)
Le savoir est le pouvoir et réciproquement.
Conclusion
Savoir et pouvoir sont deux notions complémentairns.
Bibliographie
DESCARTES, Discours de la méthode, 6' partie, éditions de poche di
verses.
EINSTEIN et INFELD, L'Évolution des idées en physique, Petite Biblio
thèque Payot.
HADOT, Qu'est-ce que la philosophie antique ?, Folio Essais
Gallimard.
MARX, Thèses sur Feuerbach, in Sur la religion, Éditions sociales.
1) Introduction
La qualité rendant digne d'être estimé et s'attachant à un ensemble unitaire et
synthétique intégrant un grand nombre de faits et de lois s'apprécie+elle en
fonction de la capacité de cet ensemble à produire des résultats pratiques ? Ici
l'intitulé est explicité à partir de la notion de théorie scientifique, conçue comme
une construction intellectuelle et méthodique, construction comportant di::s prin
cipes et des lois.
Ainsi parle+on de la« théorie de la relativité» ou de la« théo
rie du champ unitaire », qui ferait la synthèse des conceptions sur les interac
tions nucléaires, électromagnétiques et de gravitation.
Mais, à l'évidence, on
peut ici élargir la notion de théorie, laquelle, au sens général du terme, peut dé
signer un ensemble organisé de concepts abstraits, appliqué à un domaine par
ticulier.
Ainsi peut-on parler d'une théorie artistique ou d'une théorie politique.
Une théorie n'est-elle qu'une organisation logique et rationnelle d'idées ? Ne
sera-t-elle pas alors un pur jeu de l'esprit? Mais l'homme ne se définit-il pas comme
celui qui veut se faire le maître des choses ? Faut-il dès lors disjoindre savoir et
pouvoir? Comment comprendre la nécessaire connexion du savoir et du pou
• voir ? C'est bel et bien le fondement du pouvoir qui se dessine comme hori
zon de la question.
Nous atteignons ici le problème et comprenons l'enjeu, le
gain spéculatif et pratique dans un champ central de la réflexion.
2) Discussion
A.
La théorie, libre jeu spéculatif (thèse)
•
,.
La valeur d'une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pratique? En première
· analyse, l'idée même de théorie, que ce soit dans une perspective générale ou
dans une perspective scientifique, conduit à répondre de manière négative à la
question posée.
:i
i Theôria signifie, en grec, vue intellectuelle, spéculation, action d'observer.
D'où
· ridée de théorie, de connaissance spéculative et désintéressée, par opposition à
la pratique.
Dans !'Antiquité, la théorie apparaît comme une réflexion pure
ment contemplative, dont la valeur ne se mesure nullement à l'aune de l'effi
cacité pratique.
Bien au contraire, les Grecs voient dans la contemplation pure
le sommet de toute activité intellectuelle et, à la Renaissance, l'humanité eu
.
ropéenne, retrouvant l'image antique, privilégie la dimension théorétique: de
!'Antiquité à la Renaissance, la valeur de la théorie se mesure à sa dimension
.
désintéressée: se détournant de tous les intérêts pratiques, l'homme élabore l'idée
d'une doctrine totalisante, rassemblant les diverses réalités particulières et ce au
sein d'un système théorétique, voué à la saisie intellectuelle du réel.
Un en
semble unitaire rassemble alors les différents savoirs et la valeur de cet ensemble
se dégage de sa fonction unificatrice en tant que telle, non point de la notion
! d'activité pratique.
En d'autres termes, la théorie philosophique, des Anciens jus" qu'à la Renaissance et au XVII' siècle, unifie les sciences particulières au sein
· d'un système global.
D'où la théorie tire-t-elle sa valeur ? De sa dimension
,• désintéressée, de son caractère nécessaire et universel.
En bref, c'est la passion de
,Ja connaissance qui s'assouvit en tant que telle dans la théorie.
« C'est ainsi
qu'un édifice unique, en perpétuelle construction à travers l'infinité des géné
rations, l'édifice des vérités définitives théorétiquement liées entre elles, devait
: donner la réponse à tous les problèmes imaginables, que ce soit les problèmes
· de fait ou les problèmes de raison » (Husserl, La Crise de l'humanité européenne
et la philosophie, Gallimard, p.
11).
Ici la valeur de la théorie se mesure à sa
'capacité de problématisation, de réponse au problème.
: Qu'en est-il dans le domaine de la théorie scientifique, et non plus de la théorie
au sens global et philosophique du terme? Sa valeur se mesure-t-elle à son ef
ficacité pratique? Point du tout.
En physique, la valeur d'une théorie se mesure
· à sa capacité de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓