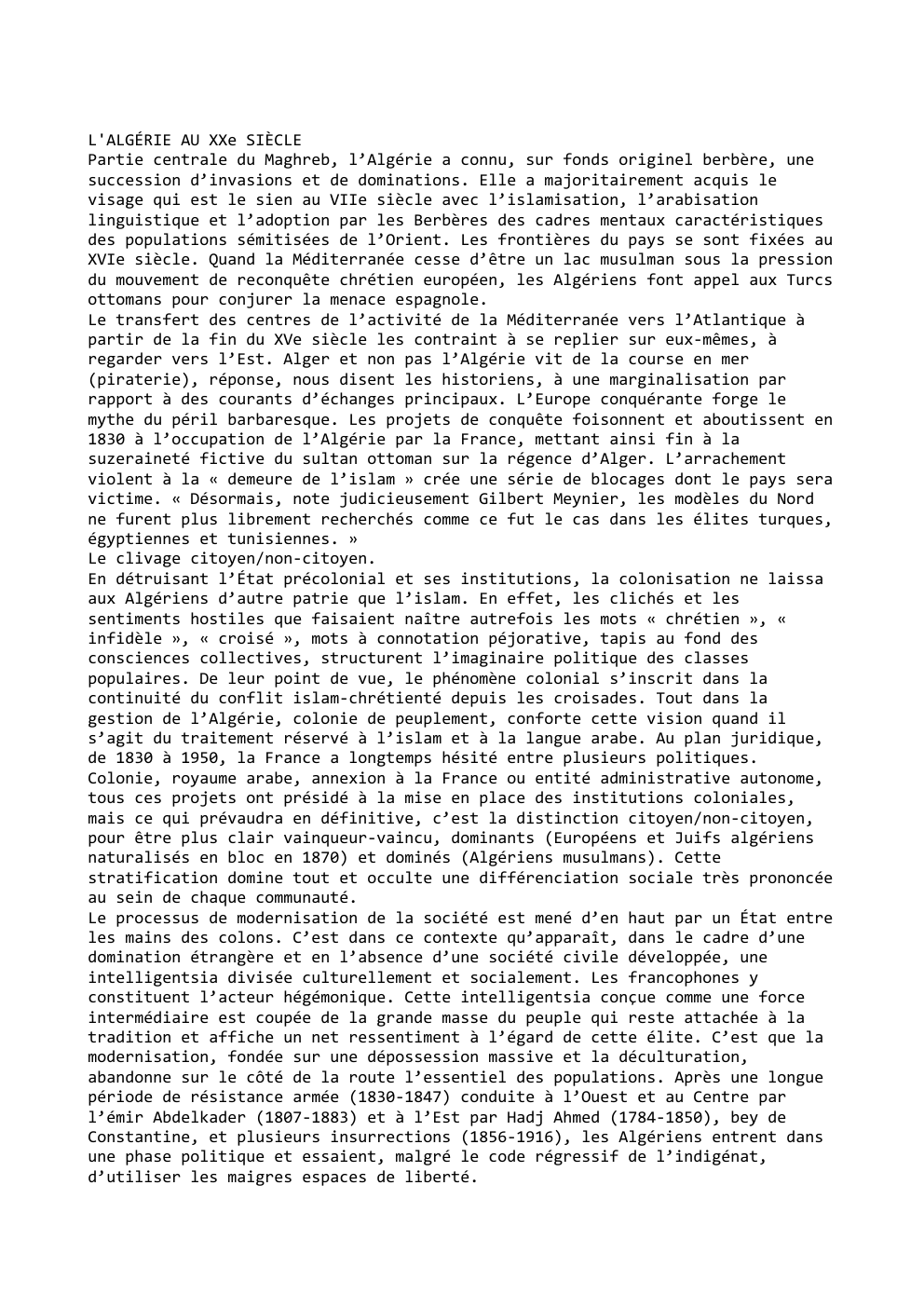L'ALGÉRIE AU XXe SIÈCLE Partie centrale du Maghreb, l’Algérie a connu, sur fonds originel berbère, une succession d’invasions et de...
Extrait du document
«
L'ALGÉRIE AU XXe SIÈCLE
Partie centrale du Maghreb, l’Algérie a connu, sur fonds originel berbère, une
succession d’invasions et de dominations.
Elle a majoritairement acquis le
visage qui est le sien au VIIe siècle avec l’islamisation, l’arabisation
linguistique et l’adoption par les Berbères des cadres mentaux caractéristiques
des populations sémitisées de l’Orient.
Les frontières du pays se sont fixées au
XVIe siècle.
Quand la Méditerranée cesse d’être un lac musulman sous la pression
du mouvement de reconquête chrétien européen, les Algériens font appel aux Turcs
ottomans pour conjurer la menace espagnole.
Le transfert des centres de l’activité de la Méditerranée vers l’Atlantique à
partir de la fin du XVe siècle les contraint à se replier sur eux-mêmes, à
regarder vers l’Est.
Alger et non pas l’Algérie vit de la course en mer
(piraterie), réponse, nous disent les historiens, à une marginalisation par
rapport à des courants d’échanges principaux.
L’Europe conquérante forge le
mythe du péril barbaresque.
Les projets de conquête foisonnent et aboutissent en
1830 à l’occupation de l’Algérie par la France, mettant ainsi fin à la
suzeraineté fictive du sultan ottoman sur la régence d’Alger.
L’arrachement
violent à la « demeure de l’islam » crée une série de blocages dont le pays sera
victime.
« Désormais, note judicieusement Gilbert Meynier, les modèles du Nord
ne furent plus librement recherchés comme ce fut le cas dans les élites turques,
égyptiennes et tunisiennes.
»
Le clivage citoyen/non-citoyen.
En détruisant l’État précolonial et ses institutions, la colonisation ne laissa
aux Algériens d’autre patrie que l’islam.
En effet, les clichés et les
sentiments hostiles que faisaient naître autrefois les mots « chrétien », «
infidèle », « croisé », mots à connotation péjorative, tapis au fond des
consciences collectives, structurent l’imaginaire politique des classes
populaires.
De leur point de vue, le phénomène colonial s’inscrit dans la
continuité du conflit islam-chrétienté depuis les croisades.
Tout dans la
gestion de l’Algérie, colonie de peuplement, conforte cette vision quand il
s’agit du traitement réservé à l’islam et à la langue arabe.
Au plan juridique,
de 1830 à 1950, la France a longtemps hésité entre plusieurs politiques.
Colonie, royaume arabe, annexion à la France ou entité administrative autonome,
tous ces projets ont présidé à la mise en place des institutions coloniales,
mais ce qui prévaudra en définitive, c’est la distinction citoyen/non-citoyen,
pour être plus clair vainqueur-vaincu, dominants (Européens et Juifs algériens
naturalisés en bloc en 1870) et dominés (Algériens musulmans).
Cette
stratification domine tout et occulte une différenciation sociale très prononcée
au sein de chaque communauté.
Le processus de modernisation de la société est mené d’en haut par un État entre
les mains des colons.
C’est dans ce contexte qu’apparaît, dans le cadre d’une
domination étrangère et en l’absence d’une société civile développée, une
intelligentsia divisée culturellement et socialement.
Les francophones y
constituent l’acteur hégémonique.
Cette intelligentsia conçue comme une force
intermédiaire est coupée de la grande masse du peuple qui reste attachée à la
tradition et affiche un net ressentiment à l’égard de cette élite.
C’est que la
modernisation, fondée sur une dépossession massive et la déculturation,
abandonne sur le côté de la route l’essentiel des populations.
Après une longue
période de résistance armée (1830-1847) conduite à l’Ouest et au Centre par
l’émir Abdelkader (1807-1883) et à l’Est par Hadj Ahmed (1784-1850), bey de
Constantine, et plusieurs insurrections (1856-1916), les Algériens entrent dans
une phase politique et essaient, malgré le code régressif de l’indigénat,
d’utiliser les maigres espaces de liberté.
Réformisme et national-populisme.
De 1830 à 1954, le réformisme politique des élites algériennes incarné par les
assimilationnistes, puis à partir de 1925 par les Ulama, bute sur deux écueils.
D’une part, les Européens défenseurs du statu quo bloquent toute issue
pacifique.
D’autre part, le sentiment de victimisation et la vision millénariste
du devenir, dominante dans les classes pauvres des villes et chez les ruraux,
rendent inopérante la démarche réformatrice des élites politiques.
On comprendra
mieux pourquoi leur éveil politique, au cours de la Seconde Guerre mondiale, se
traduit par une adhésion massive au national-populisme de Messali Hadj, en scène
depuis 1926, minoritaire jusqu’en 1940, mais toujours intransigeant sur son but,
l’indépendance du pays.
Sa bataille contre les assimilationnistes (Mohammed
Bendjelloul et Ferhat Abbas jusqu’en 1940) et contre la recherche d’une formule
de protectorat (Cheikh Ben Badis et Bachir El Ibrahimi [1889-1965]) portera ses
fruits.
En effet, en 1947, à l’issue des élections municipales d’octobre, son
parti, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), autre
dénomination du PPA (Parti du peuple algérien), deviendra la première force
politique.
Le radicalisme, un moment amorti par la répression, sera relancé en 1954 par la
scission du MTLD et surtout par la montée des luttes au Maghreb et l’intérêt
manifesté pour cette zone par le nassérisme.
C’est ainsi que Messali, encore aux
prises avec les conséquences d’une scission qu’il a voulue et organisée, est
dépassé par ses propres disciples qui, du point de vue idéologique, lui
empruntent l’idée de l’identification du peuple au parti et du parti à sa
direction.
Mais, l’hégémonie qu’il voulait acquérir sur les partis adverses par
la politique et l’appui populaire, ses enfants illégitimes qui créent le FLN
(Front de libération nationale), lui abandonnant l’étiquette de
Co
ri ht © La Découverte 2006
Pa e 1 sur 2
Encyclopédie de l'État du monde
Mouvement national algérien (MNA), l’obtiendront d’une manière autoritaire et en
militarisant la vie politique.
Dans leur optique, les éléments gênants dont il
faut se débarrasser, ce sont les concurrents qui refusent leur monopole, même
s’ils sont d’accord pour la lutte armée.
Une classe politique instrumentalisée et marginalisée.
Avec l’insurrection du 1er novembre 1954 et la décision du FLN de marginaliser
la classe politique formée depuis le début du siècle tout en
l’instrumentalisant, l’Algérie connaît, pour la seconde fois de son histoire, un
désencadrement massif, la France ayant la première détruit les élites
précoloniales militairement ou en les condamnant à l’exil dans les pays
islamiques.
Les nouvelles élites politiques, recrutées dans le monde rural, sont
parties d’un niveau très bas.
On va dès lors....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓