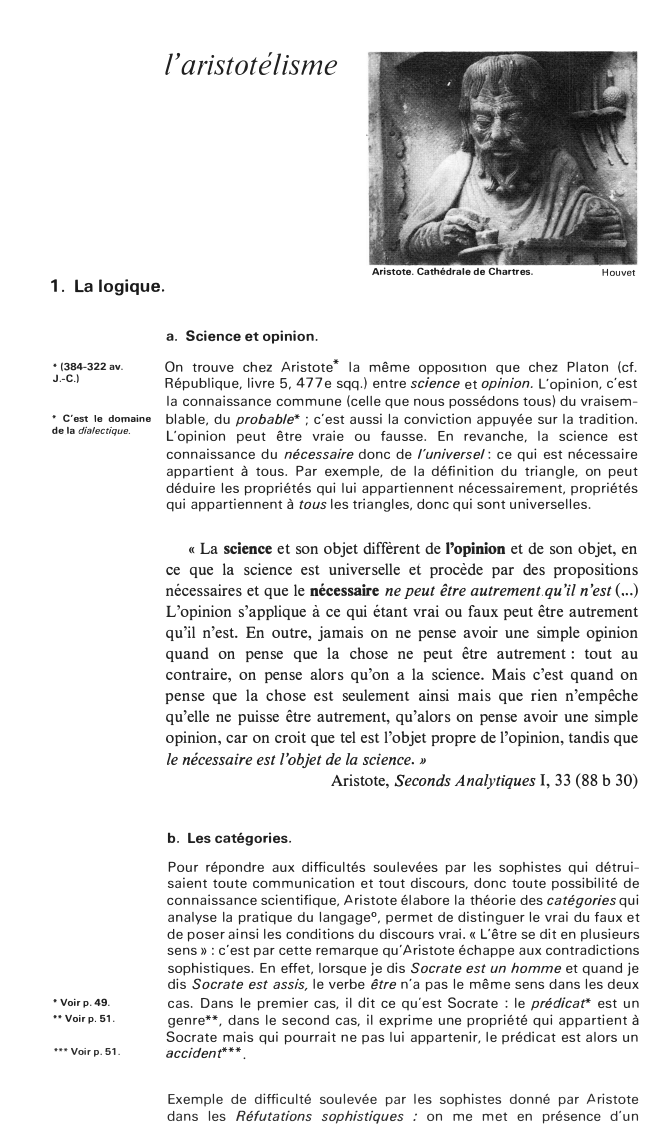l'aristotélisme Aristote. Cathédrale de Chartres. 1. La logique. Houvet a. Science et opinion. • (384-322 av. J.-C.) * C'est le...
Extrait du document
«
l'aristotélisme
Aristote.
Cathédrale de Chartres.
1.
La logique.
Houvet
a.
Science et opinion.
• (384-322 av.
J.-C.)
* C'est le domaine
de Ja dialectique.
On trouve chez Aristote* la même oppos1t1on que chez Platon (cf.
République, livre 5, 477e sqq.) entre science et opinion.
L'opinion, c'est
la connaissance commune (celle que nous possédons tous) du vraisem
blable, du probable*; c'est aussi la conviction appuyée sur la tradition.
L'opinion peut être vraie ou fausse.
En revanche, la science est
connaissance du nécessaire donc de l'universel: ce qui est nécessaire
appartient à tous.
Par exemple, de la définition du triangle, on peut
déduire les propriétés qui lui appartiennent nécessairement, propriétés
qui appartiennent à tous les triangles, donc qui sont universelles.
« La science et son objet diffèrent de l'opinion et de son objet, en
ce que la science est universelle et procède par des propositions
nécessaires et que le nécessaire ne peut être autrement.qu'il n'est( ...)
L'opinion s'applique à ce qui étant vrai ou faux peut être autrement
qu'il n'est.
En outre, jamais on ne pense avoir une simple opinion
quand on pense que la chose ne peut être autrement : tout au
contraire, on pense alors qu'on a la science.
Mais c'est quand on
pense que la chose est seulement ainsi mais que rien n'empêche
qu'elle ne puisse être autrement, qu'alors on pense avoir une simple
opinion, car on croit que tel est l'objet propre de l'opinion, tandis que
le nécessaire est l'objet de la science.
))
Aristote, Seconds Analytiques I, 33 (88 b 30)
b.
Les catégories.
* Voir p.
49.
** Voir p.
51.
*** Voir p.
51.
Pour répondre aux difficultés soulevées par les sophistes qui détrui
saient toute communication et tout discours, donc toute possibilité de
connaissance scientifique, Aristote élabore la théorie des catégories qui
analyse la pratique du langage 0 , permet de distinguer le vrai du faux et
de poser ainsi les conditions du discours vrai.« L'être se dit en plusieurs
sens»: c'est par cette remarque qu'Aristote échappe aux contradictions
sophistiques.
En effet, lorsque je dis Socrate est un homme et quand je
dis Socrate est assis, le verbe être n'a pas le même sens dans les deux
cas.
Dans le premier cas, il dit ce qu'est Socrate : le prédicat* est un
genre**, dans le second cas, il exprime une propriété qui appartient à
Socrate mais qui pourrait ne pas lui appartenir, le prédicat est alors un
àccident***.
Exemple de difficulté soulevée par les sophistes donné par Aristote
dans les Réfutations sophistiques : on me met en présence d'un
homme voilé et on me demande si je le connais.
Je réponds non.
Une
fois le voile enlevé, je suis obligé d'admettre que je le connais : c'est
mon père.
Donc, je connais et je ne connais pas le même homme.
« L'être se prend en de multiples sens : en un sens, il signifie ce
qu'est la chose, la substance, et en un autre sens, il signifie une qualité
ou une quantité, ou l'un des autres prédicats de cette sorte.
Mais
entre toutes ces acceptions de l'être, il est clair que l'être au sens
premier est le « ce qu'est la chose », notion qui n'exprime rien d'autre
que la substance (...) En effet, [quand nous exprimons ce qu'est la
chose], nous ne disons pas qu'elle est blanche ou chaude, ni qu'elle a
trois coudées, mais qu'elle est un homme ou un dieu.
Les autres
choses ne sont appelées des êtres, que parce qu'elles sont ou des
quantités de l'être proprement dit, ou des- qualités, ou des affections
de cet être, ou quelque autre détermination de ce genre.
Aussi
pourrait-on se demander si le se promener, le se bien porter, le être
assis sont des êtres ou ne sont pas des êtres (...) car aucun de ces
états n'a par lui-même naturellement une existence propre, ni ne peut
être séparé de la substance, mais s'il y a quelque être, c'est bien plutôt
ce qui se proméne qui est un être, ce qui est assis, ce qui se porte bien.
Et ces derniéres choses apparaissent davantage des êtres, parce qu'il
y a, sous chacune d'elles, un sujet réel et déterminé : ce qui se
manifeste dans une telle catégorie, car le bon ou l'assis ne sont jamais
dits sans lui.
Il est donc évident que c'est par le moyen de cette
catégorie que chacune des autres catégories existe.
Aristote, Métaphysique, Z, I
Aristote procède ensuite à une classification des différentes catégories,
c'est-à-dire des différentes formes de l'attribution.
Les catégories sont « la subsfance, la quantité, la qualité, la
relation, le lieu, le temps, la ,t:>osition, la possession, l'action, la
passion.
Est substance, pour le dire en un mot, par exemple, homme,
cheval ; quantité, par exemple, long de deux coudées, long de trois
coudées ; qualité : blanc, grammairien ; relation : double, moitié, plus
grand; lieu : dans le Lycée, au Forum ; temps : hier, l'an dernier;
position : il est couché, il est assis ; possession : il est chaussé, il est
armé ; action : il coupe, il brûle ; passion : il est coupé, il est brûlé.
Aucun de ces termes en lui-même n'affirme ni ne nie rien; c'est
seulement par la liaison de ces termes entre eux que se produit
l'affirmation ou la négation.
En effet, toute affirmation et toute
négation est, semble-t-il bien vraie ou fausse, tandis que pour des
expressions sans aucune liaison il n'y a ni vrai ni faux : par exemple,
homme, blanc, court».
Aristote, Catégories, 4
Il donne ainsi une définition du vrai et du faux : la vérité réside dans la
proposition ° et non dans le terme 0 • Une proposition est vraie si elle dit
ce qui est.
« ...c'est dans la composition et la division que consistent le vrai et
le faux.
En eux-mêmes les noms et lès verbes sont semblables à la
notion qui n'a ni composition, ni division : tels sont l'homme, le
blanc, quand on n'y ajoute rien, car ils ne sont encore ni vrais ni faux.
En voici une preuve : bouc-cerf signifie bien quelque chose, mais il
n'est encore ni vrai, ni faux, à moins d'ajouter qu'il est ou qu'il n'est
pas, absolument parlant ou avec référence au temps.
»
Aristote, De l'interprétation, I (16 a 10)
* Cf.
les Catégories
et Métaphysique,
livret,.
Aristote étudie en détail chaque catégorie*.
Les trois catégories fondamentales sont la substance, la qualité et la
quantité, La substance est la catégorie première puisque les autres
catégories ne peuvent être sans elle : il ne peut exister de blanc sans
une chose qui soit blanche.
« C'est la substance qui est absolument première, à la fois
logiquement, dans l'ordre de la connaissance et selon le temps.
En
effet, d'une part, aucune des autres catégories n'existe à l'état séparé,
mais seulement la substance.
D'autre part, elle est aussi première
logiquement, car dans la définition de chaque être est nécessairement
contenue celle de sa substance.
Enfin, nous croyons connaître le plus
parfaitement chaque chose quand nous connaissons ce qu'elle est,
par exemple ce qu'est l'homme ou le feu, bien plutôt que lorsque nous
connaissons sa qualité ou son lieu, puisque chacun de ces prédicats
eux-mêmes, nous les connaissons seulement quand nous con11aissons
ce qu'ils sont, ce qu'est la quantité ou la qualité.
Et en vérité, l'objet
éternel de toutes les recherches présentes et passées, le problème
toujours en suspens : qu'est-ce que l'être? revient à se demander:
qu'est-ce que la substance?>>
Aristote, Métaphysique, Z, I
« J'appelle qualité ce en vertu de quoi on est dit être tel.
Mais la
qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens.
(...)
On appelle dispositions les qualités qui peuvent facilem�nt être
mues et rapidement changées, telles que la chaleur et le refroidisse
ment, la maladie et la santé(...) Un autre genre de.qualité, c'est celui
d'après lequel nous parlons de bons lutteurs ou de bons coureurs, de
bien portants ou de malades, en un mot, tout ce qui est dit selon une
aptitude ou une inaptitude naturelle(...) Un troisième genre de qualité
est formé des qualités affectives et des affections.
Telles sont par
exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté, avec toutes les détermina
tions de même ordre, en y ajoutant la chaleur, la froidure, la
blancheur et la noirceur (...) Une quatrième sorte de qualité
comprend la figure ou la forme, qui appartient à tout être, et, en outre
la droiture et 1� courbure ainsi que toute autre propriété semblable.
Les quall.iés admettent le plus et le moins.
Une chose blanche, en
effet, est dite plus ou moins blanche qu'une autre, et une chose juste,
plus ou moins juste qu'une autre.
En outre, la qualité en elle-même
prend de l'accroissement : ce qui est blanc peut devenir plus blanc
(...)
Par contre, triangle et tétragone ne paraissent pas admettre le
plus et le moins, pas plus qu'aucune autre figure (...).
Toutes les
qualités n'admettent donc pas le plus et le moins.»
Aristote, Catégories, 8
« Quantité se dit de ce qui est divisible en deux ou plusieurs
éléments intégrants, dont chacun est, par nature, une chose une et
individuelle.
Une multiplicité est une quantité si elle est nombrable,
une grandeur, si elle est mesurable.»
Aristote, Métaphysiquef'::., 13
N.B.
La qualité s'oppose à la quantité en ce qu'elle n'est pas
mesurable : elle ne peut comporter que des différences d'intensité.
c.
Le syllogisme, la démonstration.
* Voir p.
89.
** Aristote, premier
créateur d"un sys
tèm e l o g i q u e,
n'emploie pas le
terme de logique.
C'est au XIII' siè
c I e s e ul eme nt
qu'on utilise ce ter
me pour désigner
la syllogistique.
*** l'ensemble des
logiques
écrits
d'Aristote est dési
gné sous le titre
d"Organon, ce qui
signifie en grec
« instrument ».
* Proposition.
* Ex.
: toute plante
à feuilles larges
perd ses feuilles en
hiver.
** Ex.
: quelques
chevaux sont noirs.
*** Ex.
: le plaisir
n'est pas le bien.
(1) Voir exemple p.
50.
* Est logiquement
nécessaire ce dont
la négation impli
que une contradic
tion (voir p.
46).
La science, connaissance vraie, repose sur une démonstration.
Cette
démonstration, c'est le syllogisme* (déductif ou inductif) qui établit
la nécessité d'une conclusion à partir de propositions déjà connues
(prémisses).
Ce qu'on appelle la logique** aristotélicienne est l'étude de
cet instrument*** qu'est le syllogisme.
« Il faut d'abord établir quel est le sujet de notre enquête et de
quelle discipline elle relève : son sujet, c'est la démonstration et c'est
la science démonstrative dont elle dépend.
Ensuite nous devons
définir ce qu'on entend par prémisse par terme, par syllogisme (...)
Après cela, il faudra définir en quoi consiste pour un terme, d'être ou
non contenu dans la totalité d'un autre terme, et ce que nous
entendons par être affirmé universellement et être nié universelle
ment.
La prémisse est le discours* qui affirme ou qui nie quelque chose
de quelque chose et ce discours est soit universel, soit particulier, soit
indéfini.
J'appelle universelle, l'attribution ou la non-attribution à un
sujet pris universellement*, particulière, l'attribution ou la non-attri
bution à un sujet pris particulièrement** ou non universellement;
indéfinie, l'attribution ou la non-attribution faite sans indication
d'universalité ou de particularité*** (...).
J'appelle terme ce en quoi se résoud la prémisse, savoir le prédicat
et le sujet dont il est affirmé (1) (...).
Le syllogisme est ùn discours dans lequel, certaines choses étant
posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessaire
ment* par le seul fait de ces données : je veux dire que c'est par elles
que la conséquence est obtenue (...).
Aucun terme étranger n'est en
sus requis pour produire la conséquence nécessaire.»
Aristote, Premiers Analytiques 1, I (24 a)
« Disons maintenant par quel moyen tout syllogisme s'engendre
(...).
Quand trois termes sont entre eux dans des rapports tels que le
mineur soit contenu dans la totalité du moyen et le moyen contenu,
ou non contenu dans la totalité du majeur, alors il y a nécessairement
entre les extrêmes syllogisme parfait.
J'appelle moyen le terme qui est
lui-même contenu dans un autre terme et contient un autre terme en
lui, et qui occupe aussi une position intermédiaire; j'appelle extrêmes
à la fois le terme qui est lui-même contenu dans un autre et le terme
dans lequel un autre est contenu.
Si tout A est affirmé de tout B, et B
de tout C, nécessairement A est affirmé de tout C (2) (...) De même, si
A n'est affirmé de nul B et si B est affirmé de tout C, il en résulte que
A n'appartient à nul C (3).
»
Aristote, Premiers Analytiques, I, 4
( 1) Exemple :
noirs
sont
quelques chevaux
prédicat
copule
sujet
--- termes ----
(2) Exemple :
(extrême) A= être capable de voler (majeur)
(moyen) B = oiseaux (moyen)
(extrême) C = pingouins (mineur)
Si tous les oiseaux volent
prémisses
et si tous les pingouins sont des oiseaux }
alors tous les pingouins volent.
conclusion
(3) Exemple :
A = mammifère
B = oiseaux
C = pingouins
Si nul oiseau n'est mammifère
et si tous les pingouins sont des oiseaux
alors nul pingouin n'est mammifère.
Le syllogisme est démonstratif lorsqu'il part de prem,sses vraies,
premières et immédiates, c'est-à-dire de principes non démontrables
car, s'ils étaient démontrables ils ne seraient pas premiers, ils seraient
connus à partir d'autres propositions.
Or, on ne saurait remonter à
l'infini.
Mais comment connaissons-nous les principes ? La réponse
d' .Aristote est ambiguë, néanmoins, en ce qui concerne la connaissance
de la nature, les principes sont connus par induction : à partir
d'observations particulières répétées, on peut dégager l'universel.
Si
l'on observe toutes les espèces d'oiseaux connues.
si l'on constate que
chacune de ces espèces pond des œufs, alors on pourra affirmer que
tous les oiseaux pondent des œufs.
Aristote a formalisé l'induction en la
présentant sous forme d'un syllogisme.
« L'"mduction ou syllogisme inductif consiste à conclure, en
s'appuyant sur l'un des extrêmes que l'autre est attribué au moyen.
Par exemple, B étant moyen terme entre A et C, on prouvera par C
que A appartient à B : c'est ainsi en effet que nous faisons nos
inductions.
Admettons que A signifie le fait de vivre longtemps, B le
fait d'être dépourvu de fiel et C les individus à longue vie, soit
homme, cheval, mulet.
A appartient alors à la totalité de C.
Si donc
C se convertit avec B, et que le moyen terme n'a pas plus d'extension
que C, nécessairement A appartient à B (1) (...) Mais il est indispensa
ble de concevoir C comme composé de tous les êtres particuliers, car
l'induction procède par l'énumération d'eux tous.»
Aristote, Premiers Analytiques 2, (23)
( 1) A appartient à B.
soit:
l'homme, le cheval, le mulet, vivent longtemps
l'homme, le cheval, le mulet, sont tous les animaux sans fiel
tous les animaux sans fiel vivent longtemps.
d.
La « définition ».
* La d i chotomie
consiste à diviser
une classe en deux
classes dont les
différences sont
contradictoires;
exemple : on peut
diviser la classe
animal en pédestre
et non-pédestre.
n Le genre qui n'a
en dessous de lui
que des espèces.
"- � * Qui appartien
nent à l'espèce.
* Ce que la chose
est.
• • C'est en effet
donner un synony
me.
* Exemple : animal
est un genre qui
contient des espè
c e s d iffér e n t e s
(homme, bœuf, oi
seau.
papillon).
** D'une manière
propre à l'espèce.
Aristote s'est tout particulièrement intéressé aux êtres vivants ; or, leur
étude repose sur une classification en genres et espèces.
Certaines
classifications dichotomiques* aboutissent à des absurdités : « cer
tains groupes, les fourmis, par exemple, tombent sous les deux
divisions, ailées et non-ailées.» (Aristote, Des parties des animaux, 1, 3
(643b).
La classification correcte sera effectuée en partant des genres
distingués par l'expérience commune (poissons et oiseaux, poulpes et
coquillages), en tenant compte de la structure générale de l'organisme
et du mode d'exercice des fonctions principales.
Définir, c'est d'abord
classer: c'est placer l'objet à définir dans le genre prochain**en
indiquant ce qui permet de le distinguer des autres objets du genre
(différences spécifiques***).
« La définition est un discours qui exprime l'essence* de la chose
( ...) Quand, de quelque façon que ce soit on rend la chose à définir
par un seul terme, il est évident que ce n'est pas là donner la
définition de la chose**.
Le genre* est ce qui est attribué essentiellement à des choses
multiples et différant spécifiquement** entre elles.
Et on doit considé
rer comme prédicats essentiels tous les termes d'une nature telle
qu'ils répondent d'une façon appropriée à la question : qu'est-ce que
le sujet qui est devant vous ? Par exemple, dans le cas de l'homme, si
on demande ce qu'il est, la réponse appropriée est que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓