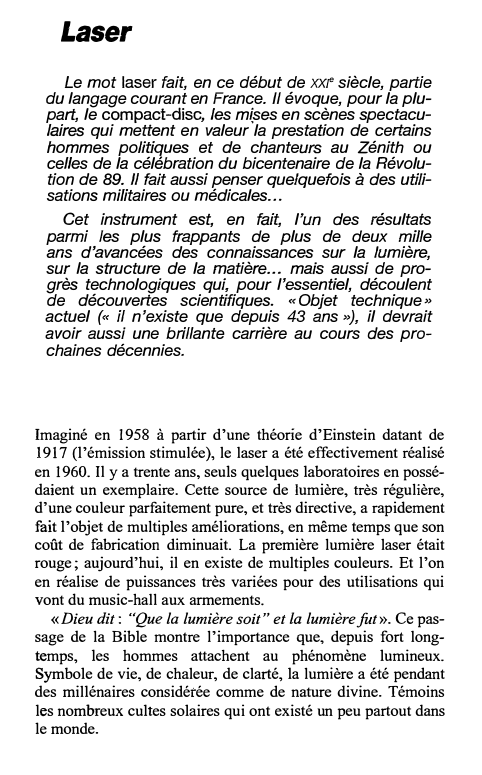Laser Le mot laser fait, en ce début de xxr siècle, partie du langage courant en France. Il évoque, pour...
Extrait du document
«
Laser
Le mot laser fait, en ce début de xxr siècle, partie
du langage courant en France.
Il évoque, pour la plu
part, le compact-dise, /es m{ses en scènes spectacu
laires qui mettent en valeur la prestation de certains
hommes politiques et de chanteurs au Zénith ou
celles de la célébration du bicentenaire de la Révolu
tion de 89.
Il fait aussi penser quelquefois à des utili
sations militaires ou médicales...
Cet instrument est, en fait, l'un des résultats
parmi /es plus frappants de plus de deux mille
ans d'avancées des connaissances sur la lumière,
sur la structure de la matière...
mais aussi de pro
grès technologiques qui, pour l'essentiel, découlent
de découvertes scientifiques.
« Objet technique»
actuel (« il n'existe que depuis 43 ans »), il devrait
avoir aussi une brillante carrière au cours des pro
chaines décennies.
Imaginé en 1958 à partir d'une théorie d'Einstein datant de
1917 (l'émission stimulée), le laser a été effectivement réalisé
en I 960.
Il y a trente ans, seuls quelques laboratoires en possé
daient un exemplaire.
Cette source de lumière, très régulière,
d'une couleur parfaitement pure, et très directive, a rapidement
fait l'objet de multiples améliorations, en même temps que son
coût de fabrication diminuait.
La première lumière laser était
rouge; aujourd'hui, il en existe de multiples couleurs.
Et l'on
en réalise de puissances très variées pour des utilisations qui
vont du music-hall aux armements.
«Dieu dit: "Que la lumière soit" et la lumière fat».
Ce pas
sage de la Bible montre l'importance que, depuis fort long
temps, les hommes attachent au phénomène lumineux.
Symbole de vie, de chaleur, de clarté, la lumière a été pendant
des millénaires considérée comme de nature divine.
Témoins
les nombreux cultes solaires qui ont existé un peu partout dans
le monde.
Le physicien français Jean-Baptiste Biot écrivait en 1816 :
Lorsque le Soleil, d'abord caché sous l'horizon, se lève et
paraît tout à coup à nos yeux, on conçoit qu'il existe
nécessairement entre cet astre et nous un certain mode
de communication qui nous avertit de son existence,
sans que nous ayons besoin de le toucher.
Ce mode de
communication, qui s'exerce ainsi à distance, et se
transmet par les yeux, constitue ce que l'on appelle la
lumière.»
Parler de mode de communication, c'est reconnaître une nature
matérielle au phénomène.
L'on est loin de la lumière identifiée
à Mâât, fille du dieu Rê, ou (selon les auteurs) à Chou, dieu de
l'air et de la lumière, par les anciens Égyptiens.
De l' Antiquité
au XIXe siècle l'on est passé, en optique, de l'interrogation religieuse au raisonnement scientifique.
En ce qui concerne la production de la lumière, par contre, les choses n'ont pas tellement
changé.
Alors que, de Biot à nous-mêmes, le bond a été, à cet
égard, considérable.
Les sources de lumière: de la torche au laser
Le soleil est, bien évidemment, la toute première source
connue.
Elle restera longtemps - pratiquement jusqu'au XX•
siècle - la plus utilisée, y compris par les physiciens, parce
que la plus vive.
Quitte d'ailleurs à imaginer des dispositifs
(comprenant d'abord des miroirs-plans, puis des miroirs
·concaves - comme le four solaire d'Odeillo dans les Pyrénées
orientales-et plus tard des lentilles) permettant de concentrer
le faisceau lumineux, de l'orienter ...
Le feu en est la seconde.
Les hommes savent l'allumer
depuis 500 000 ans, peut-être davantage.
Et ils ont longtemps
(jusqu'à ce que le chimiste français Lavoisier élucide, à la fin
du XVIII• siècle, le mécanisme chimique de la combustion)
assimilé la lumière à une forme du feu.
«La lumière est le feu
le plus pur» écrit Novalis, poète allemand du XVIIIe siècle.
La torche de bois a d'abord servi.
Puis, la technique progressant, les hommes ont fabriqué de ces petites lampes à huile en
terre cuite dont on a trouvé des quantités importantes sur de
nombreux sites archéologiques.
Il en est de plus sophistiquées,
telles celles qui sont décrites par Héron d'Alexandrie (II° siècle
av.
J.-C.).
A partir du XVIe siècle, les inventeurs améliorent les
dispositifs : la combustion est facilitée par une aération appropriée, on purifie l'huile, on la remplace parfois à la fin du
XVIIIe siècle par du gaz provenant de la distillation du charbon.
A la fin de ce siècle, grâce à Philippe Lebon, l'éclairage
public au gaz se développe à Paris, un peu après Londres (Murdoch).
Les dernières décennies du XIXe siècle, avec le forage
des puits aux U.S.A., voient le remplacement rapide de l'huile
(animale ou végétale) par le pétrole («huile de terre»).
Idem
pour les gaz de distillation des hydrocarbures devant lesquels le
gaz de houille résistera plus longtemps.
Il est un autre phéno91ène naturel qu~ produit de la lumière et
que l'on peut songer à imiter (filt-ce en petite dimension), c'est
l'éclair.
Thalès (philosophe et mathématicien grec du VIIe
siècle av.
J.-C.) savait qu'une tige d'ambre frottée attire des
corps légers.
Dans l'obscurité, on distingue aussi de petites
étincelles.
(Voir art.
l.)
En 1660, l' Allemand Otto von Guericke invente une
machine grâce à laquelle il fabrique en plus grande quantité de
ces « charges électriques», comme on les appellera plus tard.
On constate, au XVIIIe, qu'elles sont de deux sortes et que leurs
effets sont opposés : elles seront baptisées par r Américain
Benjamin Franklin - qui démontre aussi que l'éclair est une
étincelle électrique et invente le paratonnerre - «positive» et
«négative».
En rapprochant deux boules métalliques chargées
d'électridté, on provoque une étincelle, bien sûr très brève.
L'invention de la pile par Volta en 1800 donne la possibilité ·
d'avoir un courant électrique, de durée plus longue.
Quand on
cisaille le fil d'un circuit où passe ce courant, si ce dernier est
assez intense, une étincelle électrique permanente s'établit
entre les bords de la coupure.
C'est l'arc électrique, réalisé par
l' Anglais Davy en 1810 entre deux tiges de carbone.
La plupart
des grandes salles de cinéma étaient encore, il y a une trentaine
d'années, équipées de projecteurs à arc électrique.
En I 857, l' Allemand Heinrich Geissler présente un tube de
verre, comportant deux électrodes, branché sur une pompe à
faire le vide d'air.
Le tube contient un gaz et les électrodes sont
reliées aux bornes d'un générateur électrique (une pile, par
exemple).
Quand le gaz, dans le tube, est à la pression atmosphérique, aucun courant ne passe dans le circuit.
Si l'on
pompe, quand la pression devient assez faible, les atomes restants se séparent en ions positifs et en électrons, qui sont attirés
par les électrodes.
De ce fait un courant passe et, par suite de
différents phénomènes (les chocs des particules entre elles,
notamment), une lueur apparaît dans le tube et finit par l'envahir tout entier.
La couleur de la lumière dépend de la nature du
gaz.
Le néon, par exemple, produit un beau rouge.
Améliorés
par l'ingénieur français Georges Claude vers 1910, ces tubes
sont aujourd'hui très utilisés, entre autres pour les enseignes
des magasins.
En 1878, l'inventeur et homme d'affaires américain Thomas
Edison réalise la lampe à incandescence (la lumière est provoquée par un filament, chauffé par le passage du courant électrique, et situé dans une ampoule vide ou contenant un gaz
chimiquement inerte).
Cela reste le mode d'éclairage le plus
utilisé de nos jours.
Dans toutes les sources connues jusqu'en 1960, la lumière
-même si une couleur domine-est plurichromatique, c'està-dire composée de plusieurs couleurs.
Pour la rendre monochromatique, il faut un filtre.
Si l'on considère la lumière
comme un ensemble de vibrations, celles-oi ont un « comportement anarchique» les unes par rapport aux autres.
Si on la
considère comme un ensemble de particules (des photons),
ceux-ci se comportent aussi différemment les uns des autres.
La
lumière est dite incohérente.
Par un dispositif que nous ne décrirons pas, en s'inspirant
entre autres des travaux sur le «pompage optique» qui valurent
le prix Nobel à Alfred Kastler en 1966, dispositif qui comporte
en particulier une sorte de long cylindre terminé par deux
miroirs entre lesquels la lumière se réfléchit (de la matière dont
est composé le cylindre dépend la couleur de la radiation ; le
premier était en rubis), on obtient une lumière cohérente et
parfaitement monochromatique.
Cet appareil est un laser.
·Propagation de la lumière et instruments d'optique
Aristote (IV• siècle av.
J.-C.), Euclide (III•) savent que la
lumière se propage en ligne droite.
Euclide connaît la
manière· dont elle se réfléchit sur un miroir-plan (en bronze
poli ou en obsidienne, qui est une sorte de verre naturel d'origine volcanique).
II constate que, passant d'un milieu transparent dans un autre (par exemple de l'air dans l'eau ou le verre)
le rayon de lumière s'infléchit (phénomène dit de «réfrac-·
tion»).
II note aussi qu'un miroir sphérique concave (qu'il
baptise « miroir ardent») concentre en un point (son «foyer»),
après réflexion, un faisceau de lumière initialement parallèle.
Cela.
peut servir à allumer
du feu, comme le font les
enfants à l'aide d'une
loupe.
Des chroniqueurs
de la fin de l 'Antiquité
Foyer
racontent qu'Archimède
(III• siècle av.
J.-C.) utilisa
un miroir de ce type, de
Miroir
grande dimension, pour
incendier les voiles de galères romaines assiègeant Syracuse (le
fait n'est pas prouvé).
Héron d'Alexandrie décrit un petit four
solaire comportant un miroir concave.
Le grand physicien arabe
Ibn al Haytham (XII• siècle) fabrique et étudie les « sphères
ardentes», lesquelles annoncent les lentilles.
Les lentilles convergentes (les loupes, si l'on préfère) apparaissent à la fin du XIII• siècle, dans la région de Florence, dans
les bésicles pour presbytes.
On les utilise ensuite pour corriger
l'hypermétropie.
Et l'on invente des lentilles divergentes qui
corrigent la myopie.
Ces premières lentilles sont des morcea\{x
de verre, limités par des faces qui sont des portions de sphères.
Les artisans opticiens les améliorent pendant plusieurs siècles.
L'astronome et physicien allemand Johannes Kepler démontre
' (1604 et 1611) comment ces lentilles forment les images des
objets.
Descartes publie en 1637 la loi de la réfraction.
Les défauts de l'œil
L'œil se comporte, du point de vue optique, comme un appareil photographique.
La lumière, venant d'un objet, est reçue
sur une lentille convergente - le cristallin - qui produit une
image de cet objet sur la rétine, qui tapisse la partie interne
de l'arrière du globe oculaire.
Cette rétine communique, par
l'intermédiaire du nerf optique, l'information reçue au cerveau, ce qui produit la sensation lumineuse.
Le cristallin est une lentille vivante.
La courbure de ses
faces se modifie en fonction de l'objet regardé, de manière
à ce que l'image de ce dernier se forme avec précision sur
la rétine.
Les possibles avatars principaux de ce système
optique sont les suivants:
• l'individu vieillit et son cristallin ne répond plus correctement.
Il n'arrive plus, en particulier, à former sur la rétine
l'image d'un objet assez proche; celui-ci tend à se former
en arrière de la rétine et la vision de l'objet est trouble.
Ce
défaut est la presbytie.
Presque toutes les personnes
deviennent presbytes après 40 ans (plus ou moins vite).
Cela se corrige à l'aide de verres convergents.
• le cristallin forme l'image de l'objet en avant de la rétine,
la vision est également trouble.
La personne est myope.
Une lentille divergente permet de former l'image sur la
rétine.
• le cristallin forme l'image derrière la rétine.
Vision encore
trouble.
La personne est hypermétrope.
Une lentille
convergente rétablit une vision correcte.
Le premier défaut est lié à l'âge de !'individu.
Les deux derniers sont consécutifs à l'œil lui-même.
On peut les avoir à
1a naissance, ils peuvent aussi apparaître ultérieurement.
c~
Myopie
~Rétine
Vision normale
Hypermétropie
Des artisans ont, dès le XVIe siècle, peut-être par hasard, asso
cié des lentilles différentes, les ont fixées dans des tubes cou
lissant les uns dans les autres, et ont constaté que, dans
certaines conditions, le dispositif permettait de mieux distin
guer des objets éloignés.
Le physicien italien Galileo Galilei
(Galilée), ayant entre les mains une telle lunette en 1609 (elle
est constituée d'une lentille convergente et d'une lentille diver
gente, chacune dans un tube; son grossissement n'est que de
trois), l'utilise pour observer les astres et les planètes.
Grâce aux propriétés énoncées par Kepler, les physiciens et
astronomes imaginent d'autres associations de lentilles, obte
nànt des lunettes astronomiques plus performantes que celle de
Galilée.
A la fin du siècle, le physicien et mathématicien anglats
Isaac Newton, reprenant une idée déjà relativement ancienne,
remplace l'objectif (la lentille la plus proche de l'objet) par un
miroir concave, réalisant ainsi un télescope à miroir, plus
puissant et techniquement plus facile à réaliser que les Iunèttes.
Parallèlement, Galilée à l'origine, puis d'autres physiciens
(Leewenhoek, etc.), ont constaté que, associées différemment,
les couples de lentilles permettent aussi de distinguer des objets
très petits, non visibles à l'œil nu.
C'est l'origine du micro
scope.
Au XVIIIe siècle, grâce aux progrès de l'optique, à ceux
de la géométrie et d'autres branches des mathématiques, des
améliorations notables ont été apportées aux instruments pour
éliminer plusieurs défauts : remplacement fréquent des surfaces
sphériques par des surfaces paraboliques, réalisation d'objectifs
et d'oculaires, dits composés, en accolant des lentilles en verres
différents ...
(voir art.
3).
Les couleurs
La thèse la plus répandue, depuis l' Antiquité, revient à
.
admettre que la lumière initiale et parfaite est le blanc.
Entre
ce dernier et le noir, la couleur est fonction de l'affaiblissement
de la lumière initiale: le rouge....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓