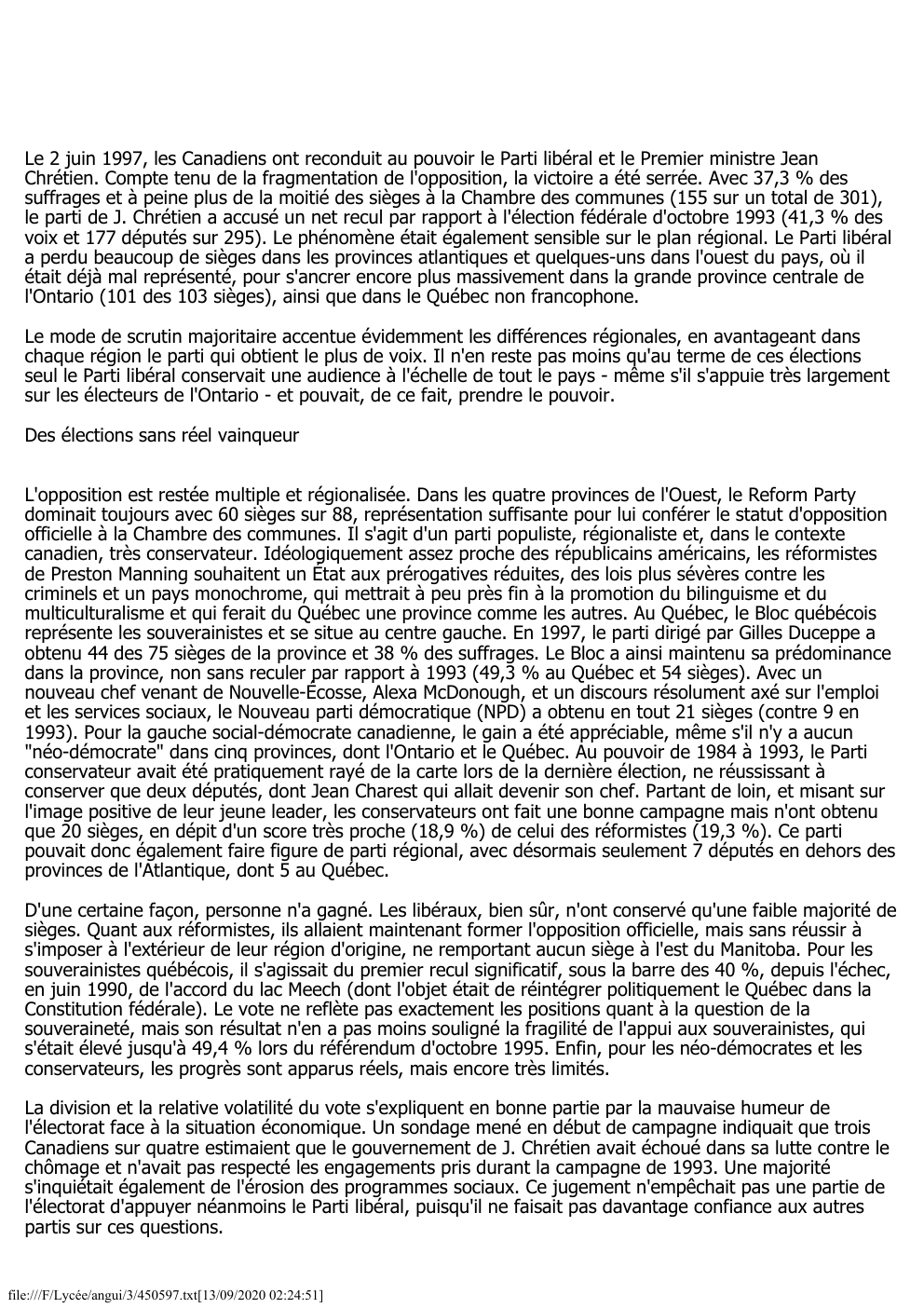Le 2 juin 1997, les Canadiens ont reconduit au pouvoir le Parti libéral et le Premier ministre Jean Chrétien. Compte...
Extrait du document
«
Le 2 juin 1997, les Canadiens ont reconduit au pouvoir le Parti libéral et le Premier ministre Jean
Chrétien.
Compte tenu de la fragmentation de l'opposition, la victoire a été serrée.
Avec 37,3 % des
suffrages et à peine plus de la moitié des sièges à la Chambre des communes (155 sur un total de 301),
le parti de J.
Chrétien a accusé un net recul par rapport à l'élection fédérale d'octobre 1993 (41,3 % des
voix et 177 députés sur 295).
Le phénomène était également sensible sur le plan régional.
Le Parti libéral
a perdu beaucoup de sièges dans les provinces atlantiques et quelques-uns dans l'ouest du pays, où il
était déjà mal représenté, pour s'ancrer encore plus massivement dans la grande province centrale de
l'Ontario (101 des 103 sièges), ainsi que dans le Québec non francophone.
Le mode de scrutin majoritaire accentue évidemment les différences régionales, en avantageant dans
chaque région le parti qui obtient le plus de voix.
Il n'en reste pas moins qu'au terme de ces élections
seul le Parti libéral conservait une audience à l'échelle de tout le pays - même s'il s'appuie très largement
sur les électeurs de l'Ontario - et pouvait, de ce fait, prendre le pouvoir.
Des élections sans réel vainqueur
L'opposition est restée multiple et régionalisée.
Dans les quatre provinces de l'Ouest, le Reform Party
dominait toujours avec 60 sièges sur 88, représentation suffisante pour lui conférer le statut d'opposition
officielle à la Chambre des communes.
Il s'agit d'un parti populiste, régionaliste et, dans le contexte
canadien, très conservateur.
Idéologiquement assez proche des républicains américains, les réformistes
de Preston Manning souhaitent un État aux prérogatives réduites, des lois plus sévères contre les
criminels et un pays monochrome, qui mettrait à peu près fin à la promotion du bilinguisme et du
multiculturalisme et qui ferait du Québec une province comme les autres.
Au Québec, le Bloc québécois
représente les souverainistes et se situe au centre gauche.
En 1997, le parti dirigé par Gilles Duceppe a
obtenu 44 des 75 sièges de la province et 38 % des suffrages.
Le Bloc a ainsi maintenu sa prédominance
dans la province, non sans reculer par rapport à 1993 (49,3 % au Québec et 54 sièges).
Avec un
nouveau chef venant de Nouvelle-Écosse, Alexa McDonough, et un discours résolument axé sur l'emploi
et les services sociaux, le Nouveau parti démocratique (NPD) a obtenu en tout 21 sièges (contre 9 en
1993).
Pour la gauche social-démocrate canadienne, le gain a été appréciable, même s'il n'y a aucun
"néo-démocrate" dans cinq provinces, dont l'Ontario et le Québec.
Au pouvoir de 1984 à 1993, le Parti
conservateur avait été pratiquement rayé de la carte lors de la dernière élection, ne réussissant à
conserver que deux députés, dont Jean Charest qui allait devenir son chef.
Partant de loin, et misant sur
l'image positive de leur jeune leader, les conservateurs ont fait une bonne campagne mais n'ont obtenu
que 20 sièges, en dépit d'un score très proche (18,9 %) de celui des réformistes (19,3 %).
Ce parti
pouvait donc également faire figure de parti régional, avec désormais seulement 7 députés en dehors des
provinces de l'Atlantique, dont 5 au Québec.
D'une certaine façon, personne n'a gagné.
Les libéraux, bien sûr, n'ont conservé qu'une faible majorité de
sièges.
Quant aux réformistes, ils allaient maintenant former l'opposition officielle, mais sans réussir à
s'imposer à l'extérieur de leur région d'origine, ne remportant aucun siège à l'est du Manitoba.
Pour les
souverainistes québécois, il s'agissait du premier recul significatif, sous la barre des 40 %, depuis l'échec,
en juin 1990, de l'accord du lac Meech (dont l'objet était de réintégrer politiquement le Québec dans la
Constitution fédérale).
Le vote ne reflète pas exactement les positions quant à la question de la
souveraineté, mais son résultat n'en a pas moins souligné la fragilité de l'appui aux souverainistes, qui
s'était élevé jusqu'à 49,4 % lors du référendum d'octobre 1995.
Enfin, pour les néo-démocrates et les
conservateurs, les progrès sont apparus réels, mais encore très limités.
La division et la relative volatilité du vote s'expliquent en bonne partie par la mauvaise humeur de
l'électorat face à la situation économique.
Un sondage mené en début de campagne indiquait que trois
Canadiens sur quatre estimaient que le gouvernement de J.
Chrétien avait échoué dans sa lutte contre le
chômage et n'avait pas respecté les engagements pris durant la campagne de 1993.
Une majorité
s'inquiétait également de l'érosion des programmes sociaux.
Ce jugement n'empêchait pas une partie de
l'électorat d'appuyer néanmoins le Parti libéral, puisqu'il ne faisait pas davantage confiance aux autres
partis sur ces questions.
file:///F/Lycée/angui/3/450597.txt[13/09/2020 02:24:51]
De bons résultats économiques au péril de la protection sociale
Pourtant, la situation économique du Canada apparaissait à plusieurs égards favorable.
Le FMI et l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) ont évalué le taux de croissance pour
1997 et 1998 à 3,5 % en moyenne annuelle, ce qui constituerait la meilleure performance du pays depuis
1994 et le classerait dans le peloton de tête des pays industrialisés.
Le déficit des finances publiques
fédérales, à hauteur de 6 % du PIB en 1993, était tombé à moins de 3 % en 1996-1997, et le Canada
semblait pouvoir devenir, avant la fin de 1998, le premier pays du G-7 (Groupe des sept pays les plus
industrialisés) à afficher un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓