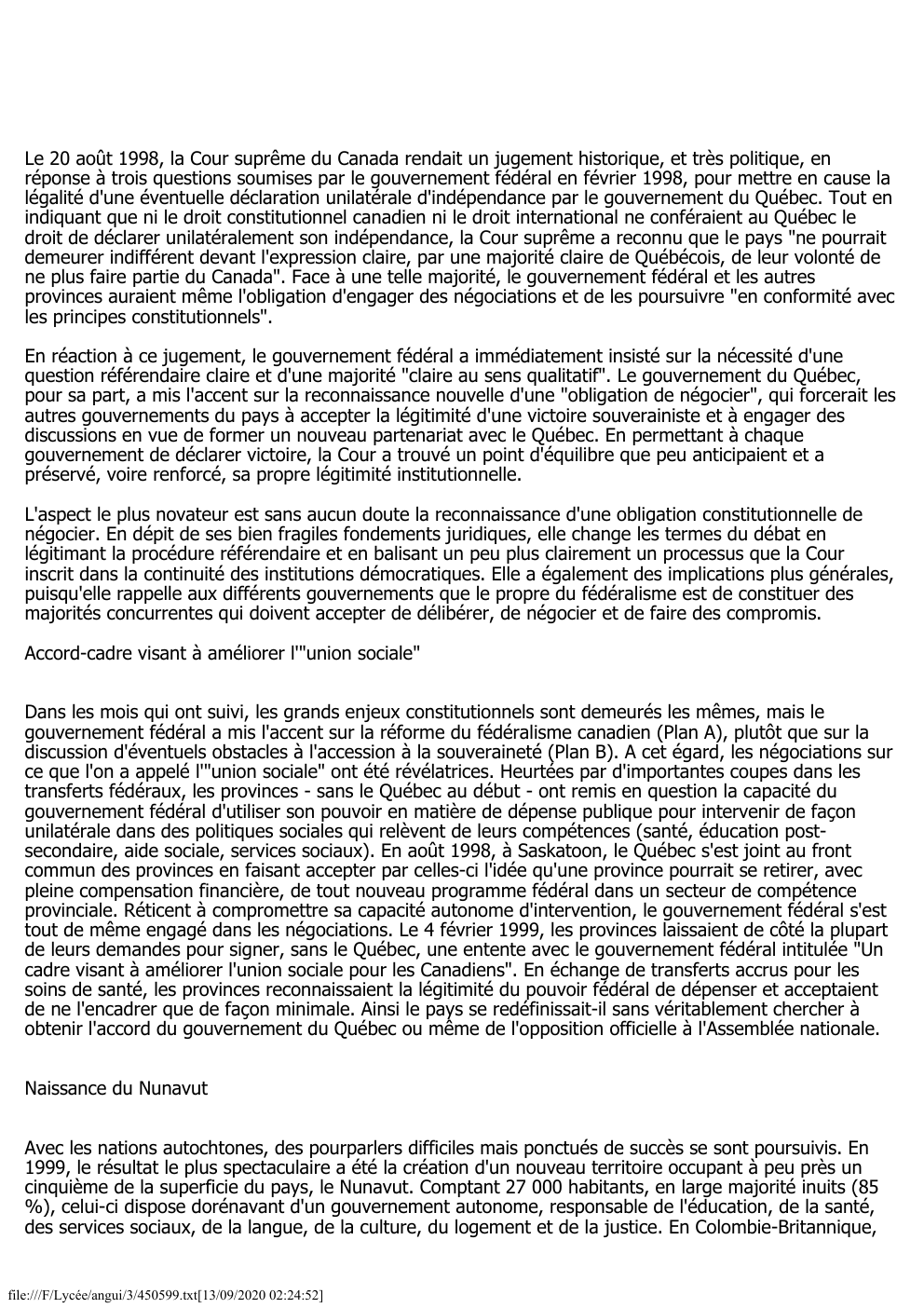Le 20 août 1998, la Cour suprême du Canada rendait un jugement historique, et très politique, en réponse à trois...
Extrait du document
«
Le 20 août 1998, la Cour suprême du Canada rendait un jugement historique, et très politique, en
réponse à trois questions soumises par le gouvernement fédéral en février 1998, pour mettre en cause la
légalité d'une éventuelle déclaration unilatérale d'indépendance par le gouvernement du Québec.
Tout en
indiquant que ni le droit constitutionnel canadien ni le droit international ne conféraient au Québec le
droit de déclarer unilatéralement son indépendance, la Cour suprême a reconnu que le pays "ne pourrait
demeurer indifférent devant l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de
ne plus faire partie du Canada".
Face à une telle majorité, le gouvernement fédéral et les autres
provinces auraient même l'obligation d'engager des négociations et de les poursuivre "en conformité avec
les principes constitutionnels".
En réaction à ce jugement, le gouvernement fédéral a immédiatement insisté sur la nécessité d'une
question référendaire claire et d'une majorité "claire au sens qualitatif".
Le gouvernement du Québec,
pour sa part, a mis l'accent sur la reconnaissance nouvelle d'une "obligation de négocier", qui forcerait les
autres gouvernements du pays à accepter la légitimité d'une victoire souverainiste et à engager des
discussions en vue de former un nouveau partenariat avec le Québec.
En permettant à chaque
gouvernement de déclarer victoire, la Cour a trouvé un point d'équilibre que peu anticipaient et a
préservé, voire renforcé, sa propre légitimité institutionnelle.
L'aspect le plus novateur est sans aucun doute la reconnaissance d'une obligation constitutionnelle de
négocier.
En dépit de ses bien fragiles fondements juridiques, elle change les termes du débat en
légitimant la procédure référendaire et en balisant un peu plus clairement un processus que la Cour
inscrit dans la continuité des institutions démocratiques.
Elle a également des implications plus générales,
puisqu'elle rappelle aux différents gouvernements que le propre du fédéralisme est de constituer des
majorités concurrentes qui doivent accepter de délibérer, de négocier et de faire des compromis.
Accord-cadre visant à améliorer l'"union sociale"
Dans les mois qui ont suivi, les grands enjeux constitutionnels sont demeurés les mêmes, mais le
gouvernement fédéral a mis l'accent sur la réforme du fédéralisme canadien (Plan A), plutôt que sur la
discussion d'éventuels obstacles à l'accession à la souveraineté (Plan B).
A cet égard, les négociations sur
ce que l'on a appelé l'"union sociale" ont été révélatrices.
Heurtées par d'importantes coupes dans les
transferts fédéraux, les provinces - sans le Québec au début - ont remis en question la capacité du
gouvernement fédéral d'utiliser son pouvoir en matière de dépense publique pour intervenir de façon
unilatérale dans des politiques sociales qui relèvent de leurs compétences (santé, éducation postsecondaire, aide sociale, services sociaux).
En août 1998, à Saskatoon, le Québec s'est joint au front
commun des provinces en faisant accepter par celles-ci l'idée qu'une province pourrait se retirer, avec
pleine compensation financière, de tout nouveau programme fédéral dans un secteur de compétence
provinciale.
Réticent à compromettre sa capacité autonome d'intervention, le gouvernement fédéral s'est
tout de même engagé dans les négociations.
Le 4 février 1999, les provinces laissaient de côté la plupart
de leurs demandes pour signer, sans le Québec, une entente avec le gouvernement fédéral intitulée "Un
cadre visant à améliorer l'union sociale pour les Canadiens".
En échange de transferts accrus pour les
soins de santé, les provinces reconnaissaient la légitimité du pouvoir fédéral de dépenser et acceptaient
de ne l'encadrer que de façon minimale.
Ainsi le pays se redéfinissait-il sans véritablement chercher à
obtenir l'accord du gouvernement du Québec ou même de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale.
Naissance du Nunavut
Avec les nations autochtones, des pourparlers difficiles mais ponctués de succès se sont poursuivis.
En
1999, le résultat le plus spectaculaire a été la création d'un nouveau territoire occupant à peu près un
cinquième de la superficie du pays, le Nunavut.
Comptant 27 000 habitants, en large majorité inuits (85
%), celui-ci dispose dorénavant d'un gouvernement autonome, responsable de l'éducation, de la santé,
des services sociaux, de la langue, de la culture, du logement et de la justice.
En Colombie-Britannique,
file:///F/Lycée/angui/3/450599.txt[13/09/2020 02:24:52]
un traité beaucoup plus controversé, et qui pourrait préfigurer de nombreux autres accords, a répondu
aux demandes du peuple Nisga'a en accordant à celui-ci l'intendance de ses terres et de ses affaires.
En
mai 1999, une entente de principe était également annoncée concernant les Inuits du Labrador.
Sur le plan économique, la croissance a été modérée (3,0 % en 1998), l'inflation très basse (1 %) et le
taux de chômage légèrement en baisse (8,3 % en 1998).
A 7,8 %, ce dernier atteignait en février 1999
son plus bas niveau en huit ans.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓