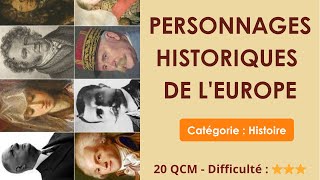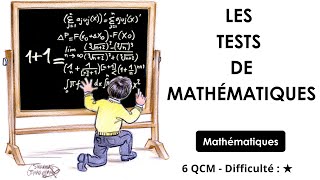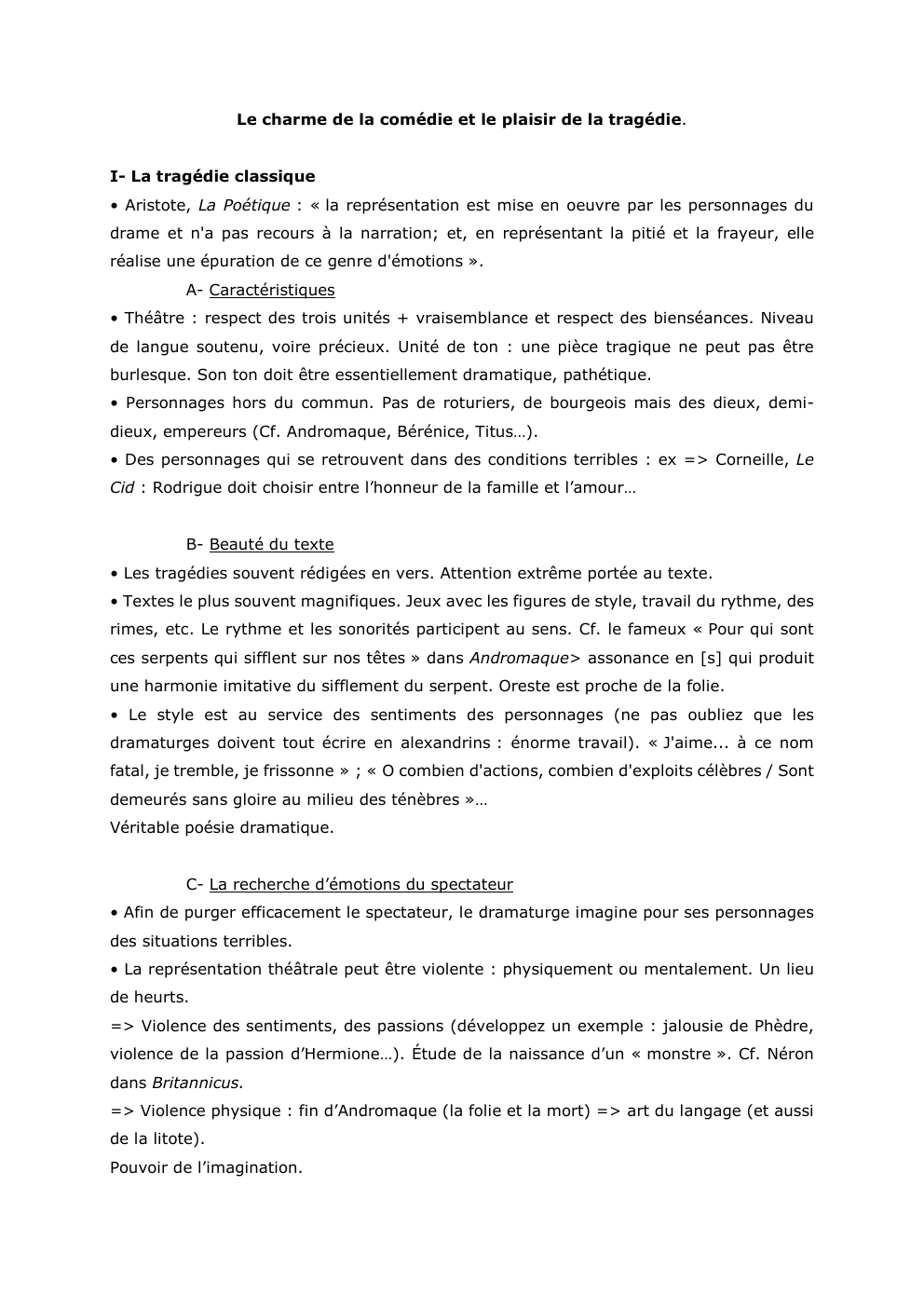Le charme de la comédie et le plaisir de la tragédie. I- La tragédie classique • Aristote, La Poétique :...
Extrait du document
«
Le charme de la comédie et le plaisir de la tragédie.
I- La tragédie classique
• Aristote, La Poétique : « la représentation est mise en oeuvre par les personnages du
drame et n'a pas recours à la narration; et, en représentant la pitié et la frayeur, elle
réalise une épuration de ce genre d'émotions ».
A- Caractéristiques
• Théâtre : respect des trois unités + vraisemblance et respect des bienséances.
Niveau
de langue soutenu, voire précieux.
Unité de ton : une pièce tragique ne peut pas être
burlesque.
Son ton doit être essentiellement dramatique, pathétique.
• Personnages hors du commun.
Pas de roturiers, de bourgeois mais des dieux, demidieux, empereurs (Cf.
Andromaque, Bérénice, Titus…).
• Des personnages qui se retrouvent dans des conditions terribles : ex => Corneille, Le
Cid : Rodrigue doit choisir entre l’honneur de la famille et l’amour…
B- Beauté du texte
• Les tragédies souvent rédigées en vers.
Attention extrême portée au texte.
• Textes le plus souvent magnifiques.
Jeux avec les figures de style, travail du rythme, des
rimes, etc.
Le rythme et les sonorités participent au sens.
Cf.
le fameux « Pour qui sont
ces serpents qui sifflent sur nos têtes » dans Andromaque> assonance en [s] qui produit
une harmonie imitative du sifflement du serpent.
Oreste est proche de la folie.
• Le style est au service des sentiments des personnages (ne pas oubliez que les
dramaturges doivent tout écrire en alexandrins : énorme travail).
« J'aime...
à ce nom
fatal, je tremble, je frissonne » ; « O combien d'actions, combien d'exploits célèbres / Sont
demeurés sans gloire au milieu des ténèbres »…
Véritable poésie dramatique.
C- La recherche d’émotions du spectateur
• Afin de purger efficacement le spectateur, le dramaturge imagine pour ses personnages
des situations terribles.
• La représentation théâtrale peut être violente : physiquement ou mentalement.
Un lieu
de heurts.
=> Violence des sentiments, des passions (développez un exemple : jalousie de Phèdre,
violence de la passion d’Hermione…).
Étude de la naissance d’un « monstre ».
Cf.
Néron
dans Britannicus.
=> Violence physique : fin d’Andromaque (la folie et la mort) => art du langage (et aussi
de la litote).
Pouvoir de l’imagination.
• Personnages sont complexes et tourmentés.
Ex : le personnage de Phèdre.
« Phèdre
n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente » => Personnage tourmenté, ambigu,
passionné, coupable et victime : devient l’un des personnage tragique par excellence.
Cf.
par exemple son extrême de la jalousie (« craintes », «transports », « fureurs », « feux »,
« remords ») lui donnes des idées de meurtres (champ lexical du meurtre: « crimes », «
homicides », « sang ») et en même temps, la passion qui la ronge « Je le vis, je rougis, je
pâlis à sa vue, / Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue.
» (vers 273-274).
=> Les mots, leur agencement, leur force… è Émotions du spectateur.
∆) Dans la tragédie, le héros doit faire face à un dilemme ou est victime de ses
passions et doit ainsi faire face à des situations terribles qui doivent inspirer terreur et pitié
au spectateur.
Plaisir du spectateur devant un beau spectacle.
II- La comédie, un art plus proche des spectateurs
La comédie est un moment que choisit un spectateur pour se détendre, de
s’amuser et sourire et même de rire mais qui peut aussi remettre en cause les mœurs et
faire réfléchir.
A- Un moment de détente
• L’histoire met en scène des personnages du quotidien (bourgeois… VS les tragédies) qui
ont des soucis du quotidien (mariage, dote, argent…) : ressemblent + aux spectateurs.
• Éléments récurrents (rassurants) : l’homme est souvent bête, alcoolique, rustre, ridicule.
La femme est souvent rusée, revêche et avare, avec un amant ou au contraire trop belle
pour son mari.
On retrouve des personnages traditionnels comme Arlequin avec son bâton
et sa bouteille, le valet fourbe, le mari qui porte les cornes…
• La pièce se finit bien : mariage final, les personnages désagréables sont punis, les gentils
se marient.
• Les personnages méchants ou grotesques sont les perdants.
Ex : Arnolphe de l’École des femmes.
Il est si ridicule et mauvais que c’est un plaisir
d’imaginer qu’Agnès l’a ou va le tromper => le spectateur sort content du spectacle.
B- Les différentes formes de comique
• L’auteur de la comédie déploie tout son talent afin de faire rire le spectateur.
Déclinaison
des différentes formes de comiques.
• Comique de mots : Dom Juan, Molière Pierrot parlent le patois et semble un peu ridicule.
Il jure.
• Comique de gestes : Sganarelle reçoit le soufflet destiné à Pierrot (Dom Juan, Molière,
II, 3)
• Comique de situation : on pense à M.
Jourdain ; le vieux barbon voulant épouser une
jeune fille (Cf.
Le Légataire universel…).
• Comique de caractère : le valet rusé, « l’habile fourbe », comme Scapin de Molière ou
Dubois de Marivaux.
• La mise en scène et le jeu des acteurs est important aussi et peuvent renforcer le
comique.
Cf.
Molière qui roulait, d’après les témoignages, de gros yeux et qui parvenait à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓