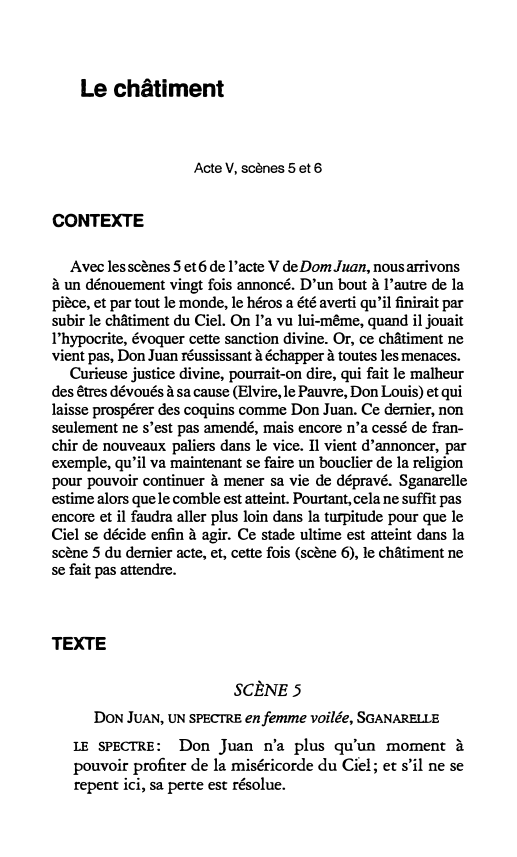Le châtiment Acte V, scènes 5 et 6 CONTEXTE Avec les scènes 5 et 6 de l'acte V de Dom...
Extrait du document
«
Le châtiment
Acte V, scènes 5 et 6
CONTEXTE
Avec les scènes 5 et 6 de l'acte V de Dom Juan, nous arrivons
à un dénouement vingt fois annoncé.
D'un bout à l'autre de la
pièce, et par tout le monde, le héros a été averti qu'il finirait par
subir le châtiment du Ciel.
On l'a vu lui-même, quand il jouait
l'hypocrite, évoquer cette sanction divine.
Or, ce châtiment ne
vient pas, Don Juan réussissant à échapper à toutes les menaces.
Curieuse justice divine, pourrait-on dire, qui fait le malheur
des êtres dévoués à sa cause (Elvire, le Pauvre, Don Louis) et qui
laisse prospérer des coquins comme Don Juan.
Ce dernier, non
seulement ne s'est pas amendé, mais encore n'a cessé de fran
chir de nouveaux paliers dans le vice.
Il vient d'annoncer, par
exemple, qu'il va maintenant se faire un bouclier de la religion
pour pouvoir continuer à mener sa vie de dépravé.
Sganarelle
estime alors que le comble est atteint.
Pourtant, cela ne suffit pas
encore et il faudra aller plus loin dans la turpitude pour que le
Ciel se décide enfin à agir.
Ce stade ultime est atteint dans la
scène 5 du dernier acte, et, cette fois (scène 6), le châtiment ne
se fait pas attendre.
TEXTE
SCÈNE5
DoN JUAN, UN SPECTRE en femme voilée, SGANARELLB
LE SPECTRE: Don Juan n'a plus qu'un moment à
pouvoir profiter de la miséricorde du Ciel; et s'il ne se
repent ici, sa perte est résolue.
SGANAREllE:
5
Entendez-vous, Monsieur?
DON JUAN: Qui ose tenir ces paroles? Je crois ·
connaître cette voix.
SGANAREllE: Ah! Monsieur, c'est un spectre: je le
reconnais au marcher.
10
DON JUAN:
que c'est.
Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce
Le Spectre change de figure et représente le Temps avec sa
faux à la main.
SGANAREUE: 0 Ciel! voyez-vous, Monsieur, ce chan
gement de figure?
15 DON JUAN: Non, non, rien n'est capable de m'impri
mer de la terreur, et je veux éprouver avec mon épée si
c'est un corps ou un esprit.
20
Le Spectre s'envole dans le temps que Don Juan le veùt
frapper.
SGANAREllE: Ah! Monsieur, rendez-vous à tant · de
preuves, et jetez-vous vite dans le repentir.
_,
DON JUAN: Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il
arrive, que je sois capable de me repentir.
Allons,
suis-moi.
SCENE6
LA STATUE, DON JUAN, SGANAREllE
LA STATUE: Arrêtez, Don Juan: vous m'avez hier don25 né parole de venir manger avec moi.
DON JUAN:
Oui.
Où faut-il aller?
LA STATUE:
Donnez-moi la main.
DON JUAN:
La voilà.
Don Juan, l'endurcissement au péché
traîne une mort funeste, et les grâces du Ciel que l'on
renvoie ouvrent un chemin à sa foudre.
LA STATUE:
30
DON JUAN: 0 Ciel! que sens-je? Un feu invisible me
brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un
brasier ardent.
Ah!
35
40
Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs
sur Don Juan; la terre s'ouvre et l'abîme; et il sort de
grands feux de l'endroit où il est tombé.
SGANARELLE: Ah! mes gages! mes gages! Voilà par sa
mort un chacun satisfait: Ciel offensé, lois violées, filles
séduites, familles déshonorées, parents outragés,
femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le mon
de est content.
Il n'y a que moi seul de malheureux.
Mes
gages, mes gages, mes gages!
IDÉE DIRECTRICE ET MOUVEMENT DU TEXTE
Don Juan parvient au terme de son parcours: il va subir le
châtiment du Ciel qui va le punir, non pour ses péchés, car à tout
péché miséricorde, mais pour n'avoir point voulu demander
cette miséricorde.
D'abord, dans la scène V, un Spectre apparaît à Don Juan et
lui renouvelle l'avertissement du Ciel:« ...
s'il ne se repent ici,
sa perte est résolue».
Cette scène est divisée en trois mouve
ments séparés par les didascalies se rapportant aux métamor
phoses du Spectre.
Après le refus de Don Juan de se repentir,
vient le châtiment annoncé.
La scène VI décrit l'ultime rencontre entre la Statue du
Commandeur et Don Juan.
Elle est également subdivisée en trois
moments.
• Dans un premier temps, jusqu'à la repartie de Don Juan: «La
voilà», la Statue demande à Don Ju_an de la suivre.
Le libertin
accepte de lui donner la main.
• Dans un deuxième temps, la Statue prononce le jugement du
Ciel: Don Juan n'a pas su profiter des grâces du Ciel, il sera fou
droyé.
Après les ultimes paroles de Don Juan, étonné du feu qui
le brûle, le libertin est précipité dans l'abîme.
• Dans un troisième temps, la comédie reprend ses droits après
le drame: c'est Sganarelle qui aura le dernier mot en pleurant ses
gages.
AXES D'EXPLICATION
Le dénouement d'une tragédie
A la fin des Liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil a
le visage détruit par la petite vérole et le livre se termine très
moralement sur l'idée que son visage s'est mis à ressembler à
son âme.
Quant au vicomte de Valmont, aristocrate émule de
Don Juan, il est tué au cours d'un duel par Danceny.
Molière aurait très bien pu faire mourir Don Juan de la même
manière que Valmont, suite à un duel avec Don Carlos.
Il lui
aurait cependant fallu s'écarter du mythe beaucoup plus qu'il ne
l'a fait jusque-là.
En fait, il va conserver le dénouement tradi
tionnel, mais en l'intégrant parfaitement à son projet.
Le deus ex
machina qui foudroie Don Juan n'apparaît pas comme un élé
ment rapporté.
Il ne nuit en rien à la cohérence d'un ensemble
qui, par bien des points, s • apparente à la tragédie.
·
• Une mort annoncée: la punition du Ciel qui sert de dénoue
ment est annoncée dès le début.
D'autres avertissements suivent,
revenant comme un leitmotiv tout au long de la pièce.
Dès l'acte I, Elvire rappelle cette éventualité.
Sganarelle,
suite à la quasi-noyade, fait remarquer qu'il s'agit peut-être d'un
avertissement du Ciel.
Au début de l'acte IV, suite à la scène du
tombeau qui termine l'acte précédent, Sganarelle interprète le
hochement de tête de la statue comme une manifestation du
Ciel:
« Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête, et je
ne doute point que le Ciel scandalisé par votre conduite
n'ait produit ce miracle.»
A la fin de l'acte IV, la statue du Commandeur, lors de sa vi
site à Don Juan, explicite ce que sa seule présence aurait suffi à
indiquer.
Refusant le flambeau que Don Juan propose, elle dit:
« On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par
le Ciel.
»
Elvire, à l'occasion de sa seconde visite {IV, 6), évoque avec
insistance le châtiment et la damnation qui suivra.
Après la seconde visite de Don Louis, l'apologie de l'hypo
crisie par Don Juan et l'épisode avec Don Carlos, Sganarelle re
vient sur cette apologie 'pour en dénoncer le caractère scanda
leux.
Nouvelle occasion pour annoncer, d'une façon nette, une
intervention du Ciel:
« C'est maintenant que je désespère, et je crois que le
Ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du
tout cette dernière horreur.
»
Et voilà maintenant qu'arrive un spectre lui aussi très
explicite:
« Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de
la miséricorde du Ciel.
»
Par cette lancinante annonce du malheur résultant de- la
volonté d'une divinité, la pièce s'apparente à la tragédie.
La tra
gédie, en effet, ne repose pas sur le suspense comme le drame.
On ne se demande pas ce qui va arriver au héros, car sa destinée
est annoncée dès le début.
Avec un tel effet d'annonce, le dé
nouement ne paraît pas artificiel et simplement plaqué à la fin de
la pièce parce qu'il faut bien terminer une pièce.C'est même son
absence qui deviendrait incompréhensible.
• Un dénouement nécessaire, dans le sens littéraire du tenne.
Pour la dramaturgie classique, les événements ne doivent pas
arriver d'une manière fortuite.
Il n'est pas possible de se débar
rasser d'un personnage en le faisant mourir d'un saignement de
nez ainsi que cela se trouve chez Corneille.
Un dénouement tout
à fait inattendu comme le coup de théâtre qui termine Tartuffe
n'est pas autorisé.
A partir d'une crise mise en place dès le début, de nombreuses
péripéties, dont le dénouement, peuvent se produire.
Mais ces
péripéties ne doivent pas survenir gratuitement.
Elles doivent
découler de la psychologie des personnages, en être la consé
quence.
C'est en cela qu'elles ont un caractère de «nécessité».
C'est exactement ce qui se passe pour Dom Juan.
Le dénoue
ment est une conséquence inéluctable de la marche de l'action et
de la psychologie du héros.
Tout au long de la pièce, Don Juan
n'a cessé de monter degré par degré dans l'ignominie.
Il a suc
cessivement enlevé une femme d'un couvent, tenté un enlève
ment par la force, ce qui s'apparente au viol, bafoué la statue
d'un homme qu'il avait tué, souhaité la mort de son père, et
enfin, ce qui paraît le comble à Sganarelle, décidé de masquer
ses vices sous le manteau de la religion.
Cette incessante pro
gression dans le vice devait déboucher sur un climax fatal.
Pourtant, le Ciel ne réagit pas encore, semblant donner raison
à Don Juan contre tous ceux qui l'avertissent.
Mais un ultime
degré va être franchi et provoquer sa colère immédiate.
Dans la
scène 5 de l'acte V, une dernière chance est donnée à Don Juan
s'il accepte de se repentir.
Son refus du remords, la faute suprê
me, provoque la foudre du Ciel.
Quelques secondes après ce
refus de se repentir, Don Juan est mort.
• La démesure: le héros de la tragédie grecque est puni par les
dieux pour avoir commis un acte de démesure, un acte qui parti
cipe de l'hybris.
En dépassant une limite, il outrage les dieux,
lesquels le lui font payer.
C'est exactement ce qui arrive à Don Juan.
Simplement, à la
différence du théâtre grec, le châtiment survient immédiatement
et sans appel après le franchissement des limites.
• Le miroir d'une société: on a dit du théâtre grec qu'il était
une fête, mais aussi un acte politique.
La représentation permet
tait à une société tout entière de se faire présenter comme dans
une sorte de miroir, les grands problèmes qui la traversaient.
Dom Juan peut être rapproché de ce type de spectacle.
Laissons les nombreuses références à l'actualité (voir p.
97-111142-179) pour nous en tenir à l'essentiel.
Dom Juan peut être
perçu comme un grand mythe sur le péché, c'est-à-dire sur la fa
çon dont les gens du xvne siècle envisageaient le problème du
mal.
Son dénouement correspondait à la thèse officielle de
!'Eglise: toute faute est pardonnable.
Saint Augustin, dans un
premier temps grand pécheur.
en était la preuve.
Ne disait-on pas
« A tout péché miséricorde»? Mais le refus de se repentir était
considéré comme diabolique.
Il se rattache.
en effet.
au péché
d'orgueil par lequel Adam avait déjà conduit les hommes à la
déchéance.
Le dénouement, dont nous avons vu qu'il était rendu néces
saire par la gradation dans le crime.
appann"t aussi parfaitement
motivé sur un plan idéologique.
Le Spectre
• Un héros faustien: la phrase prononcée par le Spectre sonne
comme un verdict.
Don Juan est mis directement en cause, com
me objet d'un jugement qui découle de son comportement.
Le
caractère fatidique, inéluctable, de cette déclaration ne laisse
aucune marge à la volonté humaine, aucune autre disponibilité
que le repentir, c'est-à-dire la soumission absolue à l'autorité du
Ciel.
Il est à noter que le Spectre parle déjà comme le gardien du
Temps, ce qui explique sa future transformation.
La scansion de
la phrase fait penser au battement impitoyable d'une horloge, au
rythme régulier sur lequel s'écoule le fatal sablier.
Le Spectre ne
porte pas d'appréciation, il ne s'implique pas dans ses paroles.
Il
rend compte d'une situation qui a valeur de fait.
mais qui ouvre
aussi sur un choix, où le Ciel n •a point de part.
un choix laissé à
l'homme.
On relèvera l'accent sur «n'a plus qu'un moment»,
qui sont les termes dominants de cet énoncé.
Cette séquence est construite selon un mouvement descen
dant.
La vigueur incisive, tranchante de la deuxième période,
scindée par la virgule et culminant sur la note aiguë de « réso
lue», contraste avec l'emphase de la première période qui se
déroule sans interruption jusqu'au point-virgule.
Cette courbe
mélodique a pour effet de renforcer l'aspect irrévocable de
la sentence.
On observe également un parallélisme dans la répétition de la
particule «ne», une fois au sens temporel.
dans «ne.•.
que».
une
deuxième fois au conditionnel, dans «si...
ne».
Le temps est
rattaché à une condition.
celle du repentir.
L'intérêt de l'analyse grammaticale est de révéler le mouve
ment même des idées sous l'organisation syntaxique.
Ainsi.
le
fait de prendre Don Juan pour sujet de la phrase s'explique
d'abord par la distance, la neutralité de l'énoncé.
Cette construc
tion suffit pour suggérer que l'homme n'est pas passif, mais
actif face à son destin.
Le sort de Don Juan ne dépend pas du
Ciel, mais de lui seul, de sa volonté, de sa liberté.
Le Ciel se
contente de tirer les conséquences irrémédiables d'un choix de
vie, d'une décision qui a rapport au temps.
On s'aperçoit alors que, derrière l'allégorie qui se démasque
sous ses yeux, Don Juan est à même de deviner un enjeu qui
n'est pas extérieur à lui, dans les sphères d'une imagerie conve
nue, mais qui est intérieur, qui tient à son existence même telle
qu'il l'a voulue, telle qu'il continue à la vouloir.
On découvre alors le sens de la relation qui apparaît entre le
«oui» et le «non», entre la liberté de choix laissée à Don Juan et
le rétrécissement du temps, cette peau de chagrin qui bientôt ar
rive à sa fin.
Dans cette perspective qu'ouvre le simple jeu grammatical, il
n'est plus question de doctrine chrétienne ni de révolte libertine,
il n'est question que des options les plus simples qui déterminent
le cours d'une existence.
Don Juan a opté pour l'intensité contre
la durée.
L'exigence du repentir, la soumission à la volonté divine,
l'acceptation des grâces du Ciel peuvent s'interpréter comme la
nécessité de rentrer dans le rang, de préférer la sécurité au risque,
la place assise à l'aventure.
Le châtiment qui menace Don Juan
n'est pas prononcé par une puissance supérieure; il découle de la
vie même de Don Juan, il dépend de la volonté de Don Juan lui
même, il est l'expression et la conséquence de sa liberté.
L'histoire de Don Juan apparaît donc comme une contribu
tion au mythe faustien.
La réponse de Don Juan à la Statue est
l'équivalent du pacte de Faust avec le diable: rendez-moi ma
jeunesse, rendez-moi mes plaisirs et je vous cède mes droits sur
l'éternité.
Si on retient cette lecture, l'urgence du repentir signifie que
Don Juan est arrivé au bout de son rouleau.
Il a fait son temps,
ce qm est une manière de dire que son temps est venu.
Cette association entre l'amour et le temps, entre le désir et la
durée, explique peut-être l'étrange réaction de Don Juan en
entendant le Spectre: «Qui ose tenir ces paroles ? Je crois
connaître cette voix.»
D'abord, le frémissement orgueilleux du grand seigneur qui
ne supporte pas qu'on lui dicte sa conduite.
Mais ce « Qui ose»
peut signifier autre chose, en liaison directe avec cette voix qu'il
croit reconnaître.
La familiarité de la voix, le fait que le Spectre est une femme
voilée comme l'était Elvire, tout cela laisse à penser que le
Spectre est une 'représentation d'Elvire.
Bien que cette associa
tion vienne aussitôt à l'esprit, elle doit cependant être écartée,
car il n'y a rien de commun entre l'impassibilité du Spectre et
l'exaltation, l'engagement, la compassion d'Elvire.
Il se peut
alors que cette figure évoque, de manière purement allégorique,
les femmes que Don Juan a aimées.
.
Seules ces femmes qu'il a trompées ont des droits sur lui, ces
droits qu'Elvire, pour sa part, n'a pas manqué de lui rappeler.
En
demandant «Qui ose?», peut-être Don Juan pense-t-il soudain
que ses victimes seules ont le droit d'oser.
Ces femmes à qui il a consacré toute sa vie, tout son temps,
ces femmes ont été des instruments de plaisir, mais elles repa
raissent en cet ultime moment pour demander des comptes.
Les
comptes, d'ailleurs, sont déjà faits.
Car ces femmes, par leur
soumission même, n'ont pas été seulement les victimes de Don
Juan: elles ont été en même temps ses bourreaux.
Elles lui ont
arraché, l'une après l'autre, ses parcelles de temps et de vie;
elles l'ont épuisé.
Aujourd'hui, elles prennent la figure du
Temps pour lui présenter leurs créances, comme Monsieur
Dimanche.
• Une fantasmagorie burlesque: la remarque de Sganarelle
introduit l'élément de tension, habituel dans cette pièce, entre le
tragique et le burlesque.
La coexistence des registres opposés
caractérise la poétique de Dom Juan.
C'est tout le sens du couple
formé par Don Juan et Sganarelle.
Sganarelle poursuit, d'ailleurs, dans la veine du comique
involontaire, quand, effrayé, mais aussi ébahi, admiratif, comme
on peut l'être devant un spectacle de Grand-Guignol, il s'excla
me: «O Ciel!» Ici, l'invocation banale est tout à fait en situa
tion.
La fantasmagorie des transformations du Spectre marque
l'intrusion du surnaturel et indique bien qu'on ne peut confondre
cette figure avec celle d'Elvire.
Le Spectre maniieste sa double
nature, humaine, quand il apparaît en femme voilée, divine
quand il représente le Temps avec sa faux.
Quand il s'envole
pour échapper à Don Juan, l'impression de frayeur cède la place
à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓