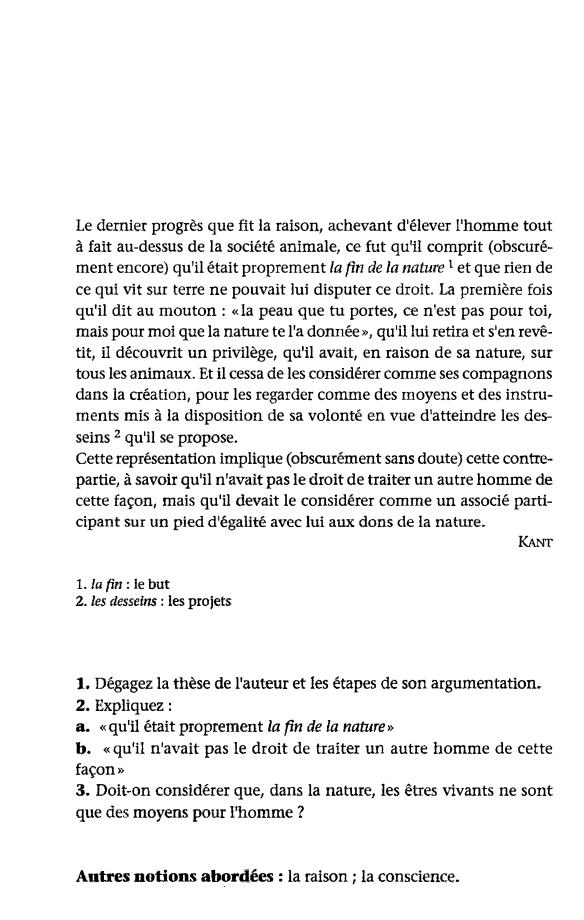Le dernier progrès que fit la raison, achevant d'élever l'homme tout à fait au-dessus de la société animale, ce fut...
Extrait du document
«
Le dernier progrès que fit la raison, achevant d'élever l'homme tout
à fait au-dessus de la société animale, ce fut qu'il comprit (obscuré
ment encore) qu'il était proprement la fin de la nature 1 et que rien de
ce qui vit sur lerre ne pouvait lui disputer ce droit.
La première fois
qu'il dit au mouton : « la peau que tu portes, ce n'est pas pour toi,
mais pour moi que la nature te l'a donnée», qu'il lui retira et s'en revê
tit, il découvrit un privilège, qu'il avait, en raison de sa nature, sur
tous les animaux.
Et il cessa de les considérer comme ses compagnons
dans la créalion, pour les regarder comme des moyens et des instru
ments mis à la disposition de sa volonté en vue d'atteindre les des
seins 2 qu'il se propose.
Cette représentation implique (obscurément sans doute) cette contre
partie, à savoir qu'il n'avait pas le droit de traiter un autre homme de
cette façon, mais qu'il devait le considérer comme un associé parti
cipant sur un pied d'égalité avec lui aux dons de la nature.
KANr
1.
la fin : le but
2.
les desseins : les projets
1.
Dégagez la thèse de l'auteur et les étapes de son argumentation.
2.
Expliquez :
a.
« qu'il était proprement la fin de la nature»
b.
« qu'il n'avait pas le droit de traiter un autre homme de cette
façon»
3.
Doit-on considérer que, dans la nature, les êtres vivants ne sont
que des moyens pour l'homme ?
Autres notions abordées : la raison ; la conscience.
1.
Dégagez la thèse de l'auteur et les étapes de son argumentation
Kant fait ici la généalogie de la raison humaine et de son rapport à la
nature.
Il évoque le moment où la conscience a permis à l'homme de se comprendre comme couronnement de la création et fin de la nature, et non plus
comme un élément de la nature parmi d'autres.
Le simple fait de parler de
nature indique d'ailleurs que l'homme se distingue de tout ce qu'il perçoit.
Le texte se déroule en deux temps.
Tout d'abord, Kant explique comment
l'homme a réalisé la transition vers une nature considérée intégralement
comme un ensemble de moyens à son service : il illustre ainsi la célèbre formule de Descartes selon laquelle nous sommes destinés à nous rendre
« comme maîtres et possesseurs de la nature».
Il montre ensuite que cette
distinction est créatrice de solidarité et de moralité puisque toute l'espèce
humaine est considérée comme ayant un statut spécifique, celui de seule
catégorie échappant par principe à une pure et simple utilisation.
2.
Expliquez :
a.
«qu'il était proprement la fin de la nature»
La notion de «fin» indique une intention, un but.
Comment l'homme
peut-il se comprendre comme «fin de la nature»? Lorsque nous contemplons
la nature, dit Kant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que tout en
elle correspond à un but : tous les organes des animaux ont une fonction adaptée à leur milieu, les moindres détails révèlent des trésors de complexité aboutissant à l'exécution de tâches parfois très simples.
Comme l'homme, par son
intelligence, trouve le moyen d'utiliser à son profit tout ce qu'il découvre dans
la nature, il en vient naturellement à considérer que c'est spécifiquement pour
lui que tout a été créé, vers lui que tout converge.
C'est une vue de l'esprit qui
caractérise la conception anthropocentrique de la nature.
En fait Kant précise
que cette idée, bien qu'inévitable, ne peut être considérée comme une connaissance positive, mais uniquement comme un « concept réfléchissant» qui
donne un fil directeur pour penser la cohérence de ce que l'on voit.
De même,
on ne peut pas démontrer positivement qu'un organe a été créé pour assumer
une fonction, on peut seulement constater qu'il le fait.
b.
«qu'il n'avait pas le droit de traiter un autre homme de cette façon»
Pourquoi l'homme épargne-t-il ses semblables alors qu'il estime avoir le
droit d'exploiter toute la création comme un ensemble de moyens mis à sa
disposition ? Parce que tous les hommes sont la fin de la nature, et qu'à ce
256 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
titre, ils n'ont pas seulement un prix comme tout le reste des êtres de la
nature, ils ont une dignité que l'homme doit respecter.
Cette «contrepartie»
est critiquée par certains partisans actuels de l'écologie et de la protection
des animaux comme étant l'équivalent, à l'égard de la nature, du racisme :
l'homme privilégie arbitrairement son espèce et affirme n'avoir de devoirs
qu'envers....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓