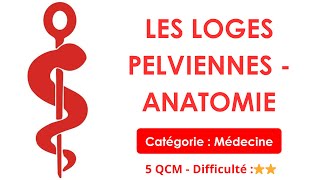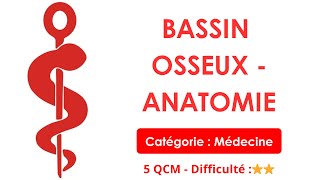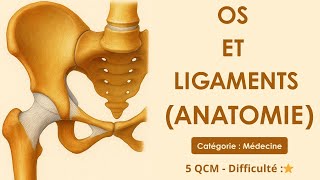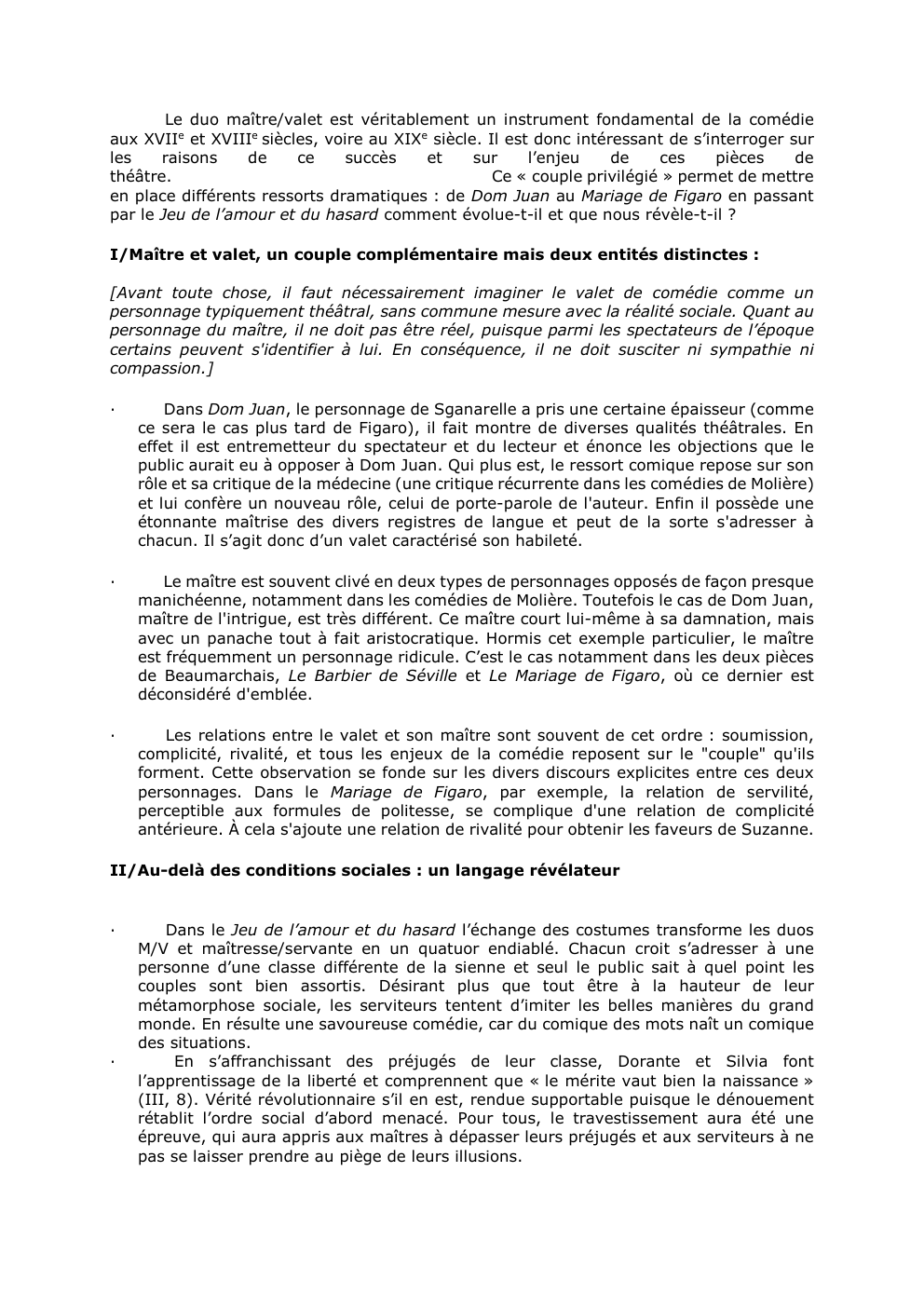Le duo maître/valet est véritablement un instrument fondamental de la comédie aux XVIIe et XVIIIe siècles, voire au XIXe siècle....
Extrait du document
«
Le duo maître/valet est véritablement un instrument fondamental de la comédie
aux XVIIe et XVIIIe siècles, voire au XIXe siècle.
Il est donc intéressant de s’interroger sur
les
raisons
de
ce
succès
et
sur
l’enjeu
de
ces
pièces
de
théâtre.
Ce « couple privilégié » permet de mettre
en place différents ressorts dramatiques : de Dom Juan au Mariage de Figaro en passant
par le Jeu de l’amour et du hasard comment évolue-t-il et que nous révèle-t-il ?
I/Maître et valet, un couple complémentaire mais deux entités distinctes :
[Avant toute chose, il faut nécessairement imaginer le valet de comédie comme un
personnage typiquement théâtral, sans commune mesure avec la réalité sociale.
Quant au
personnage du maître, il ne doit pas être réel, puisque parmi les spectateurs de l’époque
certains peuvent s'identifier à lui.
En conséquence, il ne doit susciter ni sympathie ni
compassion.]
·
Dans Dom Juan, le personnage de Sganarelle a pris une certaine épaisseur (comme
ce sera le cas plus tard de Figaro), il fait montre de diverses qualités théâtrales.
En
effet il est entremetteur du spectateur et du lecteur et énonce les objections que le
public aurait eu à opposer à Dom Juan.
Qui plus est, le ressort comique repose sur son
rôle et sa critique de la médecine (une critique récurrente dans les comédies de Molière)
et lui confère un nouveau rôle, celui de porte-parole de l'auteur.
Enfin il possède une
étonnante maîtrise des divers registres de langue et peut de la sorte s'adresser à
chacun.
Il s’agit donc d’un valet caractérisé son habileté.
·
Le maître est souvent clivé en deux types de personnages opposés de façon presque
manichéenne, notamment dans les comédies de Molière.
Toutefois le cas de Dom Juan,
maître de l'intrigue, est très différent.
Ce maître court lui-même à sa damnation, mais
avec un panache tout à fait aristocratique.
Hormis cet exemple particulier, le maître
est fréquemment un personnage ridicule.
C’est le cas notamment dans les deux pièces
de Beaumarchais, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, où ce dernier est
déconsidéré d'emblée.
·
Les relations entre le valet et son maître sont souvent de cet ordre : soumission,
complicité, rivalité, et tous les enjeux de la comédie reposent sur le "couple" qu'ils
forment.
Cette observation se fonde sur les divers discours explicites entre ces deux
personnages.
Dans le Mariage de Figaro, par exemple, la relation de servilité,
perceptible aux formules de politesse, se complique d'une relation de complicité
antérieure.
À cela s'ajoute une relation de rivalité pour obtenir les faveurs de Suzanne.
II/Au-delà des conditions sociales : un langage révélateur
·
·
Dans le Jeu de l’amour et du hasard l’échange des costumes transforme les duos
M/V et maîtresse/servante en un quatuor endiablé.
Chacun croit s’adresser à une
personne d’une classe différente de la sienne et seul le public sait à quel point les
couples sont bien assortis.
Désirant plus que tout être à la hauteur de leur
métamorphose sociale, les serviteurs tentent d’imiter les belles manières du grand
monde.
En résulte une savoureuse comédie, car du comique des mots naît un comique
des situations.
En s’affranchissant des préjugés de leur classe, Dorante et Silvia font
l’apprentissage de la liberté et comprennent que « le mérite vaut bien la naissance »
(III, 8).
Vérité révolutionnaire s’il en est, rendue supportable puisque le dénouement
rétablit l’ordre social d’abord menacé.
Pour tous, le travestissement aura été une
épreuve, qui aura appris aux maîtres à dépasser leurs préjugés et aux serviteurs à ne
pas se laisser prendre au....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓