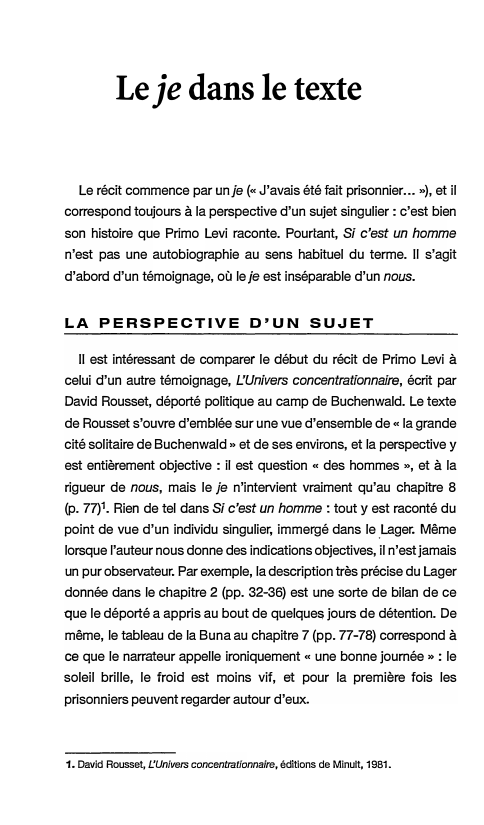Le je dans le texte Le récit commence par unje (« J'avais été fait prisonnier.•• »), et il correspond toujours...
Extrait du document
«
Le je dans le texte
Le récit commence par unje (« J'avais été fait prisonnier.•• »), et il
correspond toujours à la perspective d'un sujet singulier : c'est bien
son histoire que Primo Levi raconte.
Pourtant, Si c'est un homme
n'est pas une autobiographie au sens habituel du terme.
Il s'agit
d'abord d'un témoignage, où le je est inséparable d'un nous.
LA PERSPECTIVE D'UN SUJET
II est intéressant de comparer le début du récit de Primo Levi à
celui d'un autre témoignage, L:Univers concentrationnaire, écrit par
David Rousset, déporté politique au camp de Buchenwald.
Le texte
de Rousset s'ouvre d'emblée sur une vue d'ensemble de « la grande
cité solitaire de Buchenwald » et de ses environs, et la perspective y
est entièrement objective : il est question « des hommes », et à la
rigueur de nous, mais le je n'intervient vraiment qu'au chapitre 8
(p.
77)1• Rien de tel dans Si c'est un homme: tout y est raconté du
point de vue d'un individu singulier, immergé dans le .Lager.
Même
lorsque l'auteur nous donne des indications objectives, il n'est jamais
un pur observateur.
Par exemple, la description très précise du Lager
donnée dans le chapitre 2 (pp.
32-36) est une sorte de bilan de ce
que le déporté a appris au bout de quelques jours de détention.
De
même, le tableau de la Buna au chapitre 7 (pp.
77-78) correspond à
ce que le narrateur appelle ironiquement « une bonne journée » : le
soleil brille, le froid est moins vif, et pour la première fois les
prisonniers peuvent regarder autour d'eux.
1.
David Rousset, !.:Univers concentrationnaire, éditions de Minuit, 1981.
UN JE QUI N'EST PAS
AUTOBIOGRAPHIQUE
Le début du récit peut être dit autobiographique.
Primo Levi nous
livre un rapide portrait de ce qu'il était lors de son arrestation : " J'avais
vingt-quatre ans, peu de jugement, aucune expérience[...] » (p.
11).
Mais nous n'en saurons guère davantage car, une fois immergé dans
le Lager, le sujet n'a plus vraiment d'histoire individuelle.
1Un sujet sans histoire
Non seulement le détenu perd son nom pour devenir un simple
numéro, un être anonyme, mais il n'a plus de passé.
C'est pourquoi
les témoignages commencent généralement soit par l'arrestation de
l'auteur, soit par son arrivée dans le camp.
Les souvenirs sont
oubliés et doivent l'être pour que le déporté puisse s'adapter à cette
vie nouvelle, car pour lui tout rappel du passé, aussi bref soit-il,
s'accompagne de souffrance.
L'avenir est également absent, car au
Lager les projets se limitent à la survie immédiate et la seule
perspective est celle de la mort :
« [ •••]
d'ici, on n'en sort que par la
cheminée2 », s'entendent dire les nouveaux arrivants (p.
29).
On ne
peut donc parler d'autobiographie dans la mesure où celle-ci renvoie
au déroulement de l'histoire d'un sujet, tandis que le récit de Primo
Levi nous enferme dans le présent du Lager.
D'ailleurs, rappelons-le,
le but de l'auteur n'est pas de raconter sa vie, mais de témoigner, à
la fois pour lui et pour les autres.
1Le je et le nous
Si le récit commence bien par un je, il passe très vite au
nous peut d'ailleurs revêtir différents sens.
nous.
Ce
Il peut désigner, mais c'est
assez rare, l'action commune et la camaraderie : tel est le cas au début,
lorsqu'il est question du groupe de partisans dont l'auteur faisait partie,
et à la fin, quand il s'efforce avec deux autres détenus, Charles et
Arthur; d'organiser la survie de ceux qui ont été laissés au Lager.
2.
Il s'agit bien évidemment de la cheminée du four crématoire où l'on brûlait des
cadavres.
70
PROBLÉMATIQUES ESSENTIELLES
Le
nous
peut aussi exprimer la solidarité dans la souffrance et
dans le deuil, notamment lorsque le narrateur décrit le rituel funéraire
auquel se livrent les femmes le soir précédant le départ du train
(p.
14), et lorsqu'à l'arrivée de celui-ci il évoque la première
«
sélection » :
«
Ainsi disparurent en un instant, par traîtrise, nos
femmes, nos parents, nos enfants» (p.
19).
Le narrateur, qui n'a luimême ni femme ni enfant, qui n'est pas non plus un Juif pieux,
éprouve son appartenance à un peuple persécuté.
Le nous dont il s'agit à l'intérieur du Lager est différent: c'est un on
anonyme, une masse indifférenciée dans laquelle le je est noyé.
Dans
le chapitre 16 ne demeure plus qu'un seul homme capable de dire je,
«
«
le dernier » : il meurt face à une
«
masse abjecte » d'hommes
domptés, éteints», incapables du moindre geste de solidarité (p.
160).
LE RETOUR DE L'IDENTITÉ
Il arrive cependant qu'à de rares moments et dans des
circonstances exceptionnelles, l'identité personnelle se manifeste.
1Les souvenirs de la vie antérieure
Parfois, des bribes du passé remontent à la surface.
Ainsi, lorsque le
détenu se retrouve à l'infirmerie, le
«
mal de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓