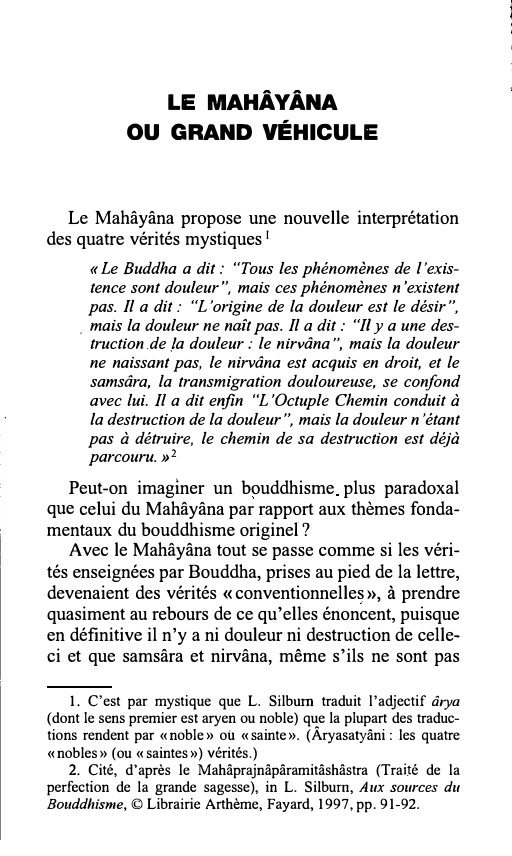LE MAHÂYÂNA OU GRAND VÉHICULE Le Mahâyâna propose une nouvelle interprétation des quatre vérités mystiques 1 « Le Buddha a...
Extrait du document
«
LE MAHÂYÂNA
OU GRAND VÉHICULE
Le Mahâyâna propose une nouvelle interprétation
des quatre vérités mystiques 1
« Le Buddha a dit: "Tous les phénomènes de l'exis
tence sont douleur", mais ces phénomènes n'existent
pas.
Il a dit: "L'origine de la douleur est le désir",
, mais la douleur ne naît pas.
Il a dit : "Il y a une des
truction _de ,la douleur : le nirvâna ", mais la douleur
ne naissant pas, le nirvâna est acquis en droit, et le
samsâra, la transmigration douloureuse, se confond
avec lui.
Il a dit enfin "L 'Octuple Chemin conduit à
la destruction de la douleur", mais la douleur n'étant
pas à détruire, le chemin de sa destruction est déjà
parcouru.
» 2
Peut-on imaginer un bouddhisme plus paradoxal
que celui du Mahâyâna par rapport aux thèmes fonda
mentaux du bouddhisme originel?
Avec le Mahâyâna tout se passe comme si les véri
tés enseignées par Bouddha, prises au pied de la lettre,
devenaient des vérités «conventionnelles», à prendre
quasiment au rebours de ce qu'elles énoncent, puisque
en définitive il n'y a ni douleur ni destruction de celle
ci et que samsâra et nirvâna, même s'ils ne sont pas
1.
C'est par mystique que L.
Silburn traduit l'adjectif ârya
(dont le sens premier est aryen ou noble) que la plupart des traduc
tions rendent par «noble» oil «sainte».
(Âryasatyâni : les quatre
«nobles» (ou «saintes») vérités.)
2.
Cité, d'après le Mahâprajnâpâramitâshâstra (Traüé de la
perfection de la grande sagesse), in L.
Silbum, Aux sources du
Bouddhisme,© Librairie Arthème, Fayard, 1997, pp.
91-92.
«identiques», comme nous le verrons, ne sont pas au
fond différents.
Mais si donc il n'y a pas à sortir du karma-samsâra,
à s'éjecter progressivement de la production condi
tionnée (pratftyasamutpâda) et qu'il n'y a pas de voie
qui mène du samsâra au nirvâna puisque les deux se
confondent, ni donc de chemin à parcourir, que peut
bien enseigner le Mahâyâna?
Il semble bien que poursuivant l'effort de vérité,
amorcé par le bouddhisme du petit Véhicule, le
Mahâyâna porte celui-ci, dans plusieurs directions, à
sa pointe ultime et souvent paradoxale à nos yeux.
Il affinera et complétera la figure du bodhisattva
comme «sauveur universel», celle de la nature de
bouddha qu'au fond chacun est et possède, il estom
pera la différence trop rigoriste et inutile à ses yeux
entre religieux et laïcs, il acceptera croyances et rites
religieux dévotionnels divinisant bouddhas et bodhi
sattvas, supra-mondains et compatissants.
Mais aussi,
et surtout pourrait-on dire, en niant toute différence
entre le samsâra et le nirvâna, sans pour autant les
rendre identiques, il enseignera la double vérité (la
conventionnelle, faite de subterfuges et d'habilité com
patissants ; la parfaite comme vérité pure et ultime) et
concevra, jusqu'à un point vertigineux, l'ultime réa
lité-vérité comme ce qui est vide (shûnya) de tout
phénomène, de toute existence, de toute production
conditionnée, sans que pour autant ne soit supprimée
leur vérité conventionnelle.
D'une part donc, une extraordinaire spéculation,
sujette à controverses entre écoles diverses, visant à
l'omniscience et à l'omnisapience; d'autre part, une
compassion telle qu'il n'y a plus non seulement ni
moi ni mien, mais un exhaussement collectif de toute
la pâte humaine, sinon de tous les vivants des trois
152 / La philosophie indienne
mondes et des cinq états, comme représentés sur la
roue de la vie (bhavachakra).
Notons pour terminer, sur une comparaison, cette
brève approche, qu'il y a, par exemple, autant de« paradoxe » dans le passage du judaïsme au christianisme
que dans celui du passage du Hînayâna au Mahâyâna,
quoique ces passages s'expliquent toujours, parmi de
multiples autres facteurs, à partir d'un « conceptpont », d'une idée-force qui sert en quelque sorte
d'interface.
En effet, à partir de la ressemblance
humano-divine de l 'Ancienne Alliance (l'homme est
créé à la ressemblance et à l'image de Dieu), l'Incarnation I peut s'offrir comme pensable et n'apparaît pas en
tout cas comme absurde.
Il n'en est pas de même de
l'idée de Trinité qui, tout en n'altérant en rien l'unicité
de Dieu, la module mystérieusement et est un développement théologique doctrinal sui generis.
De même peut-on dire, l'état de bodhisattva (être
qui se destine à l'Eveil, à devenir bouddha, tout en
restant « au service» de tous) préfigure dans le bouddhisme ancien l'importance qu'il revêtira dans le
Mahâyâna.
Mais, comme nous le verrons, la double
vérité et la non-production (anutpâda) sont à proprement parler des développements sui generis du
Mahâyâna, plutôt que des développements pensables
dans le cadre du bouddhisme originel.
1.
« Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir
Dieu», selon la forte parole de saint Irénée, un des Pères grecs de
l'Eglise.
L'idéal du bodhisattva
Dans le bouddhisme ancien, fondateur, l'idéal était
de parvenir à l'état de «saint» (arhat), la quatrième et
dernière étape d'une progression en libération-sain
teté.
Cet état de perfection, de sainteté n'était atteint
que par quelques êtres d'élite et déjà méritants de par
leurs vies antérieures - en gros quelques religieux et
occasionnellement l'un ou l'autre laïc - dont la pré- ·
occupation unique était la sanctification personnelle
ne laissant aucune place au service d'autrui, au salut
d'autrui.
Avec le Mahâyâna, quelque cinq cents ans après la
mort de Bouddha, il ne s'agit plus de devenir un arhat
qui se sauve tout seul, mais de devenir un bodhisattva
(un être d'Eveil) pour lequel le salut de tous est l'af
faire dont il ne cesse de se préoccuper, mettant au ser
vice de tous les êtres une compassion immense que
soutient une omniscience (connaissance parfaite) et
une omnisapiènce (sagesse parfaite), capables de tout
transmuer.
Tout se passant comme si la chaleur ou la
bonne odeur qui se dégageait du bodhisattva ne pou
vait que se répandre sur tous les êtres, les faisant ainsi
bénéficier de ce dont ils n'auraient pas mérité par
leurs efforts personnels.
C'est d'ailleurs pour marquer
cette différence d'idéal que les adeptes du Mahâyâna
appellent, de façon quelque peu condescendante, les
adeptes de l'idéal de l'arhat ceux qui suivent le Petit
Véhicule, se réservant, de façon quelque peu triom
phante, l'appellation de ceux qui suivent le Grand
Véhicule, celui de l'idéal du bodhisattva.
Ce n'est pas à dire que le terme de bodhisattva ne ·
figure pas dans les textes du Hînayâna, mais il désigne
alors uniquement Bouddha dans ses existences anté
rieures, telles que racontées dans les Jâtakas (les vies
antérieures de Bouddha).
D'autre part, Bouddha lui-même, ne s'étant pas
contenté d'être sauvé, éveillé, de savoir qu'il n'aurait
plus à renaître, mais ayant mis en branle la Roue de la
Loi au service de tous, ayant prêché durant quarante
cinq ans à dater de son Eveil les Quatre Saintes Véri
tés et l'enseignement qui l'explicite, avait lui aussi agi
en tant que bodhisattva compatissant, ayant renoncé à
«jouir» seul du nirvâna pour, sans se lasser, montrer
la voie de la délivrance.
L'exemple même de Bouddha, en tant que bodhi
sattva prêchant et compatissant, ne pouvait qu'encou
.
rager les mahâyânistes à revivifier un bouddhisme
devenu, à leurs yeux, par trop rigoriste, pas assez proche
- de tous.
Pour illustrer l'engagement altruiste I du bodhi
sattva, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de
citer deux textes.
Le premier, extrait d'un traité de discipline, à
l'usage de ceux qui empruntent la carrière de bodhi
sattva.
Le second, extrait d'un texte poétique du grand
poète mystique Shântideva (VIIe siècle de notre ère),
où le moi n'est autre que ce qui appartient à autrui!
1.
Le mot altruiste évidemment ne convient pas tout à fait, car
comment pourrait-il y avoir un tu, un autre égal à moi, un alter ego,
là où il n'y a pas de moi.
A l'insubstantialité du moi correspond
nécessairement l'insubstantialité de l'autre.
Par ailleurs, si dans la
conversion du mien au tien, il y a don et don total: il n'y a rien à
moi qui ne soit à toi, il y a bien «altruisme» en ce sens que l'in
verse (théoriquement tout aussi exact) n'est jamais affirmé: ce qui
est à toi est à moi ...
« Moi, de tel nom, qui ai ainsi produit la pensée de
Bodhi, j'adopte le monde infini des créatures pour
- mère, pour père, sœurs, frères, fils, filles, parents à
quelque degré et consanguins.
Les ayant adoptés, de
tout mon pouvoir, de toute ma force, de tout mon
savoir, j '.Y implanterai la racine du bien.
Désormais
le don que je ferai, la moralité que j'observerai, la
patience que je garderai, l'énergie que je déploierai,
l'extase que je pratiquerai, la sagesse que je dévelop
perai, l'adresse salvifique dont je témoignerai : tout
cela sera pour l'intérêt, le bien, le bonheur de tous les
êtres.»
in E.
Lamotte, op.
cité, p.
477
« Celui qui veut sauver rapidement, et soi-même et
autrui, doit pratiquer le grand secret : l'interversion
du moi et d'autrui.
L'àmour immodéré du moi fait
redouter le moindre danger : qui ne haïrait ce moi
aussi inquiétant qu'un ennemi, ce moi qui, par désir
de combattre la maladie, la faim, la soif, massacre
oiseaux, poissons, quadrupèdes et se pose en ennemi
de tout ce qui vit; qui par amour du gain ou des hon
neurs, irait jusqu'à tuer ses père et mère et à ravir le
patrimoine des Trois....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓